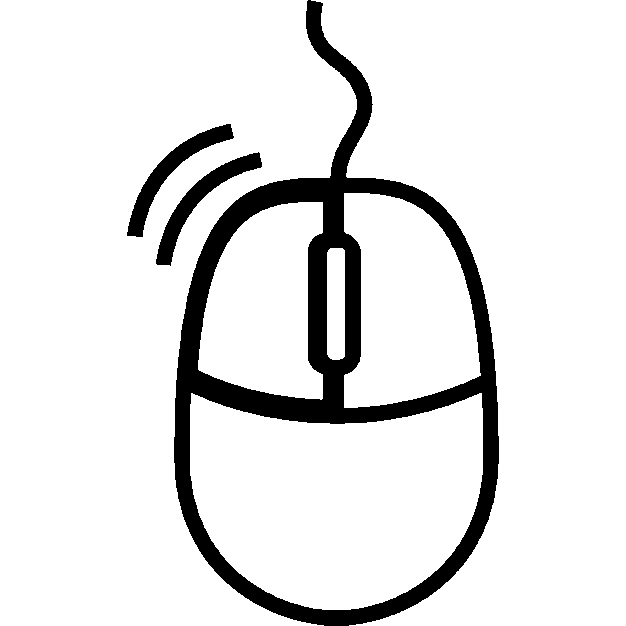Chapitre — I
BRUXELLES — BATAVIA
La petite Hollandaise
À la maison, à Bruxelles, nous parlions néerlandais. Nous étions Hollandais. Depuis que j'avais atteint mes sept ans, je suivais les cours de l'école chrétienne néerlandaise de Bruxelles. J'y avais appris l'hymne national hollandais —le Wilhelmus— et acquis le droit d'agiter un petit drapeau lors de visites de membres de la famille royale des Pays-Bas.
Mais dans la capitale belge, on parlait surtout le français. Au bac à sable, au parc, au bassin de natation, dans la rue, au jardin d'enfants, à la patinoire, on m'appelait donc 'la petite hollandaise'. Je trouvais la chose amusante, elle me donnait l'impression de jouir d'un statut particulier.
Peu avant le début de la guerre, on essaya de briser les vitres chez nous. On nous insulta. On nous appela 'sales Juifs'. J'en fus complètement retournée.
Je me souvins de ce que j'avais appris, à l'école, pendant la lecture de la bible. La demoiselle nous avait raconté que Jésus avait été crucifié, et comment, et par qui.
Je trouvais Jésus un très gentil monsieur, les Juifs m'avaient paru résolument antipathiques. Agir de cette façon ... Le soir, à table, j'essayai de raconter la belle histoire aussi bien que la demoiselle. Là-dessus, mes parents m'apprirent que j'étais moi-même une petite Juive. J'en demeurai sans voix. Être une petite Juive représentait une nouveauté difficile à intégrer.
Chez nous, à la maison, personne qui pratiquât. Chez mes grands-pères, grands-mères, oncles, tantes, pas davantage. Notre famille n'était fidèle qu'à certaines traditions judéo-néerlandaises sans rapport particulier avec la religion.
Le lendemain, j'allai frapper chez le pasteur qui habitait chez nous, à l'étage, et je lui demandai de me baptiser séance tenante. Fort aimablement, il me proposa d'entrer, m'interrogea et apprit ainsi que, le dimanche, au lieu de jouer dans la rue, j'allais très
souvent à la messe. Je trouvais cela fantastique. Les magnifiques vêtements, rouges et blancs, avec tant d'or et de broderies, les jolies petites chaises basses avec leur haut dossier et leur siège de paille, les accents majestueux de l'orgue, le chant des chœurs, le balancement de l'encensoir. J'aimais cette odeur, et celle des longs cierges aux flammes dansantes, toutes ces dorures, tout ce bois sculpté à fioritures.
Quant aux tableaux, je ne les regardais plus. Les couleurs m'en paraissaient trop sombres, les scènes qu'ils décrivaient trop tristes.
Le pasteur m'apprit les vers de Jacob Revius : 'ce ne sont pas les Juifs qui vous ont crucifié, Seigneur...' et la différence entre les religions catholique, protestante, israélite. Les protestants et les catholiques croyaient en Dieu et en son fils Jésus, les Juifs seulement en Dieu. Mais c'était toujours au même Dieu que s'adressaient leurs prières. Il existait aussi des gens qui n'étaient pas croyants, mes parents, par exemple. Et j'étais leur enfant. Je devais donc attendre pour me faire baptiser, attendre d'être grande. Je m'en allai, très déçue.
À partir de ce jour, je me mis à tout compartimenter,
tout caser dans mes petits tiroirs personnels. Les catholiques avaient des curés, les protestants des pasteurs, moi, j'avais mon père. Je refoulai le fait d'être-une-petite-juive. Je le rangeai dans le grand livre de l'oubli.
Mais les injures et les menaces sous nos fenêtres ramenèrent bien vite la chose en surface.
Pendant l'exode, le concept 'être Juif' ne me devint guère plus compréhensible, mais il apparut comme une évidence contre laquelle n'existait guère de recours. Tantôt nous étions des 'pauvres Juifs', ce qui nous valait d'être hébergés — en général contre une somme rondelette — tantôt nous étions des 'sales Juifs' et il ne nous restait plus qu'à déguerpir.
Mes parents nous avaient fait promettre, à ma sœur et à moi, de ne jamais dire que nous étions des Juifs, de ne jamais donner notre nom de famille, un patronyme aux consonances typiquement néerlandaises qui, en France, nous situait immédiatement parmi les étrangers.
Il m'apparut bientôt que nous ne cherchions pas seulement à fuir les Allemands — ils n'aimaient pas les Juifs — mais aussi que les Français ne semblaient pas plus apprécier les étrangers qu'ils n'appréciaient les Juifs, et donc nous.
Être-une-petite-Juive faisait problème. Un problème pour les autres. Mais qui devint vite un problème pour moi. Qu'est-ce que cela voulait dire? Nous avions pourtant l'air d'être comme tout le monde.
Par la suite, je connus des gens très différents. Je les rencontrai dans des camps de passage, dans des gares, dans des écoles, partout où peuvent aboutir des réfugiés. Des hommes qui portaient des longues vestes noires et des chapeaux de même couleur. Des hommes à longue barbe, avec des papillotes le long des joues. Ils se tenaient le plus souvent groupés, d'un côté avec les garçons, tandis que les femmes et les fillettes se tenaient de l'autre. Les garçonnets étaient vêtus tout à fait de la même façon que leurs pères, sauf que, chez eux, le chapeau était remplacé par une sorte de petite calotte posée sur le sommet du crâne. Ces gens parlaient une langue que je n'avais jamais entendue, mais que mon père comprenait. Je trouvais tout cela étrange, j'étais ébahie, remplie de curiosité aussi. Lorsque mon père leur parlait, je m'approchais d'eux, non sans serrer fortement sa main. Ces gens étaient des Juifs. Mon père aussi était Juif. Mais il semblait totalement différent. Je me sentais toute drôle, à l'intérieur, j'avais pitié de ces hommes, j'avais peur, j'étais désemparée. Ils avaient l'air si désespérément tristes. Et leur accoutrement accentuait encore cette tristesse. Leurs yeux gris foncé me paraissaient grands, très grands. Le peu de chair qu'on leur entrevoyait était blême. Leur comportement, leur maintien, leur regard exprimaient une intense douleur. Et ils marmonnaient sans arrêt, ils marmonnaient en balançant le torse. Ce marmonnement résonnait comme une lamentation. Une lamentation sans larmes.
Ces gens, j'ai voulu les oublier.
Ces gens, je ne les ai jamais oubliés. Sur leurs visages, sur leurs regards douloureux se superposent les visages osseux, de ceux qui, ayant survécu aux camps nazis, étant revenus de l'innommable, stupéfaits d'être encore en vie, stupéfaits d'avoir atteint les abîmes de la vie, regardaient leurs libérateurs sans les comprendre, sans les voir.
La fuite
Nous avons fui en train de Bruxelles à la Panne. Une semaine plus tard, nous nous retrouvions à pied sur le chemin de la France. Passée la frontière, l'exode se poursuivit à vélo, en bus, en train, en camion, en taxi, en camionnette. Du nord à l'ouest, de l'ouest à Paris, de Paris vers le sud-ouest, sur la côte, de la côte Toulouse. J'ai gardé des impressions de Dunkerque, Abbeville, Rouen, Bayonne, Biarritz, Pau et de bien d'autres villes et villages sur lesquels je ne peux plus mettre de nom.
Des premières semaines de la guerre je conserve l'image de routes qui semblaient ne jamais devoir finir, avec des milliers et des milliers de réfugiés chargés de paquets et de valises — de places dans des villes et des villages avec des gens assis, couchés, endormis — de gares aux quais noirs de monde — de camions surchargés de vieillards, d'enfants, de bétail — de groupes à la débandade devant les convois de troupes — de masses fuyant sous les salves de mitrailleuses — de voitures militaires inutilisables — de bagages abandonnés — de maisons bombardées — de maison vides — de quartiers dévastés — de tas de ruines encore fumantes — de corps mutilés — de gens en larmes.
Je me souviens du hurlement des sirènes - de la course à l'abri - du bruit infernal des bombardements - de la misère sans espoir qui les suivait. Mais les avions en flammes dans le ciel me paraissaient un fascinant spectacle. Il ne me venait pas à l'esprit que ces appareils étaient manœuvrés par des êtres humains.
Couvents
Pendant l'exode, nous avons dormi dans des gares, sur des bancs de parcs publics, sur le sol dans la nature, sur des chaises de café, dans des caves, des greniers, des hôtels, chez des paysans, chez des citadins, dans des centres d'accueil, dans des écoles, des couvents. Je n'aimais pas les couvents. Les religieuses n'y admettaient pas les hommes. Mon père devait donc se chercher un logement ailleurs et j'étais terrorisée à l'idée de le perdre. Mais les nonnes se préoccupaient beaucoup de nous et de la vie spirituelle de ces 'pauvres réfugiées', de ces 'pauvres juives'. Elles tentèrent de persuader ma mère de nous confier à elles, ma sœur et moi. J'aurais voulu leur imposer le silence. Elles me rendaient folle d'inquiétude. Je ne voulais pas rester en arrière, je ne voulais pas vivre avec elles. Les couvents étaient sombres, froids, humides, et je trouvais épouvantable de dormir par terre devant un crucifié grandeur nature. Quand on me réveillait, le matin, en m'annonçant que nous poursuivions notre route, je voyais de nouveau la vie en rose, et ce d'autant plus que je pouvais compter sur un grand café-crème. À la maison, je ne buvais pas de café. Ce n'était pas une boisson pour les enfants.
Payer
Mes parents faisaient le maximum pour que nous puissions rester ensemble, nous quatre, au moins pendant la journée. Ce n'était pourtant pas toujours possible. La première fois que nous sommes partis sans mon père, ce fut à cause du conducteur d'une Citroën. Au dernier moment, il se ravisa, il ne prendrait dans sa voiture que des femmes et des enfants. Déjà installé, mon père dut céder sa place à une Française et à son enfant. Après avoir roulé quelques heures, ce même chauffeur s'arrêta. Il se montra brutal, se mit à jurer. Il voulait obtenir plus d'argent de ma mère. C'était pendant un orage. Des chevaux apeurés se rassemblaient dans une prairie. Des éclairs zébraient le ciel. Ma mère donna l'argent. Le soir dans un café, nous obtînmes la permission de dormir sur des chaises. On nous éveilla. Le patron, qui avait bavardé avec le conducteur de la Citroën, voulait nous mettre à la porte. Il n'admettait pas d'étrangers dans son établissement. Ma mère dut une nouvelle foi régler la chose avec de l'argent. Le jour suivant, le petit jeu reprit. Le chauffeur exigea encore un surplus pour nous conduire au lieu de rendez-vous fixé par mon père.
Un mois de guerre
Et l'exode se poursuivit. Dans une petite gare, nous attendîmes pendant des heures un train pour Paris qui ne vint jamais. Nous atteignîmes tout de même la capitale française, à bord d'une camionnette de France-Soir. Nous y louâmes un appartement. Pour un mois. Cinq jours plus tard, l'avance allemande nous précipitait sur la route de Bayonne. C'est dans cette ville que, pour la première fois de mon existence, j'assistai à un service dans une synagogue.
Après quelques jours nous avons continué sur Biarritz.
Ça et là, nous avions dû abandonner des bagages. Les gens avaient priorité sur les valises. Et les bagages expédiés en avance étaient, le plus souvent, des bagages perdus.
Nous n'avions donc plus grand-chose. Et l'argent liquide faisait aussi problème. À Biarritz, nous prîmes un petit appartement meublé. Ma mère trouva un travail de couturière. J'ignorais que ma mère pût travailler.
Ma sœur et moi passions la journée dans une école tenue par des religieuses. Les nonnes m'interrogèrent. Elles voulaient savoir comment les juifs vivaient, chez eux, et je leur racontais ce que je savais. Je rendais compte de la vie quotidienne dans une famille juive, à Bruxelles, une famille qui mangeait de la soupe au poulet le vendredi soir et du pain azyme le dimanche matin.
À Biarritz, jour et nuit, mon père faisait la queue devant les portes des consulats. Nous l'y relayions parfois. Tout le monde voulait quitter la France. Des centaines de réfugiés attendaient, sur le quai, dans l'espoir de prendre un bateau. Nous quatre allions partir en Angleterre.
Il apparut bientôt que seul mon père obtiendrait une place. Ma mère pleura, ma sœur pleura.
Pau
Nous décidâmes de nous rendre à Pau. Comme les Allemands se rapprochaient de plus en plus, mon père partit sans attendre. Nous le suivîmes quelques heures plus tard, en taxi. Au bout d'une trentaine de kilomètres, le chauffeur refusa d'aller plus loin. Il voulait rentrer. Et nous étions là, sur la route. Il nous tallait gagner Pau, rejoindre mon père. Un bus de transports publics s'arrêta, bien qu'il n'y eût pas de halte. Le conducteur nous fit monter. Le soir même, nous étions à Pau. Mais aucune trace de mon père. Et aucun endroit où dormir. Avec notre maigre bagage, nous sommes retournées à la gare autoroutière. Le gardien nous autorisa à passer la nuit sur les banquettes d'un véhicule vide. Le lendemain, dans la ville surpeuplée, nous retrouvâmes mon père.
Il régnait dans Pau une atmosphère de découragement et de désespérance. Pas de vivres dans les magasins. Pas de place dans les cafés ou restaurants. Nous tournions en rond, nous errions. J'aurais voulu partir, partir aussi loin que possible de Pau. Nous sommes montés dans un train. Mon père se ravisa, nous descendîmes du train. Nous avions conquis, de haute lutte, quatre places dans un bus. Mon père se ravisa encore, nous descendîmes du bus. Nous nous sommes rendus dans un centre d'accueil pour réfugiés où ma mère nous ordonna de coucher tout habillées sur la paille. La nuit, mon père vint nous chercher. Il était allé aux informations, il avait entendu certaines rumeurs selon lesquelles des étrangers rassemblés dans ces centres seraient directement conduits en Allemagne.
Les Juifs restent à l'arrière
Nous sommes arrivés à Toulouse. Comment, je ne sais plus. Tout me pesait. Pau-Toulouse. Entre les deux, un blanc.
À Toulouse, nous les femmes avons de nouveau été hébergées dans un couvent, mon père dans une école. Ensuite, on s'installa à trois dans une mansarde, chez de très aimables paysans, dans un petit village, à quelques kilomètres de la ville. Ma sœur habitait chez des voisins. Enfin de compte, on s'est retrouvé à Lafourguette, dans un château aménagé en centre d'accueil pour les Belges et les Hollandais. La nourriture et l'hébergement y étaient gratuits.
Fin août, des autocars de la Croix-Rouge ramenèrent un grand nombre de réfugiés en Belgique et aux Pays-Bas. Ils retournaient chez eux, à la maison. Je rôdais entre les bus. Moi, neuf ans, comme j'aurais aimé rentrer à Bruxelles, à la maison... Mais les Juifs devaient rester à l'arrière. Trop dangereux de retourner, disait mon père.
Le Château
Le Château (1) [en français dans le texte original], un 'centre d'accueil pour les réfugiés belges et néerlandais, devint alors un camp pour les réfugiés juifs, porteurs de passeports hollandais. La plupart venaient de Belgique, certains des Pays-Bas, quelques-uns d'Autriche ou d'Allemagne. Le Consulat hollandais de Toulouse proposa à. mon père la responsabilité de ce camp. Nous logions à quatre dans une chambre qui servait durant la journée de bureau directorial. Les autres familles se groupaient tant bien que mal dans les salles et les greniers.
Nous pouvions nous promener librement dans le village. Pour Toulouse, il fallait une autorisation plutôt difficile à obtenir.
En dehors des corvées de camp, il n'y avait aucune possibilité de travail. Les hommes et les femmes du Château consacraient donc leurs journées à meubler le vide. Il y eut des tensions, des disputes, on se battait, on échangeait pères et mères. La mère de ma petite amie à la chevelure rousse fit une tentative de suicide. Les adultes prenaient plaisir à se défouler sur ma soeur et sur moi, mon père étant directeur du camp, donc coupable de tout, nous, les enfants, devions payer la note.
Ces adultes du Château, je ne les aimais pas, pas plus qu'ils ne m'aimaient.
Mon pépé (1) [en français dans le texte original] et un autre homme
Le Château était entouré d'un vaste parc.
Je fuyais loin des grandes personnes, grimpais très haut dans les arbres et y restais toute seule, des heures durant. C'est là que me découvrit un jour le gardien du Château — un vieil homme aux pommettes rouges, aux yeux rieurs. Il devint mon pépé. Ensemble nous allions cueillir des tomates, des raisins, des pêches. C'est lui qui m'apprit à boire. C'est à lui que je dois ma première cuite. Je revins très gaie, trouvant que la vie valait la peine d'être vécue. Quand mon pépé n'avait pas de temps à me consacrer, je sortais sans lui, j'allais toute seule cueillir des mûres, assez loin parfois. Souvent je rencontrais un cycliste coiffé d'un béret alpin, vêtu d'un costume beige, d'une chemise blanche, et dont la cravate était toujours impeccable. J'ai renoncé aux promenades et aux cueillettes des mûres le jour où cet homme jaillit d'un buisson, la braguette grande ouverte, d'où sortait un appendice avec lequel il jouait tout en répétant pstt, psst. Je me suis enfuie. Je trouvais l'incident effrayant. Je n'osais me confier à personne. Je n'y comprenais rien, je ressentais cela comme un acte coupable, une chose qui ne pouvait se produire. J'étais malade de honte, tout ensemble furieuse et malheureuse.
Suicide
Au Château, il fallait toujours faire attention et, quoi que vous fassiez, c'était toujours mal. Vivre y était dangereux.
Parfois, on me donnait la permission d'aller loger chez une famille juive hollandaise qui avait loué une petite habitation située à quelques kilomètres de là. J'adorais m'y rendre, c'était une véritable fête. Dans cette maisonnette n'éclatait jamais nulle dispute, ne régnait jamais nulle envie, nulle jalousie. Parmi eux, je redevenais moi, j'osais être 'je', être une petite fille et i non plus une silhouette pourchassée.
Or, sans la moindre explication, mes parents mirent fin à ces séjours. Les raisons, je les appris plus tard. Il n'y avait plus de famille. Ils étaient partis, ils étaient morts, ils s'étaient tués. Je souhaitai que nous pussions, â quatre, faire de même. Disparaître. Pour toujours.
Visa de transit
Les réfugiés n'étaient souhaités nulle part.
Quant aux réfugiés Juifs, ils étaient à peine tolérés. Tout ce qu'ils pouvaient obtenir, c'était un visa de transit, moyennant beaucoup d'argent, et encore: avec l'aide ou l'appui de hautes autorités.
Nous sommes restés plus d'un an au Château, attendant les papiers nécessaires pour pouvoir quitter la France. Pour atteindre notre but — l'Angleterre, l'Afrique du Sud ou, éventuellement, les Indes néerlandaises— il nous fallait traverser de nombreux pays. Obtenir le visa indispensable ou le cachet voulu, était affreusement difficile. Chaque fois que les choses étaient enfin réglées pour un pays, l'autorisation pour un autre venait d'expirer.
Nous sommes tout de même parvenus à quitter la France. Nous pouvions nous rendre au Portugal, via l'Espagne. J'étais contente de ne pas devoir rester Madrid. Les voitures de police et les hommes en uniforme m'y terrorisaient. Mais j'aimais Praia das Maças, à quelque distance de Lisbonne. J'y avais retrouvé une petite amie connue à la patinoire de Bruxelles. Nous allions nager ensemble. Le temps passé sur cette plage ressemblait à celui des grandes vacances vécues â Ostende, en Belgique. Sans soucis. Hélas, il nous fallait quitter le Portugal.
Nous n'avions qu'un visa de transit.
Des Noirs
Nous avons pris un bateau pour le Mozambique. Mais nous ne pouvions le quitter pendant les escales. Nous étions des réfugiés et les réfugiés ne débarquent pas.
Sur le quai du port de Luanda, en Angola, je vis un Noir battu à mort par un Européen. Curieusement, le Noir ne rendait pas les coups. Il demandait pardon. Je n'avais encore jamais vu un adulte frappé par un autre adulte rester sans se défendre.
Et personne n'intervenait.
Pour le Mozambique, nous ne disposions que d'un visa de transit. Nous ne pouvions guère nous attarder.
Lourenço Marques. Comme j'aurais aimé y vivre, à condition que ce ne fût pas dans la pension où nous demeurions pendant la journée, mais dans la maison où nous dormions, la nuit, à quatre dans une chambre, à même le sol. Je détestais la patronne de la pension. Je ne pouvais pas la voir en peinture. Tous les matins, elle souhaitait la bienvenue au personnel avec un fouet. Tous les matins, la même cérémonie. Pourquoi frappait-elle? Pourquoi mes parents restaient-ils sans protester? Ils me remirent à ma place. Je devais apprendre à me taire. Je devais comprendre que des réfugiés n'ont pas le droit de parler. Dans un silence lourd de révolte, j'expédiai la patronne en enfer.
Quand elle s'absentait, je jouais dans le jardin avec le portier, un nain, un nain à la peau noire. Il m'apprit
reconnaître les insectes. C'est lui qui recevait le plus de coups. N'est-il pas encore plus facile de frapper un nain, et, par ses fonctions même, ce nain n'était-il pas toujours à portée de main?
Il devint mon ami. Il était vieux. J'étais impuissante.
Blanc, mais pas riche
Nous avons pris un train pour l'Afrique du Sud quelques jours après que mon père et moi eûmes fêté Yom Kippour (le grand pardon) à la synagogue de Lourenço Marques. J'étais très contente, très fière. Il m'avait appris ce que je devrais dire aux gens avec qui nous resterions bavarder, après la cérémonie. Je ne comprenais pas bien ce que je disais, mais cela ne m'empêcha nullement de lancer à tous un joyeux 'gut yomtev'.
Pour l'Afrique du Sud également, nous n'avions qu'un visa de transit. Néanmoins, mes parents espéraient pouvoir s'y fixer. Quelques réfugiés n'étaient-ils pas parvenus à obtenir un permis de résidence? Mais nous, nous n'y réussîmes pas. Aucune de nos tentatives à. Pretoria, Johannesburg, Durban ne fut couronnée de succès. Nous étions juifs, des juifs hollandais, des juifs pauvres. Bon gré, mal gré, il nous fallait prendre un bateau pour les Indes néerlandaises. Les hollandais étaient les bienvenus dans ce pays!
Nous partîmes donc pour cette terre promise.
Nous allions à Batavia. Mon père y trouverait du travail, nous pourrions de nouveau vivre normalement, dans une maison, nous quatre, comme avant. Avant: la paix. Plus de guerres, plus d'angoisses, plus de poursuite, plus de lâcheté, plus de tourments.
Batavia résonnait comme une musique dans les oreilles.
Batavia
8 Novembre 1941. Nous atteignons les Indes néerlandaises, la terre promise. Indemnes. Tous les quatre.
Le voyage Bruxelles-Batavia avait duré 547 jours. Un an, cinq mois et vingt-neuf jours. Nous étions à Batavia. Nous étions libres.
Du bateau on nous conduisit tout droit dans un camp situé à quelques kilomètres de la capitale. Motif: parmi ces Hollandais fugitifs venus d'Europe se trouvaient peut-être des espions, des traîtres, de la racaille. Il fallait un certain laps de temps pour examiner cela de plus près.
Nous nous retrouvions donc réfugiés, et considérés comme tels. Nous n'habitions pas dans une maison. Nous ne vivions pas normalement. Nous étions enfermés dans un camp. Nous logions ensemble dans une chambre minuscule. Nous n'étions pas libres.
Il régnait dans ce camp une ambiance pourrie. Tout le monde était abattu. Adultes et enfants, complètement désabusés. Chacun se sentait comme un ennemi potentiel des Pays-Bas et de ses Colonies.
Mes parents furent conduits à plusieurs reprises à Batavia pour des interrogatoires de police. Ma sœur et, moi fûmes également entendues. Une fois. À tour de rôle. On appela d'abord mon père ensuite ma mère, enfin ma sœur. J'étais la plus jeune, je fus questionnée la dernière par un officier de police qui me fit expliquer qui j'étais. On nous déclara bons pour être libérés.
Mon père n'avait pas de travail, nous n'avions plus d'argent. Pas d'argent, pas de logement.
Des hollandais charitables hébergeaient des réfugiés dans leur maison (avec un certificat de bonne conduite délivré par la police!). Nous nous trouvions sur une liste d'attente.
Après quelques jours passés encore au camp, nous obtînmes enfin un abri. Mes parents furent logés chez la famille S., ma sœur et moi fûmes poussées dans un taxi et déposées dans une école Berlitz. Le couple qui devait se charger de nous, était occupé donner cours quand on nous débarqua. Pour l'attendre, on nous fit prendre place sur un banc, dans le couloir, et nous reçûmes un grand verre de sirop, avec une paille.
(...) Élèves et professeurs vinrent à tour de rôle jeter un coup d'œil sur 'les petites réfugiées' qui venaient d'Europe. Je me sentais très malheureuse. J'avais l'impression d'être un petit singe en cage. Pour la première fois de ma vie, je me réjouis d'avoir une sœur, de n'être pas tout à fait seule au monde. Pour la première fois aussi, j'avais un vrai chagrin. Un chagrin sans larmes.
#