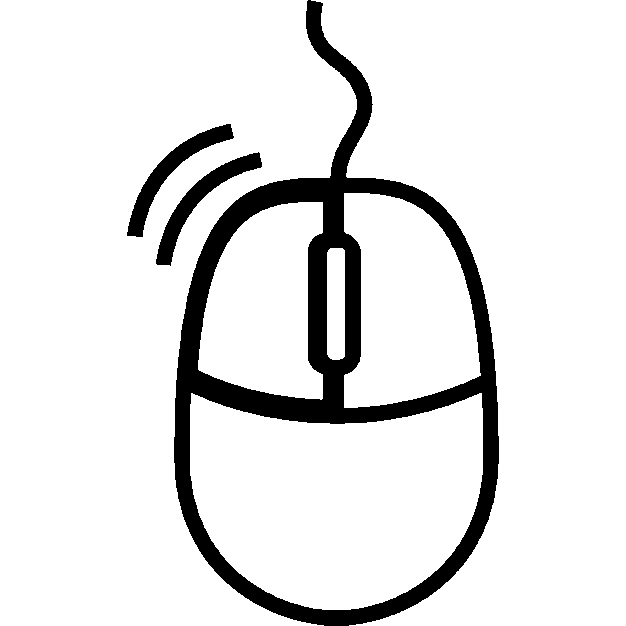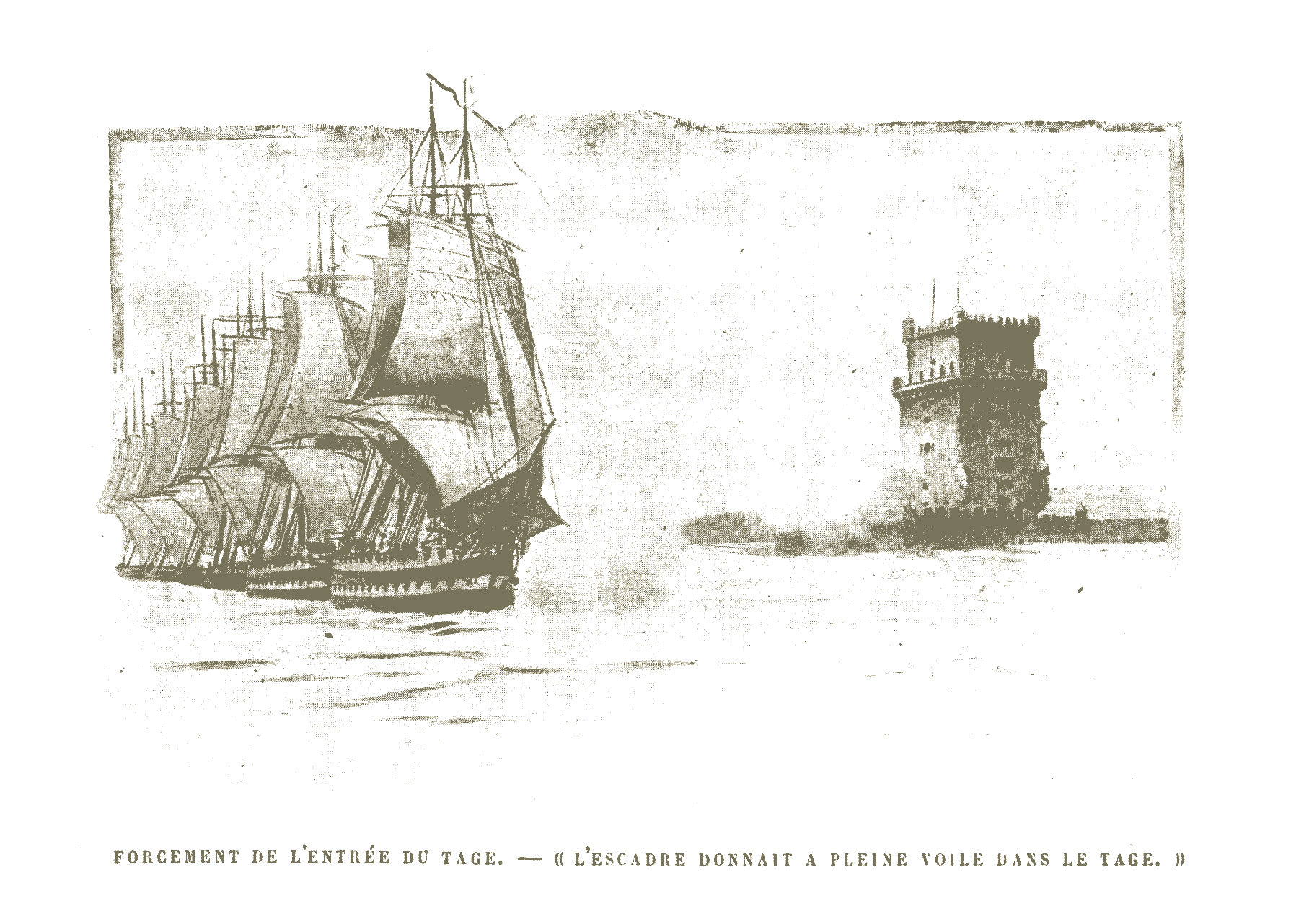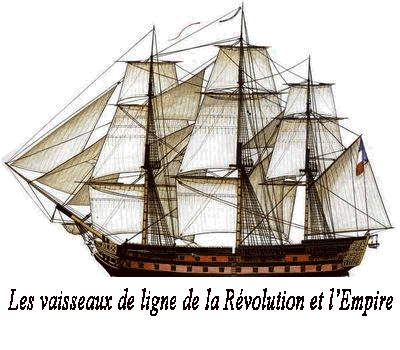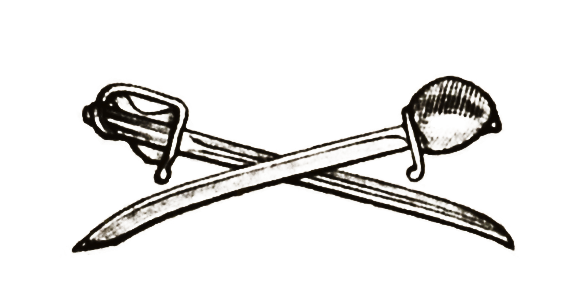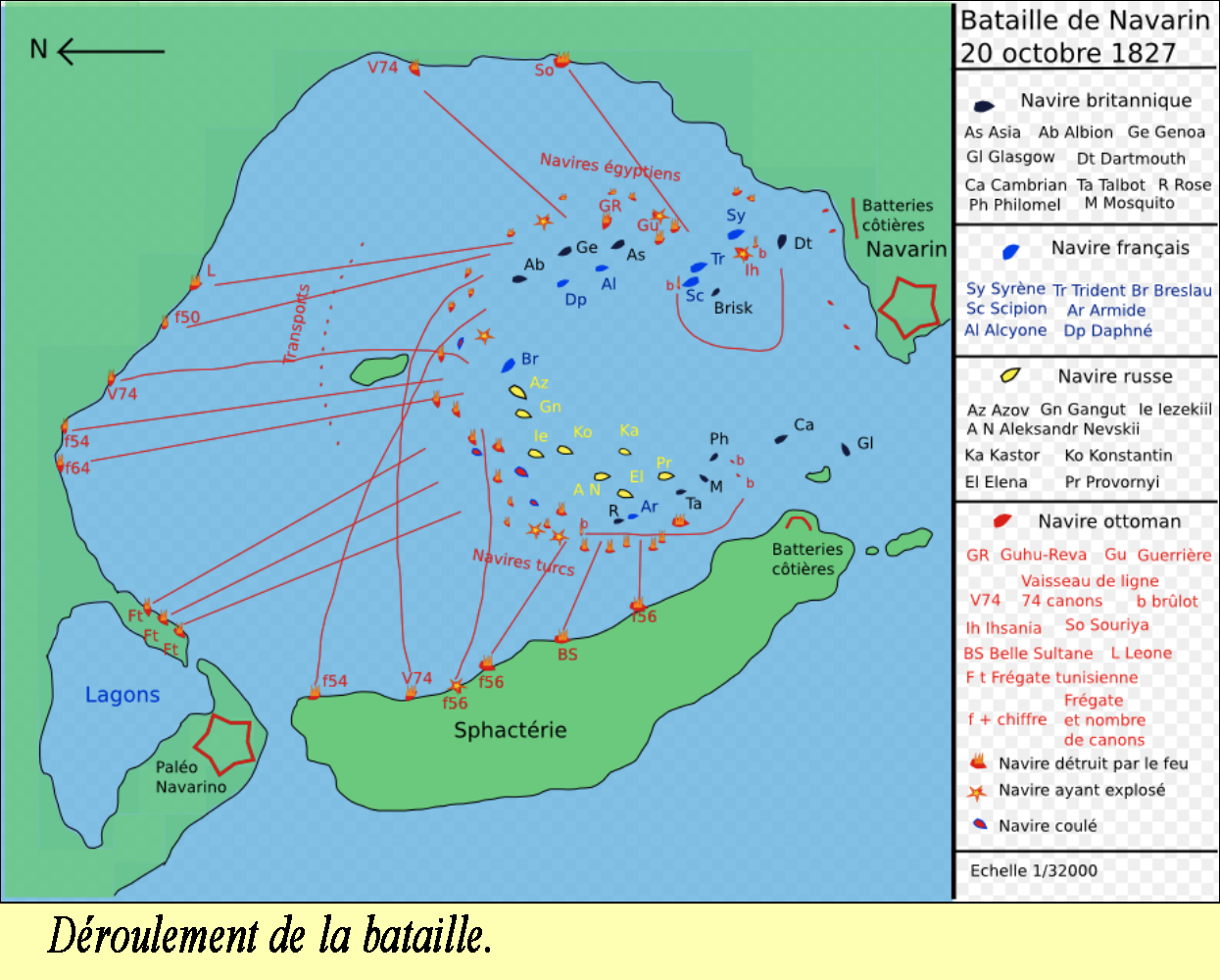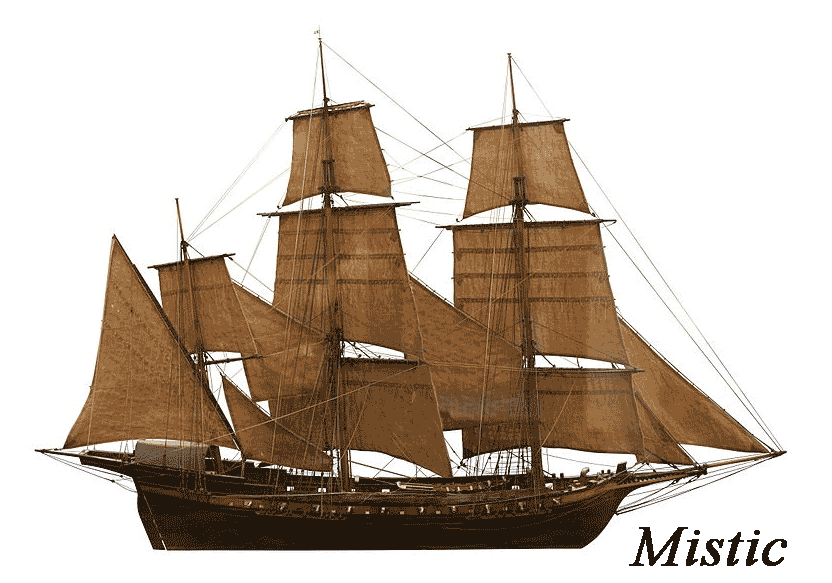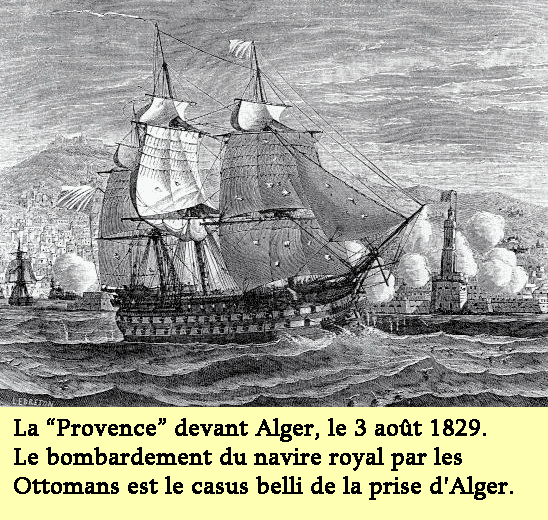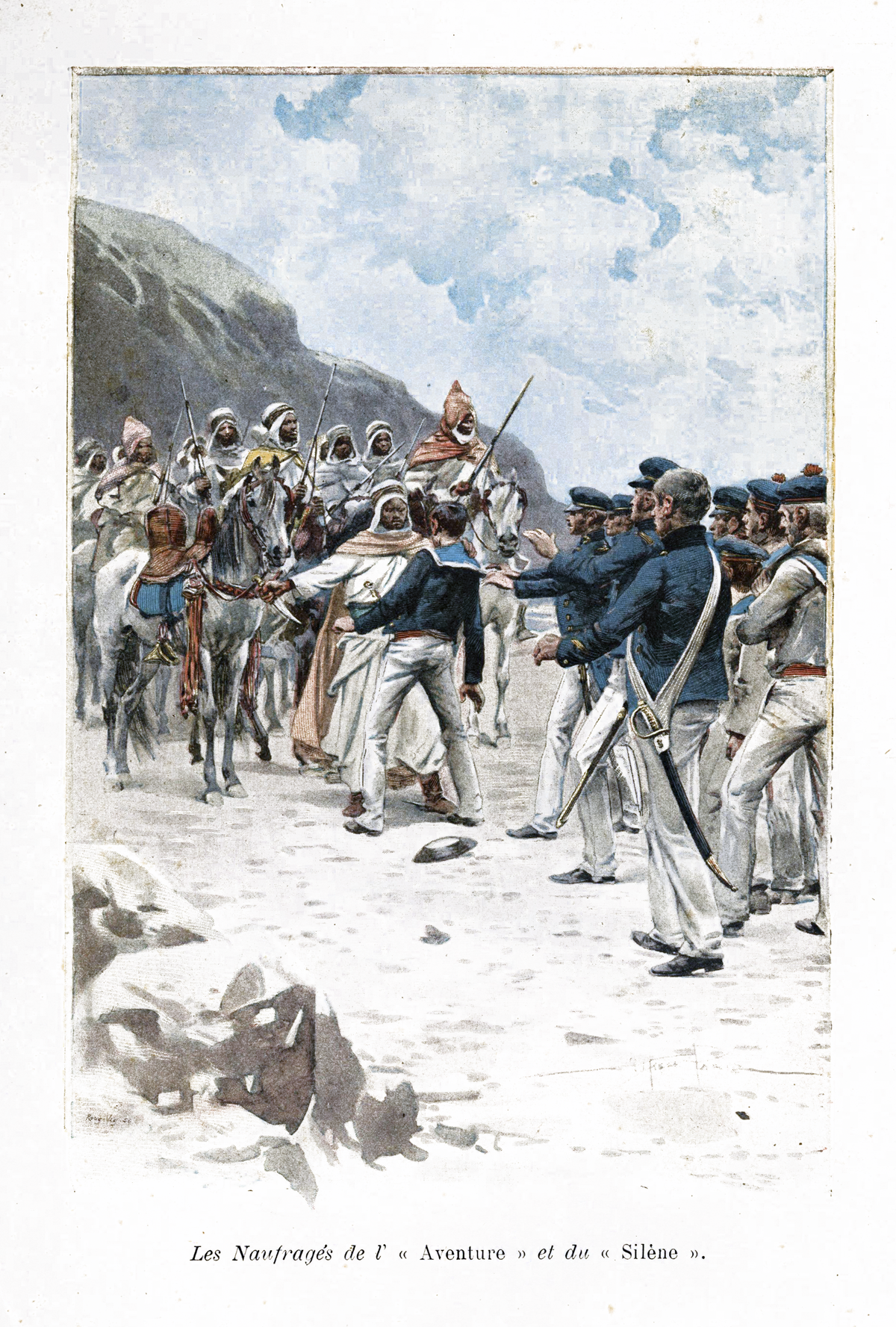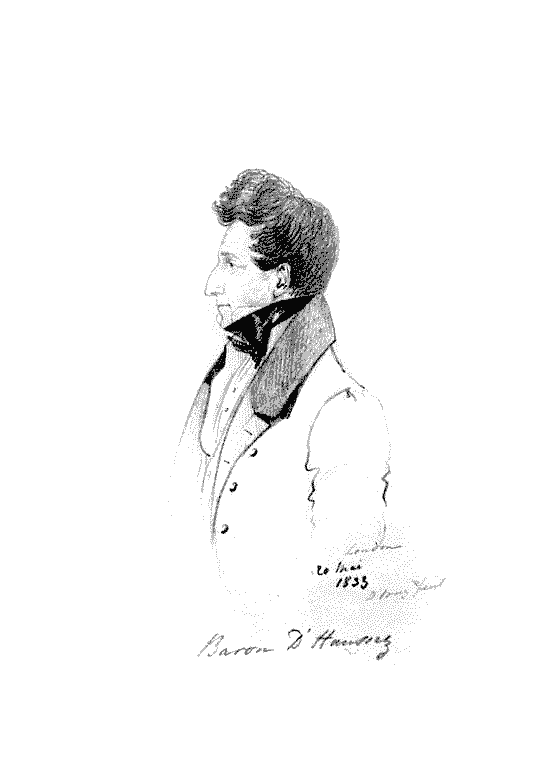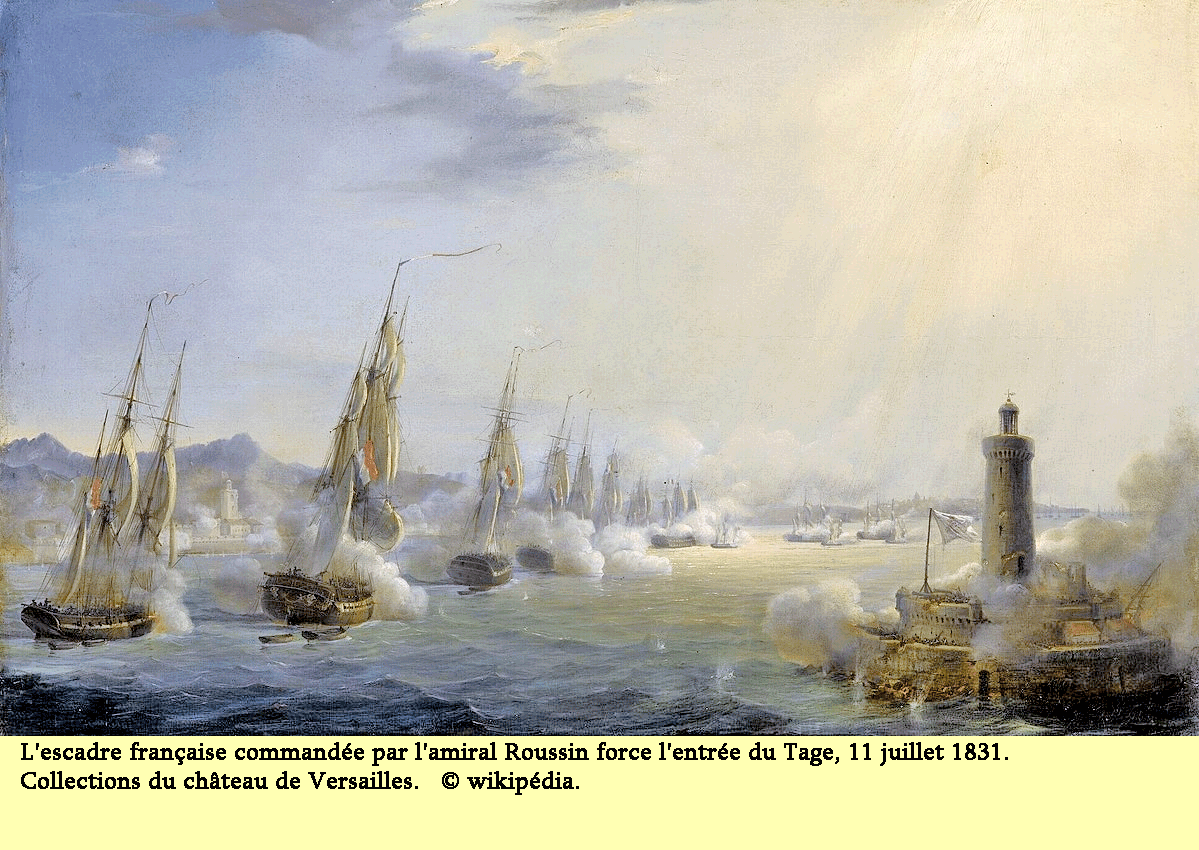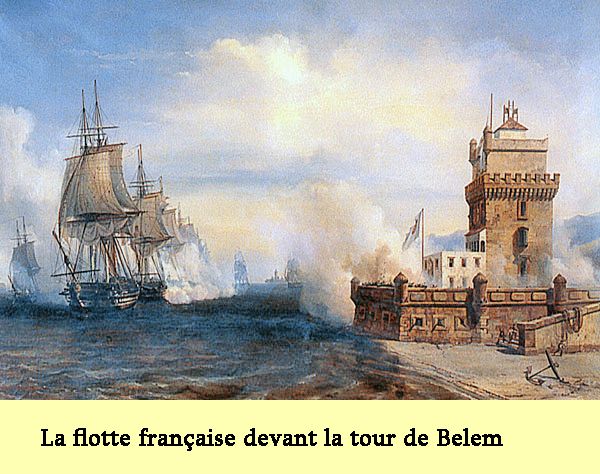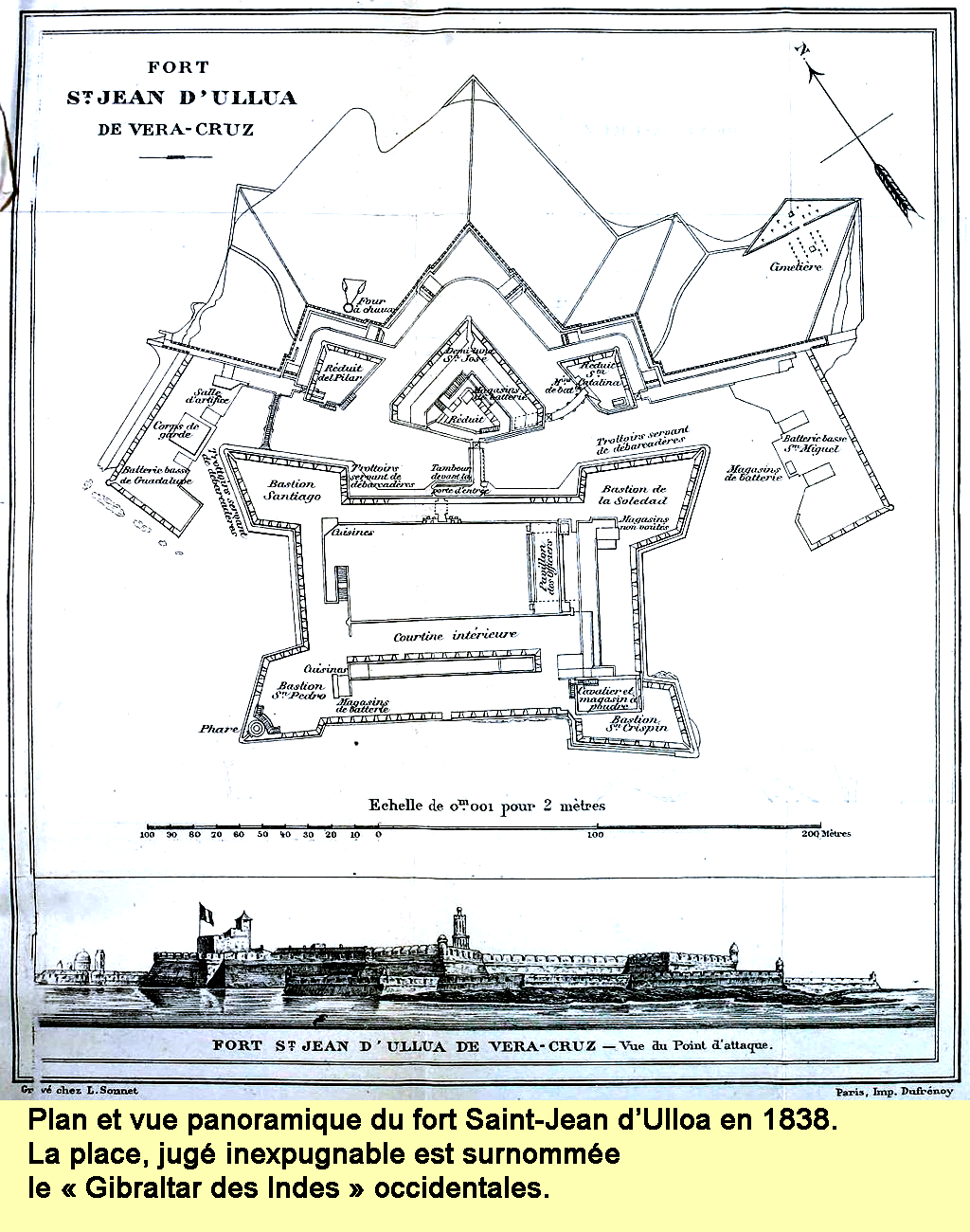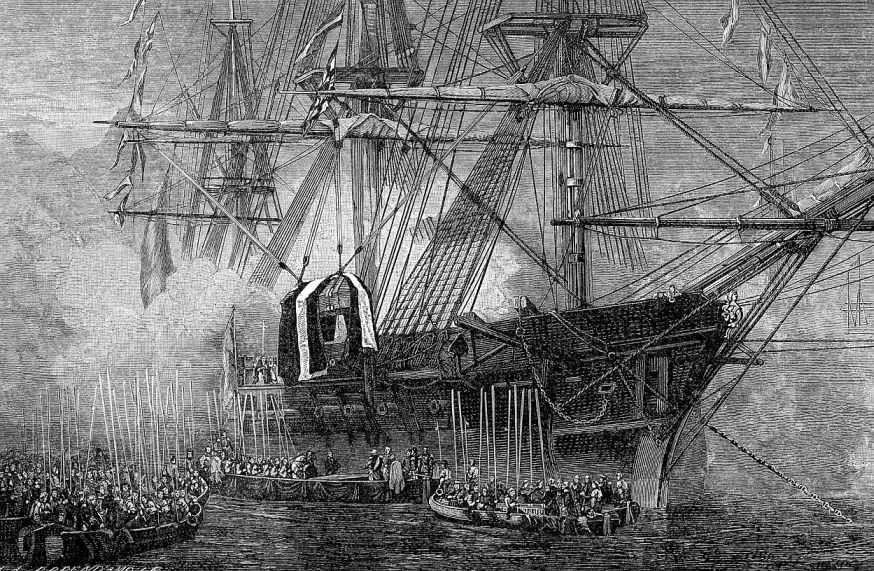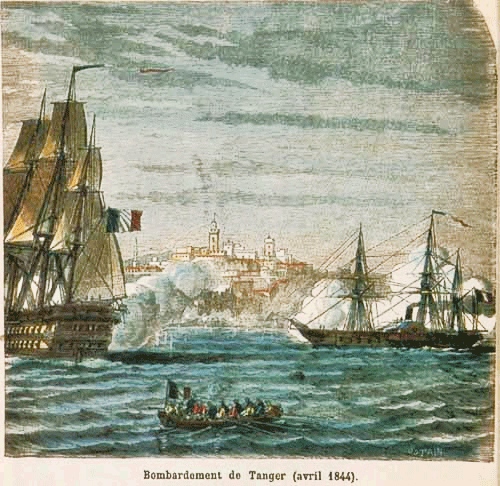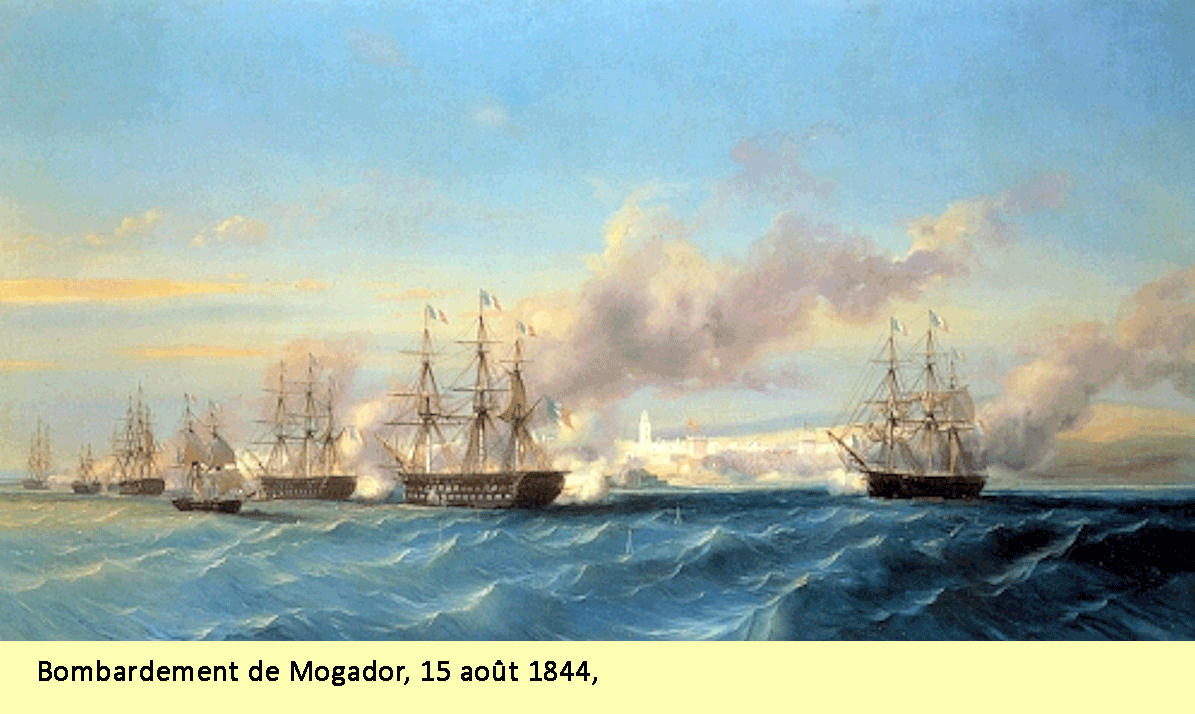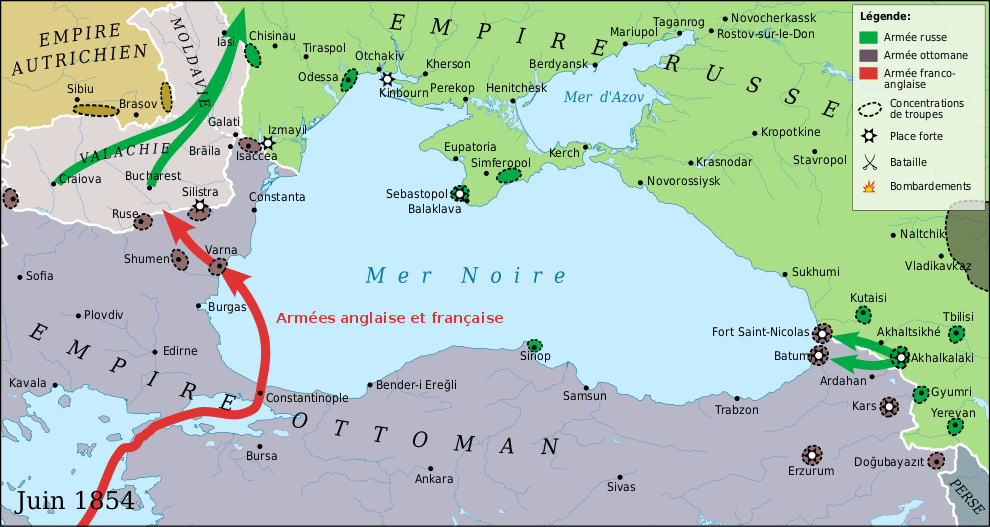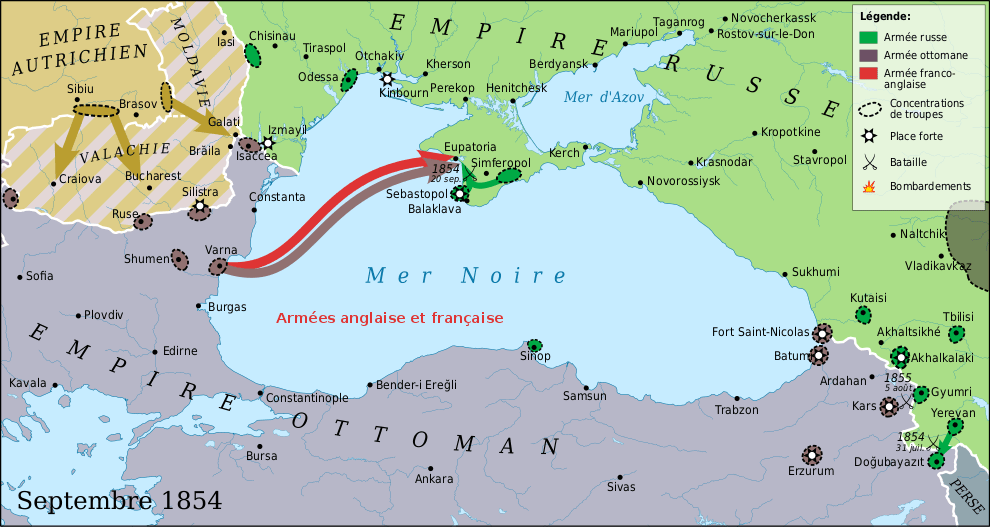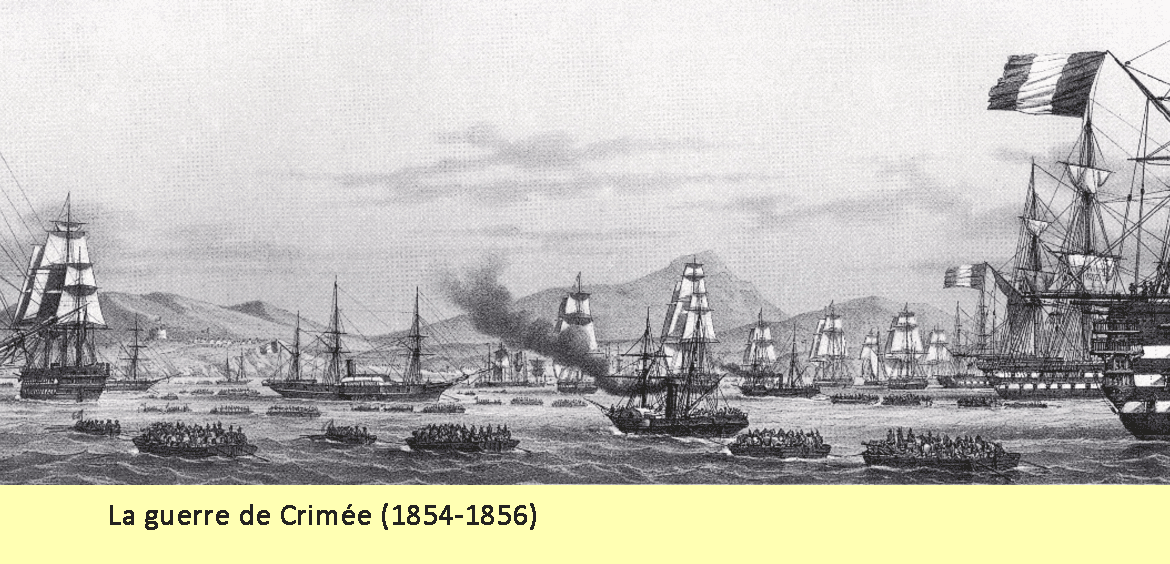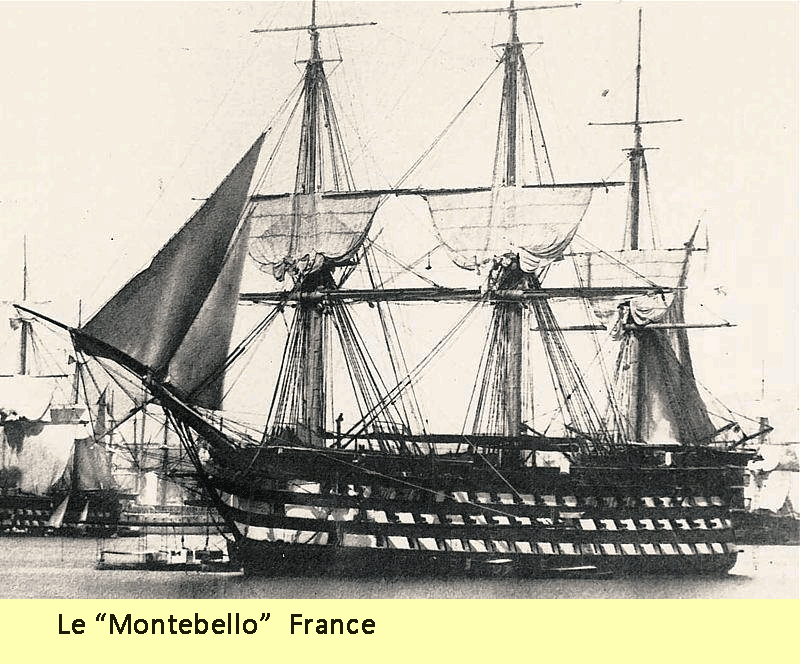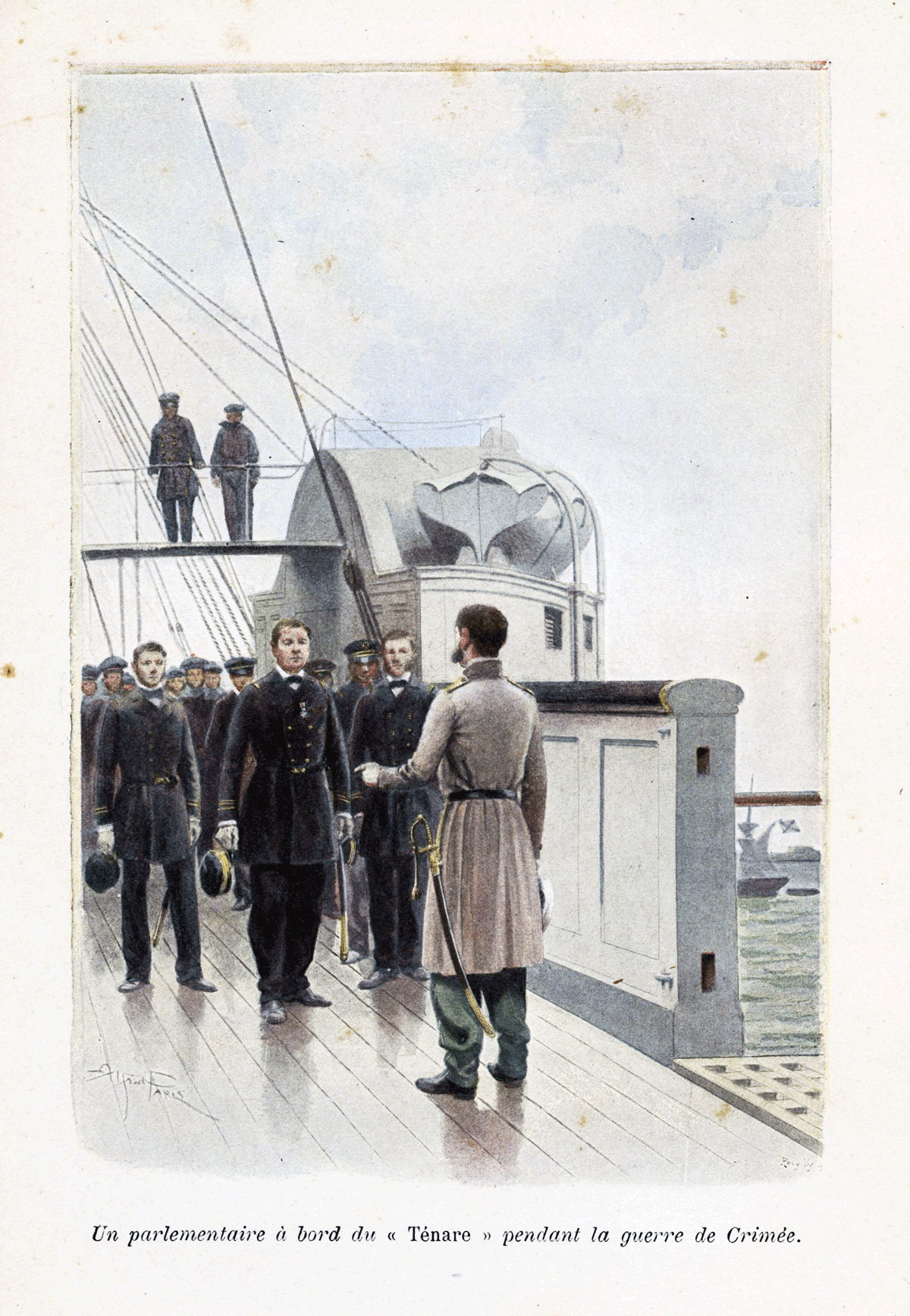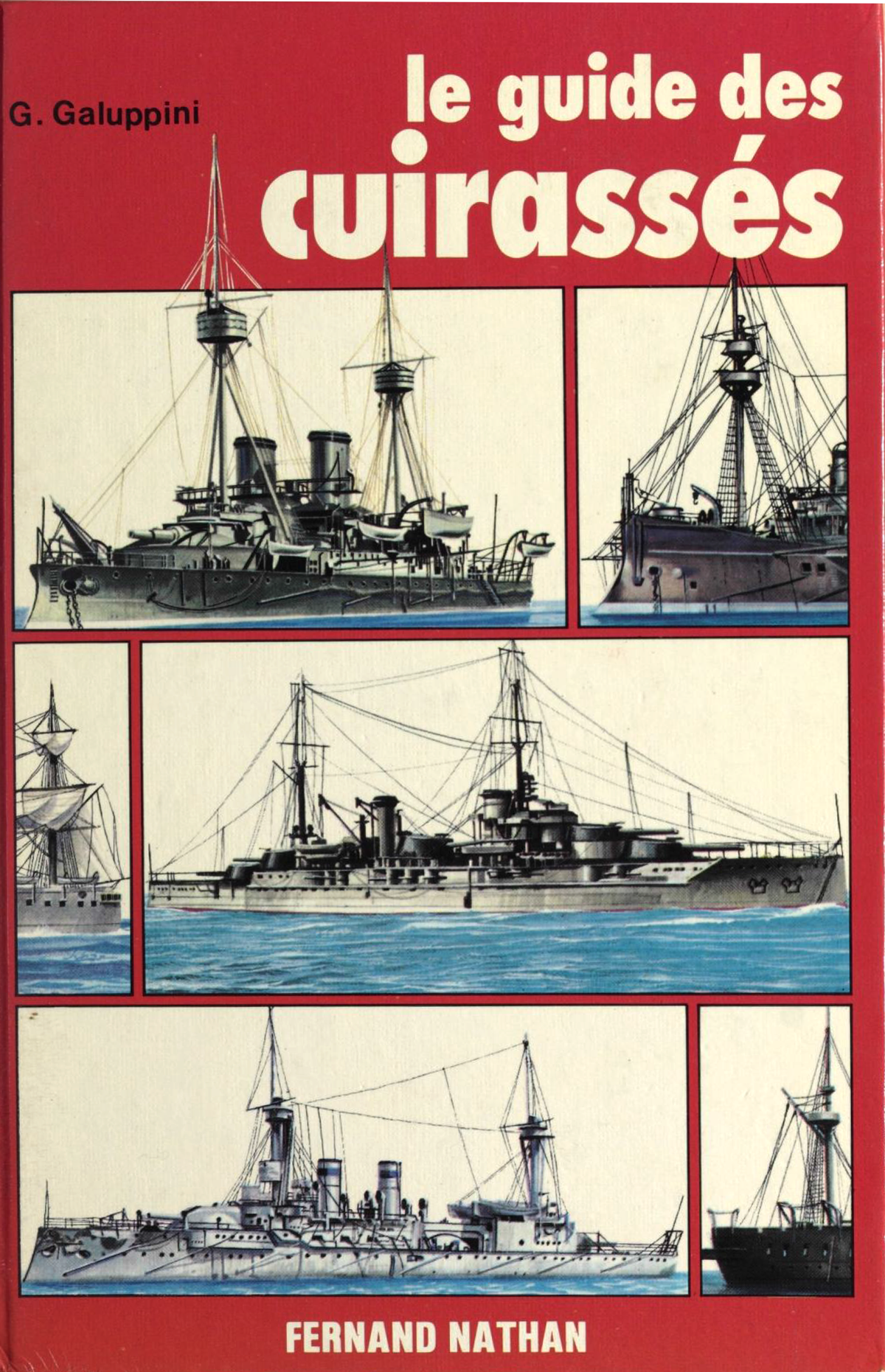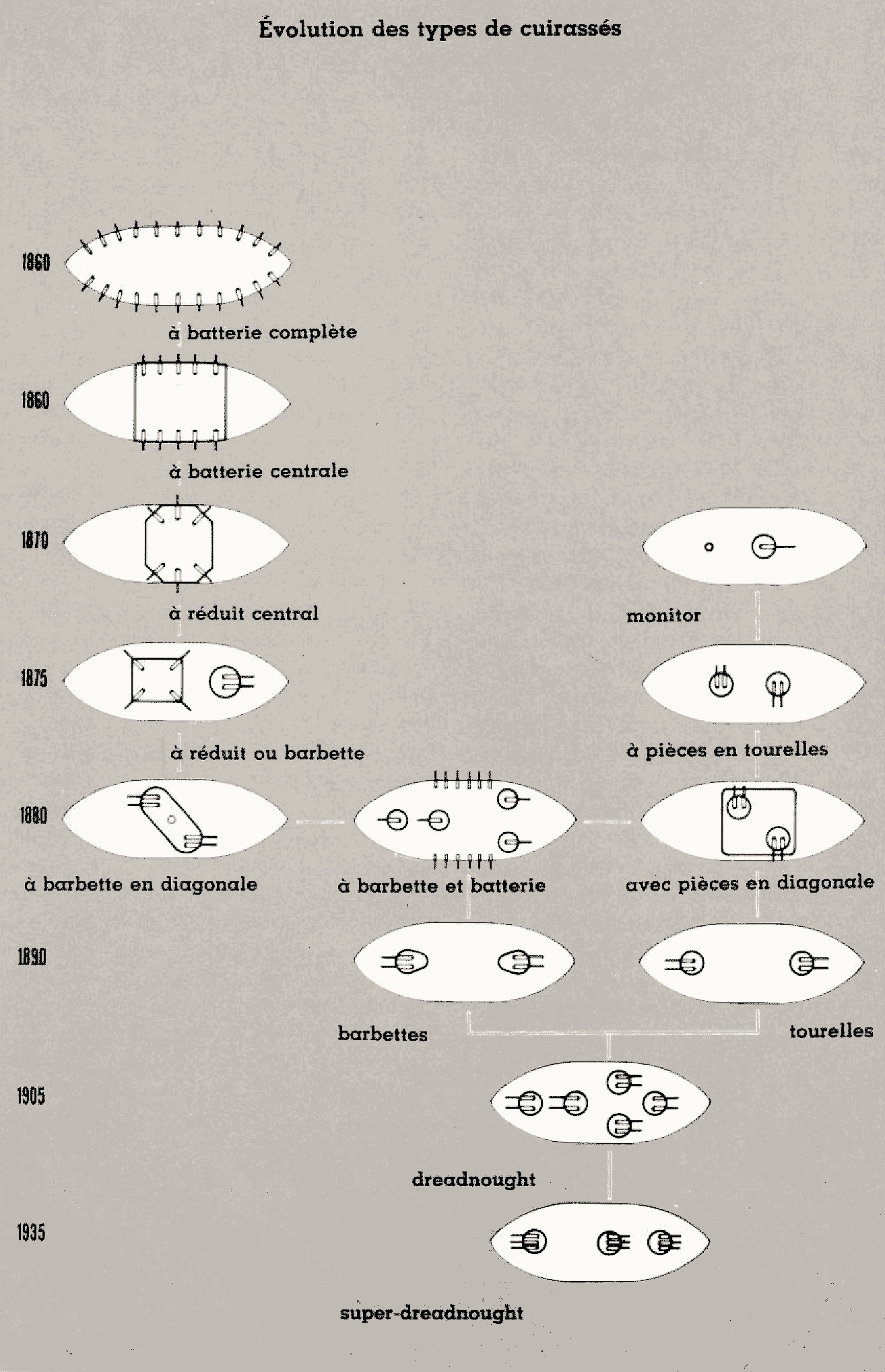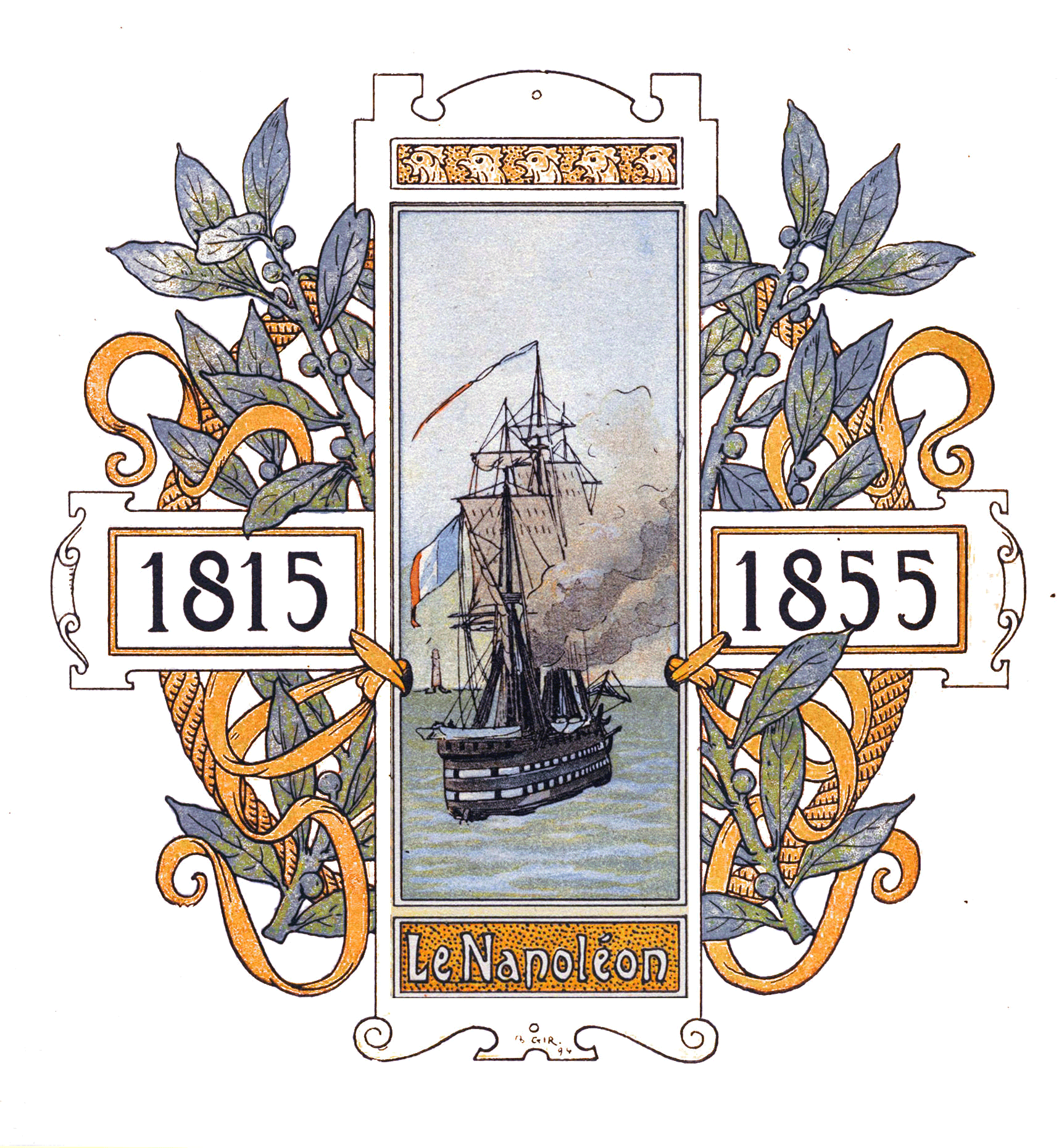
Gloires et Souvenirs Maritimes
1815 - 1855
Prise du fort de Santi Petri
(1823)
Louis XVIII se fit désigner par le Congrès de Vérone pour rétablir Ferdinand VII, renversé par ses propres sujets. Ce prince avait été conduit à Cadix par les Cortés. Pour réduire cette place, il fallut que l'escadre de l'amiral Duperré en fasse le siège. Cadix se rendit après huit jours de résistance.
CE matin au point du jour, les vents étant à l'est, j'ai donné ordre aux vaisseaux le Centaure et le Trident et à la frégate la Guerrière d'appareiller, mon dessein étant d'attaquer le fort de Santi Petri.
À sept heures la division était sous voiles. Mon projet était de passer à terre du banc de rochers nommé le Juan Bella. En conséquence, je donnai ordre à la corvette l'Isis, commandée par M. Boniface, capitaine de vaisseau, que vous m'aviez envoyée dans la nuit et que j'avais retenue, de prendre la tête de la ligne et de sonder devant elle, à distance, afin de pouvoir me signaler le fond. La division s'approcha ainsi de la terre au nord de Santi Petri, en louvoyant sous les huniers.
À midi je fus rallié par la goélette le Santo Cristo, commandée par M. Trotel, lieutenant de vaisseau.
À une heure un quart, je fis hisser le signal dont j'étais convenu avec nos batteries pour qu'elles commençassent leur feu, ce qui fut fait avec une extrême vigueur. Parvenu à la distance à laquelle je voulais être, et relevant le fort de Santi Petri dans le sud-est, je donnai ordre à M. Ponée, commandant le Centaure, de prendre position à ce point et de s'embosser; ce qui fut exécuté avec habileté, malgré la force du vent qui fraîchissait en ce moment, et celle des courants, qui prenaient le vaisseau par la hanche de bâbord ; les voiles serrées avec autant d'ordre que de célérité, je fis signal de commencer le feu, auquel le fort répondit par le petit nombre de pièces qu'il avait dans cette partie.
Pendant ce temps le Trident s'avançait : il vint mouiller derrière le Centaure, et commença le feu aussitôt qu'il fut embossé, recevant avec le Centaure celui d'une batterie de l'île de Léon et d'une batterie de Santi Petri, qui tiraient également sur la goélette le Santo Cristo, qui n'en était qu'à un quart de portée.
Il était trois heures. Le Centaure combattait depuis une heure un quart ; le fort de Santi Petri ne ripostait plus qu'à de longs intervalles : je jugeai que le moment d'en tenter l'assaut était venu. Je fis signal à la division d'embarquer les troupes dans les chaloupes et de les diriger sur le Centaure. Ce mouvement se fit avec toute la célérité que je pouvais désirer, et je n'attendais plus que le moment où le Trident et la Guerrière auraient commencé leur feu pour ordonner le débarquement, quand à trois heures et demie le fort arbora un pavillon blanc, qui fut à l'instant salué de mille cris de « Vive le roi! »
Je fis pousser sur-le-champ les chaloupes au large, ayant à bord quatre cent vingt hommes des 12e et 24e de ligne et un détachement de grenadiers de l'artillerie de marine. Arrivés au pied du rocher sur lequel le fort est construit, M. Tétiot, capitaine de frégate commandant le débarquement, m'expédia un parlementaire, officier espagnol, qui me proposa pour capitulation que la garnison du fort fût libre de se retirer dans l'île de Léon sous ses drapeaux respectifs, pour continuer d'y servir contre l'armée française. Je ne voulus pas souscrire à cette condition et je lui donnai pour ultimatum que la garnison prendrait l'engagement de ne pas servir contre la France pendant toute cette guerre.
Ces conditions, consenties par le commandant du fort, allaient être remplies ; mais la crainte que les Espagnols avaient de rentrer dans l'île de Léon les détermina ensuite à se constituer prisonniers, et nos troupes prirent à l'instant possession du fort sous le commandement de M. Louftaud, chef de bataillon dans le 12e. Les Espagnols y avaient vingt-sept pièces de canon de 24 en bronze, cent quatre-vingts hommes de garnison, des munitions nombreuses et deux mois de vivres. Ils ont eu treize hommes tués ou blessés.
Je connaissais trop l'importance de la position de Santi Petri pour ne pas profiter à l'heure même du succès que je venais d'obtenir. J'ai fait armer aussitôt un canot par bâtiment pour intercepter les bateaux qui, en entrant par la rivière de ce nom, ravitaillaient Cadix malgré la surveillance la plus active de nos croiseurs, et déjà j'entends le canon du fort tirer sur ces bateaux; son feu, joint à celui de la batterie que nous avons en face, ôte sans retour à Cadix ce moyen de ravitaillement à peu près unique.
Je ne terminerai point ce rapport général sans payer à l'état-major, aux matelots, aux soldats du Centaure le tribut d'éloges qu'ils ont si bien mérité. Tous ont montré un enthousiasme que rien ne peut exprimer.
AMIRAL DES ROTOURS.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Navarin
Combat de Navarin
(20 OCTOBRE 1827)
La Russie, l'Angleterre et la France firent cause commune pour soutenir la Grèce révoltée contre l'oppression turque. La médiation de ces trois puissances ayant été repoussée, on résolut de recourir à la force. Les escadres combinées attaquèrent dans la baie de Navarin la flotte turco-égyptienne.
Rade de Navarin, le 21 octobre 1827.
VICTOIRE et santé, mon cher papa, voilà deux mots qui vont résonner bien agréablement quand vous apprendrez le combat terrible qu'ont livré hier les puissances alliées contre la flotte turque.
Le résultat est que la marine turque est anéantie. Cinq frégates ont brûlé et sauté pendant le combat, et pendant la nuit on a entendu beaucoup d'explosions ; en un mot, de dix-huit frégates et de trois vaisseaux, il ne reste plus aux Turcs qu'un vieux vaisseau qui n'a pas donné, deux frégates et un assez bon nombre de corvettes ou bricks dont on va sans doute s'emparer aussi. Nous n'avons pas anéanti tout cela sans recevoir de boulets, aussi les amiraux français ou anglais sont-ils presque entièrement désemparés; plusieurs vaisseaux et autres bâtiments ont été fort maltraités; on compte à bord de la Sirène une quarantaine d'hommes hors de combat; mais moi je ne m'y trouvais pas, car j'étais dans un canot et sur une goélette pendant toute l'affaire, qui a commencé à une heure et demie et n'a cessé qu'à la nuit. Voici à peu près ce qui s'est passé et ce qui a déterminé le combat.
Depuis plusieurs jours les escadres réunies croisaient devant Navarin, où était renfermée la flotte turque au nombre de quatre-vingt-dix bâtiments, dont trois vaisseaux, dix-huit frégates et le reste corvettes et bricks. Le gouvernement turc ne se décidait pas promptement, à ce qu'il paraît, sur les arrangements qui lui sont proposés par les puissances. Nous autres, nous commencions à avoir besoin de prendre nos quartiers d'hiver, vu le mauvais temps. En conséquence, on envoya une frégate à Navarin pour engager les flottes à retourner à Alexandrie et à Constantinople.
Cette frégate vit que l'armée était embossée en demi-cercle et que six brûlots se trouvaient à l'entrée du port.
L'amiral anglais, qui commande ici, décida aussitôt qu'on devait entrer à Navarin en amis ou en ennemis par le premier bon vent; ce ne fut cependant que le surlendemain que le vent permit d'entrer.
L'ordre de bataille était celui-ci.
L'amiral et les trois vaisseaux français attaquaient à droite l'aile gauche de l'armée, composée principalement d'un vaisseau et de cinq frégates du premier rang. L'amiral anglais avec ses vaisseaux devait attaquer le centre, les Russes l'aile droite, et enfin les frégates devaient avoir affaire à une foule de corvettes et de bricks. Une frégate anglaise et les bricks eurent pour leur part les brûlots.
Le 20 à midi, l'escadre alliée fut réunie à une lieue du port et l'amiral anglais entra en tête sans aucune résistance. La division française le suivit en partie aussi, avant que les forts se missent à tirer. La frégate anglaise chargée des brûlots s'embossa devant l'un d'eux et envoya deux embarcations pour s'en assurer; mais à peine furent-elles arrivées que les Anglais en montant à bord furent culbutés de toutes parts par les gardiens des brûlots; ils y perdirent un officier et une quinzaine d'hommes. Alors commença une fusillade très vive entre le brûlot et la frégate anglaise, et c'est ce qui détermina l'affaire.
Pour moi, avant d'entrer, l'amiral m'avait expédié dans un canot avec douze hommes à bord de la goélette la Daphné, afin d'aller aux ordres du capitaine accrocher quelques brûlots et les écarter ainsi des bâtiments.
Nous entrions avec deux vaisseaux français, lorsque le feu commença par la Sirène, qui tira à boulets sur le brûlot; aussitôt les forts nous envoyèrent des boulets qui désemparèrent en partie la goélette ; nous arrivâmes cependant bientôt près d'un brûlot auquel le feu se trouvait, et le capitaine m'envoya pour le séparer.
Je partis, et à peine étais-je à dix pas de la goélette qu'un boulet frappa l'avant du canot et m'enleva deux hommes, et qu'un autre vint enlever le chapeau de mon patron; nous excitâmes cependant nos canotiers et nous fûmes au brûlot; mais la goélette se trouva ensuite engagée et il fallut la remorquer à son tour, puis les boulets coupèrent notre amarre et il fallut cesser; nous retournâmes donc à bord de la goélette, qui se trouva mouillée définitivement au point d'entrecroisement de tous les feux, de sorte que ses six pièces de canon furent bientôt hors d'état de servir; le capitaine ne pouvant plus rien faire et les hommes tombants, le capitaine les fit coucher à plat ventre et nous attendîmes tranquillement là l'issue du combat ; les boulets pleuvaient comme grêle, leur sifflement fut continuel pendant quatre heures.
Nous eûmes le gouvernail emporté, les deux mâts cassés, les voiles criblées, des boulets à fleur d'eau qui forcèrent à faire jouer les pompes; je perdis encore deux de mes hommes, mais il fallait qu'il en partît.
Cependant nous étions supérieurement placés pour tout voir; la Sirène, qui m'intéressait, fut prise entre trois feux et s'en débarrassa à merveille, jamais feu ne fut mieux fourni, et bientôt ses adversaires furent anéantis par le Trident, dont elle reçut aussi des boulets, car dans ce brouhaha la fumée empêchait souvent de rien voir; on reçut beaucoup de boulets amis; en un mot elle coula une frégate, et une autre sauta près d'elle; elle fut assez maltraitée : quarante hommes hors de combat.
Le vaisseau-amiral anglais était aux prises avec deux frégates et un vaisseau turc qui s'est battu avec la plus grande opiniâtreté et qui, quoique tend ensuite entre deux feux des plus meurtriers, n'a pas amené pavillon; la nuit seule l'a caché aux yeux. D'abord un petit nombre de bâtiments a soutenu le choc de toute l'escadre turque, car les Russes, qui devaient arriver les derniers, étaient vivement occupés avec le fort de l'entrée; enfin ils se sont avancés et ont soutenu un très beau feu; l'amiral russe a pris d'abord une mauvaise position, mais le vaisseau français Breslau, qui était resté sans voiles, est venu prendre deux frégates qui filaient le russe, et dans trois bordées par division il a mis hors de combat deux frégates de soixante canons; les conscrits qu'il avait à bord se sont battus comme des lions et en vrais vétérans; le commandant du Breslau, M. de la Bretonnière, et les Français par conséquent, ont reçu un éloge bien flatteur de l'amiral russe devant le commandant du vaisseau-amiral anglais. M. Le Roy, aide de camp de notre amiral, fut ce matin voir l'amiral russe, qui lui dit en le voyant : « Quel est le brave capitaine français qui commande le Breslau? » M. Le Roy l'a nommé : « Eh bien, mon cher, a-t-il dit, vous le verrez avant moi, embrassez-le de ma part, car son noble dévouement et le beau feu de sa batterie m'ont épargné beaucoup de sang ».
La frégate française l'Armide s'est aussi bien montrée; sur l'aile droite, elle a combattu seule contre quatre frégates, elle a fait amener et a amariné une frégate de premier rang et a fait fuir les autres.
Du reste, chacun a fait son devoir; et dans ce combat mémorable, cette espèce de haine nationale entre les Français et les Anglais a été mise de côté : les trois peuples différents ont combattu en frères.
Le feu a cessé à la nuit; alors quatre frégates turques avaient sauté ; j'arrive cependant sur la Sirène et j'ai la douleur d'apprendre que sur tout l'état-major un élève, le meilleur garçon sans contredit, avait eu la tête percée d'un biscaïen. Nous avons perdu aussi le drogman de l'amiral, un bien brave camarade.
Pendant toute la nuit, d'heure en heure, l'explosion des bâtiments avait lieu ; c'était la plus belle horreur que l'on puisse voir.
Je vous écris le 21 à sept heures du soir; à peu près trente bâtiments turcs ont sauté; ils sont résolus à brûler ainsi toute leur flotte; nous sommes heureux si le vent ne vient pas du fond du golfe avant que tout soit expédié, car les Turcs enverraient sur nous tous ces brasiers qui pourraient nous faire beaucoup de mal.
Adieu, mon cher papa, sachez que tous les 30 du mois il part de Toulon un bâtiment de guerre pour le Levant, afin d'escorter les convois qui se présentent ; ainsi en m'écrivant le 15 je pourrai recevoir de vos nouvelles tous les mois; n'oubliez pas ceci, car je vous reprocherais de la négligence si vous ne m'écriviez pas régulièrement.
Dieu et notre bonne Mère, qui m'ont préservé d'accidents dans cette circonstance critique, ne m'abandonneront pas, je l'espère, jusqu'à la fin de la campagne, et je pourrai alors vous embrasser. Quel jour de bonheur! Je n'ai que le temps de vous raconter mon affaire, et encore je le fais à trois fois différentes ; car nous sommes en remâtage, et les vergues, les canons, les cordages, les blessés nous encombrent partout.
Embrassez bien mes sœurs et mes amis. Je suis très content; le premier combat auquel j'aie assisté a eu pour dénouement la victoire, et un jour de victoire est toujours un jour de fête.
(Joseph Kerviler, Souvenirs d'un vieux Capitaine de frégate.)
(Champion, éditeur.)
Héroïsme de l'enseigne Bisson
(5 NOVEMBRE 1827)
Les navires français faisaient dans les mers du Levant une chasse active aux pirates. C'est dans l'une de ces courses qu'eut lieu l'événement suivant.
UN brick pirate, le Panayoti, venait d'être pris par la gabare la Lamproie, mais comme cette dernière avait un équipage peu nombreux, elle laissa sa prise à la frégate la Magicienne, qui se chargea de l'armer pour la conduire à Smyrne. Quinze hommes commandés par l'enseigne Bisson y furent embarqués, puis elle prit le brick à la remorque. Un assez fort coup de vent, qui surprit quelques jours après la frégate, la força de lâcher cette remorque, et, au lieu d'attendre et d'escorter la prise, elle l'abandonna et continua sa route. Le mauvais temps contraignit bientôt Bisson à s'arrêter à Stampalie, seul port qu'il avait sous le vent et qui était réputé pour servir de retraite aux forbans.
Dans la nuit un de ses prisonniers s'étant échappé, il ne douta plus qu'il allait être attaqué par les pirates quand ils apprendraient le petit nombre d'hommes qui formaient son équipage. Bisson rassemble alors ses matelots, les prépare à un combat à outrance, leur déclare son intention de ne pas se rendre à des bandits qui les assassineraient lorsqu'ils seraient tombés en leur pouvoir, et convient avec son pilote Trémentin que le dernier des deux qui survivrait ferait sauter le bâtiment, lorsque les Grecs en seraient possesseurs.
Ses prévisions se réalisèrent la nuit suivante. Deux mistics, montés par cent cinquante hommes, vinrent en l'attaquant par l'avant, à la faveur de l'obscurité, lui ôter la ressource qu'il pouvait tirer de quatre pièces de canon dont était armé le brick. Cependant, à la tête des siens, il opposa aux agresseurs la plus vigoureuse résistance et ce ne fut qu'en passant sur le corps de dix matelots français que les Grecs, après avoir perdu beaucoup de monde, furent maîtres du navire.
Bisson blessé, voyant que tout était perdu, ordonne aux cinq matelots qui lui restent de se jeter à la mer pour tâcher de gagner la côte à la nage. Quant à lui, armé d'un pistolet, il descend dans la chambre où se trouvaient plusieurs barils de poudre, en disant : Adieu, pilote, je vais tout finir.
De dessus le pont le pilote lui tient la main, et lorsque tous les Grecs furent montés à bord, au signal de Trémentin, il fait feu et saute avec son navire.
Le plus heureux hasard voulut que le pilote fût lancé à la mer, étourdi de sa chute, mais seulement avec un bras contusionné. Le froid rappela rapidement ses esprits, et sur un débris du bâtiment il parvint à gagner le rivage.
Les habitants de Stampalie, qui n'étaient pas tous complices dans cette affaire, recueillirent nos six braves. Quelques jours après on trouva sur la plage les corps de soixante-dix à quatre-vingts Grecs et les membres épars de l'intrépide mais trop malheureux Bissons. (1)
Le pilote Trémentin fut nommé enseigne de vaisseau le 9 mars 1828.
(1). La ville de Lorient, dont il était originaire, lui a élevé une statue.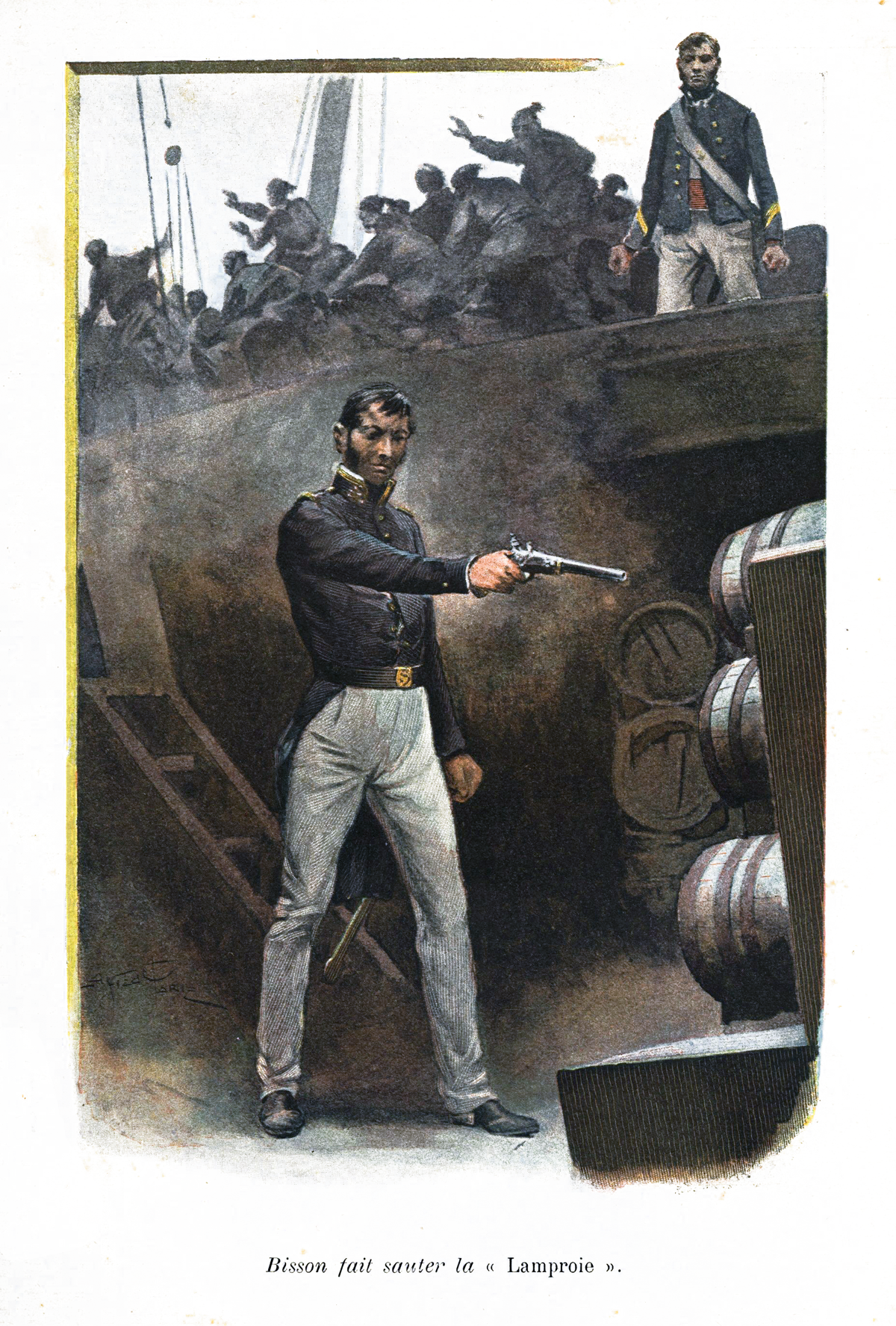
(J. Kerviler, Souvenirs d'un vieux Capitaine de frégate.)
(Champion, éditeur.)
Une insulte au pavillon parlementaire
Le blocus fut établi devant la régence d'Alger à la suite d'une insulte commise en 1827 par le dey sur la personne du consul de France. Voici l'épisode de ce blocus qui détermina l'expédition et la conquête de l'Algérie.
LE 17 juin 1829, une felouque avait été signalée sortant d'Alger et courant à l'est toutes voiles dehors : les deux frégates Iphigénie et Duchesse de Berry qui donnèrent aussitôt la chasse. Le corsaire s'étant jeté à la côte, trois embarcations de chacune des deux frégates furent envoyées pour le détruire. Le rivage était couvert de gens armés ; derrière eux on voyait des cavaliers s'agiter et de nouveaux groupes accourir.
Quand les embarcations furent à courte portée, elles ouvrirent, malgré la houle, un feu nourri et sûr qui eut bientôt balayé la plage ; mais tandis que nos marins incendiaient la felouque, l'un des canots de l' Iphigénie, enlevé par une lame énorme, s'échoua profondément dans le sable. À cette vue, les trois embarcations de la Duchesse de Berry se portèrent vivement à terre afin d'assister l'équipage en péril. De toutes parts les Arabes avaient reparu; ils s'enfuirent de nouveau après une lutte violente et sanglante.
En ce moment la force des lames était telle qu'une seule des quatre embarcations put être renflouée ; il fallut abandonner les trois autres ; mais avant qu'il eût été possible de pousser au large, les assaillants étaient revenus pour la troisième fois.
L'unique embarcation, déjà trop chargée, ne pouvait contenir tout le monde. Il y eut dans cette crise des actes sublimes.
Vingt-cinq officiers et marins se dévouèrent pour le salut de leurs camarades; vingt-quatre périrent ; leurs têtes héroïques furent portées le lendemain à la Kasbah.
Quand le consul de Sardaigne demanda au chef la permission de faire donner la sépulture aux corps décapités, Hussein lui répondit que ses gens y courraient trop de risque, parce que les tribus avec lesquelles les Français avaient été aux prises étaient les plus féroces non seulement de la côte, mais de toute la régence. Il ne fit d'ailleurs pas difficulté de rendre aux consuls les vingt-quatre têtes, qu'il avait payées cent piastres chacune ; il en avait donné deux cents pour le seul prisonnier qui eût échappé à la mort.
Quelques semaines après cet incident, le vaisseau la Provence, portant le pavillon du contre-amiral de la Bretonnière, se présentait devant Alger.
Par l'entremise du consul général de Sardaigne, une audience fut demandée au dey, qui, après quelques pourparlers, consentit à recevoir à la Kasbah l'amiral négociateur.
Le 31 juillet, M. de la Bretonnière, accompagné d'un capitaine de frégate, d'un secrétaire et d'un interprète, débarqua dans le port d'Alger; une foule tumultueuse, à grand'peine contenue par le bâton des janissaires, grondait autour du cortège.
En se rendant d'abord à la résidence du ministre de la Marine, où le comte d'Attili devait le rejoindre, l'amiral trouva rangés sur son passage, comme les trophées d'une prétendue victoire, les trois canots que la mer avait enlevés à nos marins, le 17 juin.
Arrivé à la Kasbah, il refusa de subir l'humiliante exigence que l'étiquette algérienne imposait aux étrangers ; il garda son épée.
Sa conférence avec le dey dura deux heures ; les conditions préliminaires qu'il était chargé de présenter et de soutenir au nom du roi n'avaient été ni augmentées ni diminuées. C'étaient l'envoi d'un personnage considérable de la régence à Paris et la conclusion d'un armistice.
Hussein remit au surlendemain sa réponse.
Le 2 août, l'amiral se rendit de nouveau à la Kasbah.
Malgré tous ses efforts, le dey refusa péremptoirement toute satisfaction, en disant qu' « un prince doit toujours soutenir ce qu'il a prononcé » ; mais il termina l'audience par ces mots : « J'ai de la poudre et des canons, et puisqu'il n'y a pas moyen de s'entendre, vous êtes libre de vous retirer. Vous êtes venu sous la foi d'un sauf-conduit; je vous permets de sortir sous la même garantie. »
En retournant à son bord, M. de la Bretonnière promit au consul général de Sardaigne de différer jusqu'au lendemain à midi son départ.
Le 5 août, à midi, le brick l'Alerte, qui avait accompagné la Provence appareilla le premier pour sortir de la rade.
Une heure après, la Provence leva l'ancre à son tour.
À ce moment, le port, le môle, le rivage, toutes les terrasses des maisons étagées depuis le port jusqu'à la Kasbah étaient couvertes de spectateurs. La brise était faible. Le vaisseau, sous pavillon parlementaire, s'avançait lentement.
Tout à coup une détonation retentit dans la batterie du fanal, puis une seconde et une troisième. Au signal du canon, la foule répondit par des clameurs ; les batteries qui paraissaient désertes s'animèrent ; pendant une demi-heure, les bombes et les boulets tombèrent autour du vaisseau-amiral.
Cependant il marchait, calme et dédaigneux, sans répondre à l'outrage ; quand il fut hors d'atteinte, il amena seulement alors le pavillon parlementaire qu'il avait, lui seul, respecté jusqu'à la fin ; et pourtant onze boulets avaient frappé le majestueux navire. Malgré l'aveuglement de son orgueil, Hussein ne tarda pas à reconnaître la grandeur de l'attentat qu'il venait de commettre.
Le 6 août, il fit indirectement savoir à M. de la Bretonnière que le ministre de la Marine, le commandant des canonniers et tous les chefs de batterie avaient été destitués et chassés, pour avoir agi sans ses ordres.
Le désaveu n'obtint pas plus de réponse que l'agression.
Quand ces graves nouvelles arrivèrent à Paris, elles se perdirent d'abord dans l'émotion causée par la chute du ministère Martignac ; la politique de transaction avait échoué. Le prince de Polignac et ses amis venaient d'être appelés par la confiance du roi Charles X au pouvoir.
... Un seul grand fait certain, éclatant, incontestable, dominait tout, s'imposait à tous : le 3 août, en pleine lumière, devant les grands espaces du ciel et de la mer, sous les yeux de cinquante mille témoins émus et frémissants, aux cris d'une foule qui se rendait par ses applaudissements complice de l'attentat, le dey Hussein avait outragé le pavillon français et le pavillon parlementaire, l'honneur d'une grande nation et le droit de toutes les nations.
(Camille Rousset, la Conquête d'Alger.)
(Pion, Nourrit et Cie, éditeurs.)
https://www.algerie-ancienne.com/Salon/Galib/8France/01expedit/12naufrage.htm
Cruels traitements infligés par les Arabes
aux naufragés de
l' "Aventure" et du "Silène"
aux naufragés de
l' "Aventure" et du "Silène"
(MAI 1830)

Les brigs l'Aventure, commandé par M. d'Assigny, et le Silène, commandé par M. Bruat, naviguaient de conserve sur la côte d'Afrique, non loin de Bône, lorsqu'ils firent côte, égarés dans une brume épaisse.
AYANT réuni les officiers des deux brigs, nous leur présentâmes les deux moyens de salut qui s'offraient naturellement à nous : le premier, de nous armer et de nous tenir près des brigs jusqu'à ce que le temps pût permettre aux bâtiments de guerre de venir nous sauver; le second, de ne faire aucune résistance et d'être conduits par les Bédouins jusqu'à Alger. Nous nous décidâmes pour le dernier avis, nos poudres étant mouillées et le ciel et la mer étant loin de nous faire espérer de pouvoir apercevoir nos bâtiments de tout le jour. Ayant donc rassemblé tous nos hommes et pris quelques vivres que la mer avait jetés sur le rivage, nous prîmes le chemin d'Alger, en suivant la grève; il était environ quatre heures du matin. A peine avions-nous parcouru un quart de lieue, qu'une troupe de Bédouins armés vint fondre sur nous.
Parmi les hommes qui formaient l'équipage du Silène se trouvait un Maltais pris devant Oran par ce brig, dans un bateau de pêche. Cet homme sachant l'arabe, et ayant longtemps navigué avec des marins de la régence, se dévoua, pour ainsi dire, au salut de tous. Nous recommandant de ne point contredire ce qu'il allait avancer, il protesta à ces barbares furieux que nous étions Anglais. Par trois fois on lui mit le poignard sur la gorge, pour tâcher de l'effrayer et juger par son émotion si ce qu'il avançait était vrai; sa fermeté en imposa aux Arabes; et bien qu'ils ne fussent pas entièrement convaincus, elle jeta un doute dans leur esprit, qui contribua, en partie, à sauver les équipages.
Sous le prétexte de nous conduire à Alger par un chemin plus court, ils nous firent prendre la route des montagnes.
Après un quart d'heure de marche, arrivés à un village composé d'un petit nombre de cases, ils commencèrent à nous piller, d'abord légèrement, ensuite avec la plus barbare cruauté, nous laissant sans chemise, exposés au vent et aux froides ondées du nord.
Après avoir fait environ quatre lieues dans les montagnes, nous faisant faire, à diverses reprises, des haltes, pendant lesquelles ils nous arrachaient le reste de nos vêtements, nous arrivâmes à un village assez considérable (à peu près sur le méridien du cap Dellys), où ils nous firent arrêter, et distribuèrent à quelques-uns de nous du pain en petite quantité. Plusieurs fois, pendant cette pénible route, nous passâmes dans les mains de troupes différentes de ces Arabes; et chaque changement occasionnait parmi ces brigands les cris les plus affreux, les démonstrations les plus hostiles.
Cependant, malgré les poignards et les yatagans levés, le sang ne ruissela pas; un seul des nôtres fut légèrement blessé à la tête.
Après une demi-heure de repos, les Arabes, s'apercevant que le village n'était pas assez considérable pour nous loger tous, prirent, après une grande discussion, le parti de nous disséminer.
M. Bruat, avec environ moitié des hommes, fut logé dans ce dernier village ; je repris, avec le reste, la route que nous avions déjà parcourue : on nous distribua, chemin faisant, dans des hameaux épars, mais assez rapprochés pour que nous pussions au besoin nous donner avis les uns aux autres de ce qui pourrait survenir. Les officiers, les aspirants, les maîtres furent distribués à peu près suivant ces groupes, et je leur recommandai d'agir avec la plus grande prudence dans leurs rapports avec ces féroces habitants.
Ici l'histoire de nos malheurs se complique; chaque village, chaque maison présente des scènes différentes; mais comme je craindrais de vous fatiguer par tant d'images douloureuses, je vais me borner à vous rendre compte de ce qui se passa sous mes yeux.
Arrivés dans la maison du Bédouin qui nous avait pris sous sa protection, les femmes d'abord se refusèrent à nous recevoir; nous fûmes rebutés encore dans une autre case; puis elles finirent par s'attendrir sur notre sort, et la première maison dont nous avions d'abord été repoussés devint notre asile. On nous alluma du feu, on nous donna à manger, et deux jours se passèrent sans trouble. Le premier sujet d'inquiétude nous fut donné par quelques marins qui s'échappèrent des maisons voisines, et coururent la campagne dans l'espoir de se sauver; ils furent arrêtés peu après : mais les Bédouins nous observèrent davantage, nous soupçonnant tous d'avoir les mêmes intentions.
Le 18, vers le soir, les frégates de la division et quelques brigs, s'étant approchés des navires échoués, envoyèrent des embarcations pour les reconnaître. Ces dispositions de débarquement jetèrent la terreur de toutes parts; tous les Arabes s'armèrent et descendirent des montagnes en hurlant; les femmes mirent leurs enfants sur leur dos, prêtes à fuir; nous autres, malheureux prisonniers, on nous enferma dans les cases les plus fortes, nous menaçant de mort au moindre mouvement que nous ferions pour tâcher de nous sauver.
Nous étions au moment d'être égorgés; un coup de canon que nous entendîmes nous parut pour tous le moment du massacre; car de quelque côté que tournât la fortune, les Bédouins vainqueurs ou vaincus devaient se venger sur nous de leurs pertes, ou, exaltés par leurs succès, nous ajouter aux malheureuses victimes de leur fureur. Heureusement, la chance tourna plus favorablement que nous ne devions l'espérer; la frégate rappela ses embarcations, et tout rentra pour nous dans l'ordre accoutumé. Mais il n'en fut pas ainsi dans les montagnes.
M. Bruat, que j'avais laissé avec vingt-trois hommes, compris le Maltais et six officiers, fut logé d'abord dans la même maison, avec ses compagnons; mais comme elle n'était pas assez grande pour tout le monde, on les en fit sortir et on les plaça dans une espèce de mosquée ouverte à tout venant, ce qui les exposa à des recherches pénibles et à de mauvais traitements. Les deux premiers jours, les Arabes qui les avaient capturés leur disaient chaque matin que la rivière de Bouberak gonflée par les pluies ne leur permettait pas de les conduire à Alger.
Le troisième jour, quoique leurs intentions parussent plus hostiles encore, la vie des hommes était en sûreté, lorsqu'un fils de Turc ayant passé la rivière vint dire dans ces villages que les officiers du dey étaient de l'autre côté pour nous protéger, mais que, pour eux, ils étaient bien sots de nous prendre encore pour Anglais.
Le Maltais jugeait que sa présence hâterait les secours que nous attendions, étant plus à même que personne d'expliquer notre situation affreuse ; à sa demande, M. Bruat le fit partir, en lui recommandant toute diligence.
Il y avait à peine une heure qu'il était en route, que nos marins furent mieux traités; plusieurs des Arabes leur rendirent les effets dont ils Ies avaient dépouillés le premier jour de notre captivité. En même temps, un des guides fit sortir M. Bruat, et lui fit entendre qu'il allait le conduire à la rivière. Celui-ci refusa de se séparer de ses camarades, qu'il informa aussitôt de la proposition qui venait de lui être faite; mais, d'un avis unanime, ils lui représentèrent que sa présence parmi eux ne serait pas à beaucoup près aussi utile qu'auprès des officiers du pacha. Il se décida donc à partir ; mais, sur l'observation du commis aux revues, il obtint de changer de guides pour leur laisser celui qui paraissait prendre mieux leurs intérêts. M. Bruat, en passant la rivière à la nage, perdit ses effets, qui furent entraînés par la violence du courant. Arrivé sur l'autre rive, un Turc se dépouilla des siens pour l'habiller. De là, ayant été mené à la tente de l'effendi, ne trouvant personne sachant le français ou l'anglais, il fut interrogé en espagnol, et reçut les plus grandes assurances pour la sécurité de tous.
On expédia de suite deux officiers dans les montagnes; on lui permit même d'écrire une lettre à son second, pour lui donner les mêmes assurances. L'effendi, tout en lui témoignant beaucoup d'humanité, lui fit plusieurs questions sur le débarquement. Il lui demanda s'il était vrai que les troupes destinées à l'expédition d'Alger partissent contre leur gré ! M. Bruat lui répondit que la conduite de nos soldats, lorsqu'ils seraient débarqués, prouverait la fausseté de cette assertion. Quant au point et à l'époque où devait avoir lieu le débarquement, il lui observa que les circonstances seules pourraient en décider.
On insista particulièrement pour savoir ce qu'étaient devenues ses dépêches ; sur la réponse qu'il fit qu'il les avait déchirées quelques minutes après l'échouage, on lui fit dire par un officier turc qui venait d'arriver, et qui parlait français, que s'il pouvait les lui livrer, il obtiendrait sur-le-champ sa liberté; sa réponse fut que, quand même ses jours y seraient attachés, il ne balancerait pas à les lui refuser.
Tout paraissait tranquille dans les montagnes; le sort de nos camarades semblait être assuré : mais à environ huit heures du soir, de grands cris se firent entendre de l'autre côté de la rivière; on disait que la division navale française s'était approchée des débris des brigs, que les Bédouins avaient été blessés par le feu de l'artillerie, qu'enfin plusieurs Français échappés dans les montagnes y avaient blessé une femme. Ce fut alors, nous le sûmes plus tard, le signal d'un horrible massacre. Beaucoup de nos malheureux compagnons, subitement assaillis par les Bédouins en fureur, furent égorgés et mutilés. Heureusement pour M. Bruat, il était alors auprès de l'effendi. Sans cela nous aurions eu à déplorer sa mort....
L'effendi pâlit en apprenant ces nouvelles, et se plaignit à M. Bruat de ce que la présence de ces navires avait exaspéré les Arabes, sans pouvoir nous être d'aucun secours.
Cependant. le capitaine du Silène lui fit observer que les bâtiments avaient fait leur devoir, dans la supposition que nous fussions encore cachés dans les montagnes; ajoutant que pour les autres parties du rapport qu'on venait de lui adresser, il était probable qu'elles étaient fausses.
Quelques heures plus tard M. Bruat fut expédié pour Alger, d'après les ordres du dey, et y arriva le 20 au matin. Il fut conduit chez l'aga, qui lui renouvela les questions qui lui avaient été déjà faites. Une lettre qui lui fut montrée datée de Toulon lui prouva que les Algériens recevaient des informations sur tout ce qui se passait. Le lendemain du départ de M. Bruat, les Arabes dirigèrent sur Alger onze personnes, dont deux officiers.
Enfin le 20 à quatre heures du matin, les Arabes chez lesquels j'étais logé avec une partie de mon équipage nous rassemblèrent pour nous conduire ; la rivière Bouberak et nous remettre entre les mains des officiers du dey, lesquels nous rencontrâmes un peu en deçà de la rivière.
Nous étions en tout soixante-quinze.
L'un d'eux, qui parlait français, nous dit que nous étions bien heureux d'avoir échappé au massacre, que déjà vingt têtes avaient été portées à Alger, qu'on parlait d'un plus grand nombre encore. Ces nouvelles nous navrèrent le cœur et furent pendant toute cette triste marche le sujet de nos douloureux entretiens.
Nous passâmes la nuit au cap Matifou. Le lendemain, environ à quatre heures du soir, nous entrâmes à Alger, escortés de soldats turcs et suivis d'une populace nombreuse. On nous conduisit devant le palais du dey, où le spectacle affreux de nos malheurs vint, frapper nos yeux dans toute son horrible vérité : les têtes de nos camarades y étaient exposées aux yeux d'une populace effrénée; plusieurs d'entre nous ne purent supporter ce spectacle de douleur, et tombèrent évanouis. Après dix minutes de pause, on nous conduisit au bagne, où nous trouvâmes douze des nôtres, qui, réunis à soixante-quatorze que j'accompagnais, sont jusqu'à présent les seuls débris que j'aie pu réunir de cet affreux naufrage.
Le consul d'Angleterre et celui de Sardaigne avaient demandé audience au dey pour obtenir d'avoir les états-majors chez eux ; mais nous les priâmes de n'en rien faire : notre intention étant de rester toujours avec nos hommes, et de partager en tout leur mauvaise fortune. M. le consul de Sardaigne s'est chargé d'avancer les fonds nécessaires à la nourriture des deux équipages nous en avons réglé les dépenses avec tout l'ordre et l'économie possibles. Le dey lui-même nous envoya le jour de notre arrivée les objets que réclamaient nos premiers besoins.
Quelque affreuses que soient les suites des notre naufrage, nous devons encore bénir la Providence d'avoir permis à nos soins d'en recueillir autant de débris ; car jusqu'à présent, les équipages dont les bâtiments périrent sur ces côtes, entraînés par leur courant variable, ont presque tous été entièrement massacrés; un navire même de la régence n'y éprouverait pas un sort moins funeste. Pour nous, nous avons fait ce que nous devions faire; et quels que soient les douloureux souvenirs dont nos âmes resteront toujours pénétrées, nous avons encore la consolation de n'avoir à accuser de notre perte que les chances malheureuses de la navigation.

A. D'ASSIGNY.
Énergique attitude du Baron d'Haussez
Ministre de la Marine
Ministre de la Marine
L'ANGLETERRE voyait avec inquiétude et jalousie les dispositions que la France faisait pour s'emparer d'Alger. Lord Stuart, son ambassadeur, avait, à diverses reprises, eu des conférences sur cet objet avec le prince de Polignac et n'en avait obtenu que des réponses évasives et un engagement vague de traiter de l'avenir et de la conquête, lorsque cette conquête serait faite. Il espérait sans doute tirer de moi un meilleur parti, et plusieurs fois il chercha à entamer la question, quoique je lui dise que, le côté diplomatique de cette affaire n'étant pas dans mes attributions, je ne pouvais ni ne voulais m'en occuper.
Un jour qu'il m'avait pressé fortement et sans plus de succès que de coutume, il ajouta que ses questions n'avaient pour objet que la confirmation de ce qu'il savait, qu'il avait découvert que nous ne songions pas sérieusement à l'expédition et que nos préparatifs ne tendaient qu'à faire peur au dey, à « l'amener à composition ». « Ce serait peine perdue, lui répondis-je ; dans son insouciance turque, le dey ignore peut-être que nous nous proposons de l'attaquer, et, s'il le sait, il s'en remet à Dieu du soin de le défendre.
Au reste, je puis vous déclarer, parce que nous n'en faisons pas mystère, que c'est très sérieusement que nous faisons des préparatifs.
Le roi veut que l'expédition se fasse, et elle se fera.
— Vous croyez donc que l'on ne s'y opposera pas ?...
— Sans doute, qui l'oserait ?
— Qui ?... nous les premiers.
— Milord, lui dis-je avec une émotion qui approchait fort de la colère, je n'ai jamais souffert que, même vis-à-vis de moi, simple individu, on prît un ton de menace; je ne souffrirai pas davantage qu'on se le permette à l'égard du gouvernement dont je suis membre. Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas traiter l'affaire diplomatiquement ; vous en trouverez la preuve dans les termes que je vais employer : la France se... moque de l'Angleterre (je substitue le mot moque à un terme beaucoup plus énergique de trop mauvais ton pour être écrit).
— Elle fera dans cette circonstance ce qu'elle voudra, sans souffrir de contrôle ni d'opposition.
— Nous ne sommes plus au temps où vous dictiez des lois à l'Europe. Votre influence était basée sur vos trésors, vos vaisseaux et une habitude de domination. Tout cela est usé.
— Vous ne compromettrez pas ce qui vous reste de cette influence, en allant au-delà de la menace.
— Si vous voulez le faire, je vais vous en donner les moyens. Notre flotte, déjà réunie à Toulon, sera prête à mettre à la voile dans les derniers jours de mai. Elle s'arrêtera pour se rallier aux îles Baléares. Elle opérera son débarquement à l'ouest d'Alger.
— Vous voilà informé de sa marche ; vous pouvez la rencontrer, si la fantaisie vous en prend. Mais vous ne le ferez pas. Vous n'accepterez pas le défi que je vous porte, parce que vous n'êtes pas en état de le faire.
Ce langage, je n'ai pas besoin de vous le dire, n'a rien de diplomatique.
C'est une conversation entre lord Stuart et le baron d'Haussez, et non une conférence entre l'ambassadeur d'Angleterre et le ministre de la Marine de France.
Je vous prie cependant de réfléchir sur le fond, que le ministre des Affaires étrangères pourrait vous traduire en d'autres termes, sans rien changer au sens.
Lord Stuart ne me parla plus de cette affaire.
(Mémoires de M. le Baron d'Haussez.)
(Revue de Paris, Calmann Lévy, éditeur.)
Le débarquement de Sidi-Ferruch
(JUIN 1830)
LE 18 mai, le général de Bourmont, avec son état-major, monta à bord du vaisseau amiral la Provence. L'armée espérait partir le jour même ; mais l'amiral Duperré dirigea seulement la flottille de débarquement sur Palma (aux Baléares) avec ordre d'y attendre la flotte. Le temps s'étant mis au calme plat, la flotte ne put prendre la mer que le 25 mai, et le fit dans l'ordre suivant : au centre, les deux escadres de bataille et de débarquement; à quatre milles sur la droite, l'escadre de réserve ; à quatre milles sur la gauche, le convoi; en avant-garde, les sept petits bateaux à vapeur.
Cet ordre régulier et imposant d'une escadre de cinq cents voiles ne put pas être longtemps maintenu ; la mer étant devenue grosse, les bateaux du convoi, d'une marche inégale, ne pouvaient pas conserver leur place ; l'amiral leur enjoignit de rallier séparément à Palma la flottille de débarquement, pendant que lui-même, à la tête de l'escadre, se dirigerait directement sur la côte d'Afrique; puis, en vue du prochain débarquement, il envoyait, le 30 mai, à la flottille l'ordre de rejoindre sous Alger l'escadre qui, le lendemain, relevait le cap Caxine.
Mais, le mauvais temps ne permettant pas, d'après l'appréciation de l'amiral, de tenter le débarquement, de nouveaux ordres furent donnés; la flotte s'éloigna de la terre d'Afrique, qu'elle venait d'entrevoir, et se rassembla à Palma, afin d'y réparer ses avaries et d'y attendre le moment propice.
Le 10 juin, l'armée navale réunie, moins une partie du convoi, quittait Palma et, le 12, arrivait en vue d'Alger. À cause de l'état de la mer, l'amiral, sur qui pesait la responsabilité de l'opération, était encore hésitant; toutefois, devant les signes de mécontentement et d'impatience qui se manifestaient dans l'armée, énervée par vingt-cinq jours de traversée et d'attente, il se décida enfin à donner l'ordre du débarquement.
Le 15, la flotte se rapprocha de la côte, défila majestueusement devant Alger, dont les habitants terrifiés commencèrent à comprendre la grandeur du danger qui les menaçait, et vint prendre position dans la baie ouest de Sidi-Ferruch pour l'opération du débarquement du lendemain.
Hussein-Dey avait confié le commandement général des troupes de la régence à son gendre l'aga (chef de la milice) Ibrahim ; ces forces se composaient des troupes du dey et des contingents fournis par les beys d'Oran, de Tittery et de Constantine. Bien qu'on fût à peu près certain, grâce aux indiscrétions commises en France, que le débarquement aurait lieu à Sidi-Ferruch, l'aga avait établi son quartier général près de l'embouchure de l'Harrach, sans doute en souvenir des débarquements de Charles-Quint et d'O'Reilly.
Toutefois un gros rassemblement était venu camper au lieu dit Staouëli, mais aucune disposition n'avait été prise dans la presqu'île de Sidi-Ferruch pour s'opposer au débarquement.
La Torre-Chica et la batterie en maçonnerie construite à peu de distance dans la presqu'île avaient été abandonnées ; la hauteur du Marabout n'était pas occupée. Les Turcs, au moment de l'arrivée des Français, étaient encore en train de construire diverses batteries.
La rumeur publique avait fort exagéré l'importance des forces turques réunies à Staouéli ; on racontait que des hordes de cavalerie couvertes par des milliers de chameaux (souvenir de l'expédition d'O'Reilly) attendaient l'armée sur le rivage, que les batteries de Sidi-Ferruch étaient armées d'une façon formidable et servies par des canonniers héritiers de la bravoure légendaire des soldats turcs. Ces bruits avaient même acquis une telle importance que le général de Bourmont crut devoir, dans son ordre, rassurer et encourager l'armée.
Aussi quel fut l'étonnement des Français lorsqu'en arrivant dans la baie de Sidi-Ferruch ils virent les embrasures de la Torre-Chica et de la batterie voisine dégarnies, la presqu'île inoccupée par l'ennemi ; quelques cavaliers seulement se livraient, sur la plage, à une brillante fantasia, comme pour animer le magnifique panorama qui se déroulait sous les yeux émerveillés de l'armée.
On apercevait, au milieu des broussailles, les batteries en construction au-delà de la plage de la baie ouest ; le Nageur fut chargé de leur envoyer quelques coups de canon à titre de reconnaissance. Les Turcs ripostèrent aussitôt, sans faire de mal, et ne tardèrent pas à démasquer la batterie de mortiers, dont ils dirigèrent le tir sur le Breslau. — L'emploi des bombes par l'ennemi pouvait rendre critique la position de la flotte concentrée dans la baie; mais ce danger fut écarté, grâce à l'heureuse inspiration qu'eut le commandant du Breslau de ne pas engager le combat d'artillerie; le tir des mortiers turcs étant trop court, il y avait intérêt en effet à laisser croire à l'ennemi que les navires étaient trop éloignés pour être atteints, et à ne pas lui donner d'indication pouvant lui permettre de rectifier son tir. — Bientôt, d'ailleurs, les canonniers ennemis, effrayés sans doute par l'éclatement prématuré d'une bombe, avaient cessé le feu, et, la nuit venant, il n'y eut plus, suivant les habitudes des Turcs, aucune tentative pour reprendre les hostilités. Un seul matelot à bord du Breslau avait été blessé, et le pavillon de ce navire avait été percé par un boulet.
Les prescriptions détaillées qui avaient été préparées pour le débarquement, en prévision d'une résistance énergique de la part de l'ennemi, furent révoquées, lorsqu'on se rendit compte que les Turcs ne s'opposeraient pas à l'opération.
Le 14 juin, à deux heures du matin, commence le débarquement de la première division (général Berthezène).
— Les troupes désignées pour faire partie du premier convoi prennent place sur les chalands et dans les embarcations; au milieu d'elles se trouvent le général Berthezène, ses généraux de brigade, le général de la Vitte. Les hommes emportaient avec eux cinq jours de vivres.
— À quatre heures, l'officier de marine chargé de diriger l'opération donne le signal.
Bientôt les canots remorqueurs rompent l'alignement : chacun veut arriver le premier à terre. En quelques minutes tout est débarqué ; les canonniers, faute d'attelage, traînent leurs pièces à bras en haut de l'éminence, au centre de la presqu'île ; les troupes d'infanterie se forment et le génie s'assure que la tour n'est pas minée.
L'ennemi est absent partout; la prise de possession de l'Algérie par l'armée française s'effectue sans coup férir.
(Expédition de 1830, Capitaine Rouquerol.)
(Berger-Levrault et Cie.)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:L%27escadre_fran%C3%A7aise_command%C3%A9e_par_l%27amiral_Roussin_force_l%27entr%C3%A9e_du_Tage,_11_juillet_1831.jpg
Le forcement de l'entrée du Tage
(11 JUILLET 1831)
Le contre-amiral Roussin fut envoyé avec une escadre à Lisbonne, pour demander satisfaction des violences commises contre nos nationaux dans la capitale du Portugal, où Dom Miguel s'était fait proclamer souverain absolu. On jugera par les extraits suivants de la fermeté et de l'énergie déployées par le chef de nos forces navales.
L'Amiral Roussin à M. le Vicomte de Santarem,
Ministre du Roi de Portugal.
À bord du Suffren, au mouillage de Cascaës, le 8 juillet 1831.
Mon parlementaire porte à votre gouvernement les demandes officielles du ministre. En remplissant ce devoir, je ne crois pas qu'il doive m'empêcher de tenter un moyen d'en tempérer la rigueur.
Cette lettre confidentielle a pour objet de vous engager, de vous prier même de préférer le rétablissement encore possible de la paix à la continuation certaine d'une guerre imminente.
Établi devant le Tage avec une escadre française, j'y entrerai.
Il s'agit donc, Monsieur le Vicomte, de savoir si la ville de Lisbonne, la capitale de votre pays, restera exposée au danger qui la menace. J'ai cru que la démarche que je fais dans le but de vous mettre à même de l'éviter, dût-elle échouer, nous honorerait tous deux, car la confiance ne marche qu'avec l'estime.
Baron Roussin.
Cette lettre fut portée à Lisbonne par le brig le Dragon.
Le Dragon me rejoignit dans le délai de vingt-quatre heures que je lui avais assigné. Le gouvernement portugais rejetait définitivement les demandes de la France ; l'heure était venue de le punir.
Décidé à ne pas différer d'un seul jour, si je le pouvais, l'exécution de cette menace, je résolus de profiter des premiers vents favorables, ne fussent-ils que nord-nord-ouest. Les pêcheurs que, moitié par force, moitié par intérêt, nous avions engagés à nous suivre, les trouvaient trop courts : j'espérai qu'avec de bons bâtiments ils suffiraient.
Les vents se levèrent à huit heures ; à dix, nous appareillâmes, et, portant sur l'escadre qui s'approchait, je signalai l'ordre de bataille tribord amures, pour avoir le temps de terminer nos dernières dispositions.
Rien ne saurait peindre l'ardeur qui se manifesta dans l'escadre à la vue de ce signal. On put en juger par la promptitude avec laquelle l'ordre fut formé, malgré une forte brise, une brume très épaisse et la dureté de la mer. Cette précision ardente, indispensable dans les opérations navales, se fit remarquer au plus haut degré dans la manœuvre de tous les vaisseaux et frégates de la ligne de bataille, et les avisos ne mirent pas moins d'activité à transmettre mes derniers ordres sur toute la ligne.
Tout étant prêt, à midi et demi je signalai de virer lof pour lof par la contremarche; ce mouvement opéra le rapprochement que je désirais dans les distances; et à une heure et demie, laissant arriver sur la passe du sud, l'escadre donnait à pleines voiles dans le Tage, en gouvernant entre les forts Saint-Julien et Bugio.
Elle était rangée, d'après l'ancienneté des capitaines et la force des vaisseaux, dans l'ordre suivant :
Le Marengo, l'Algésiras, le Suffren, la Ville de Marseille, le Trident, l'Alger, la Pallas, la Melpomène et la Didon.
Afin d'éviter de souffrir de nos propres feux, j'avais placé les corvettes à la droite de la tête de ligne, avec ordre aux vaisseaux qui les avaient par leur travers de ne pas tirer de ce côté. Par cet arrangement, la tour de Bugio devait être combattue exclusivement par les frégates et corvettes, tandis que les vaisseaux porteraient tous leurs efforts sur Saint-Julien.
Au moment d'entrer, je parcourus les batteries, où je trouvai un ordre et un enthousiasme admirables; je ne doutai pas que la marine ne touchât à une glorieuse journée. À peine étais-je remonté, que les deux premiers forts de l'entrée ouvrirent leur feu ; nous étions à trop grande portée ; la direction de la route nous empêchait de les découvrir en belle; nous continuâmes encore dix minutes sans riposter.
Enfin le Marengo, et successivement l'Algésiras, le Suffren et toute la ligne tirèrent, et dans un moment le fort Saint-Julien fut couvert d'une masse de fer, dont un nuage de pierres et de sable annonça les effets. Néanmoins notre distance de ce fort ne fut pas moindre de 500 toises; elle resta à peu près la même de la tour de Bugio, que les frégates et corvettes combattaient. Mais la bonne direction et la vivacité de nos coups, suppléant à la proximité, ces deux forts furent bientôt dans le plus misérable état, et Bugio, serré de plus près par les frégates et les corvettes, fut presque entièrement éteint par ces bâtiments.
L'histoire de ces deux forts principaux serait celle de tous les autres, que nous prolongeâmes successivement à des distances de 500 à 50 toises, en avançant dans le Tage; je ne la répéterai donc pas. À mesure que nous passions devant eux, ils commençaient un feu assez vif; mais aucun n'a pu le continuer après cinq ou six volées de l'escadre ; ils ne tiraient plus ensuite que quelques coups aussi rares que mal dirigés, et les acclamations des équipages seuls se faisaient entendre.
Jamais donc réputation plus formidable ne fut si peu méritée que celle des forts du Tage, et jamais on ne tira plus mauvais parti d'une artillerie nombreuse et de positions naturelles favorables à la défensive.
L'escadre parvint, sans altérer un seul instant son ordre, par le travers du Paço d'Arcos. L'absence d'avaries m'avait décidé, aussitôt après avoir passé le fort Saint-Julien, à pousser jusque devant Lisbonne. Mais, soit que le signal de continuer ne fût pas hissé assez tôt, soit qu'il n'ait pas été vu des vaisseaux de tête, le Marengo et l'Algésiras mouillèrent au poste qui leur était assigné dans la première partie du plan.
Ce fut la seule contrariété que nous éprouvâmes dans un trajet de quatre lieues; et encore celle-ci fournit-elle aux capitaines qui avaient mouillé l'occasion de donner une nouvelle preuve de leur habile fermeté. À peine aperçurent-ils que le reste de l'escadre poursuivait sa route, que l'Algésiras et le Marengo mouillés remirent sous voiles et reprirent poste dans la ligne.
Cette brillante manœuvre excita les applaudissements de l'escadre et d'innombrables cris de vive le Roi!
À quatre heures, le Suffren, devenu chef de file, suivi de la Ville de Marseille, du Trident, de l'Alger, des frégates la Pallas, la Melpomène et la Didon, rangea le fort de Bélem à 60 toises et le canonna vivement ; puis, étant parvenu par le travers du nouveau palais et d'un grand édifice public qui me parut être une corderie appartenant à l'État, je fis mouiller. Depuis le fort de Bélem ne prolongeant plus que des habitations particulières, j'avais ordonné de suspendre le feu, afin de ne combattre que tout ce qui pouvait encore se défendre; j'en ai usé ainsi dans tout le trajet de l'escadre. Le Trident, l'Alger et l'Algésiras, encore sous voiles ainsi que les frégates et corvettes, se portèrent sur l'escadre portugaise, embossée entre la ville et la pointe du Pontai.
Ils reçurent ordre de la combattre et de l'amariner, et, primant de vitesse la plupart de ces bâtiments, la Pallas tira les premières volées, qui furent aussi les dernières, et suffirent pour faire disparaître le pavillon portugais.
À cinq heures toute mon escadre était mouillée à 500 toises des quais de la ville, où régna bientôt le plus profond silence.
J'envoyai sur-le-champ M. le capitaine de corvette Olivier, mon chef d'état-major, porter au Gouvernement portugais la lettre ci-jointe.
À M. le Vicomte de Santarem.
Suffren, 11 juillet 1831, devant Lisbonne,
5 heures du soir.
Monsieur le Ministre,
Vous voyez si je tiens mes promesses. Je vous ai fait pressentir hier que je forcerais les passes du Tage; me voici devant Lisbonne : tous vos forts sont derrière moi, et je n'ai plus en face que le palais du Gouvernement. Ne provoquons point de scandale. La France, toujours généreuse, vous offre les mêmes conditions qu'avant la victoire. Je me réserve seulement, en en recueillant les fruits, d'y ajouter des indemnités pour les victimes de la guerre.
J'ai l'honneur de vous demander une réponse immédiate.
Recevez, etc.
Le Contre-Amiral commandant en chef,
Vous voyez si je tiens mes promesses. Je vous ai fait pressentir hier que je forcerais les passes du Tage; me voici devant Lisbonne : tous vos forts sont derrière moi, et je n'ai plus en face que le palais du Gouvernement. Ne provoquons point de scandale. La France, toujours généreuse, vous offre les mêmes conditions qu'avant la victoire. Je me réserve seulement, en en recueillant les fruits, d'y ajouter des indemnités pour les victimes de la guerre.
J'ai l'honneur de vous demander une réponse immédiate.
Recevez, etc.
Le Contre-Amiral commandant en chef,
Baron Roussin.
Dictée dans le sentiment de notre puissance, cette lettre ne différa point des bases posées avant la victoire.
Doublement vaincu, le gouvernement portugais céda à la force et à la générosité, et à dix heures je reçus son adhésion formelle à toutes les demandes de la France.
Telle a été, Monsieur le Ministre, l'exécution de vos ordres.
En voyant, après un succès si complet, combien il nous a peu coûté, je ne craindrai pas de voir affaiblir son prix; c'est au vaincu seulement à regretter de n'avoir pas su honorer suffisamment sa défaite. Celle-ci consiste dans la destruction du prestige qui faisait la force d'un gouvernement orgueilleux et qu'adoptait l'Europe entière, l'inexpugnabilité du Tage du côté de la mer.
Il sera tenu compte à la marine française d'y avoir substitué une glorieuse et incontestable réalité. Vous avez vu, par ce rapport, à quel point l'escadre que j'ai l'honneur de commander méritait de réussir. L'hommage que je viens de rendre ses officiers est également dû aux équipages : jamais plus d'ardeur, de subordination et de patriotisme ne se sont trouvés réunis et je ne saurais en faire un éloge trop étendu.
J'accomplis aujourd'hui le plus doux de mes devoirs en mettant sous vos yeux la liste des principaux titres que j'ai vu acquérir, et vous suppliant de les soumettre au roi, rémunérateur des services rendus à la patrie.
Mais je consacrerai d'avance ici mes obligations envers M. le contre-amiral Hugon pour le dévouement avec lequel il m'a secondé, soit en m'amenant de Toulon une escadre parfaitement exercée par ses soins et animée du meilleur esprit, soit par l'utilité de ses conseils et de son exemple; il a justifié de nouveau l'attente de la marine, et tout ce qui peut lui assurer mon attachement et ma reconnaissance.
En voyant, après un succès si complet, combien il nous a peu coûté, je ne craindrai pas de voir affaiblir son prix; c'est au vaincu seulement à regretter de n'avoir pas su honorer suffisamment sa défaite. Celle-ci consiste dans la destruction du prestige qui faisait la force d'un gouvernement orgueilleux et qu'adoptait l'Europe entière, l'inexpugnabilité du Tage du côté de la mer.
Il sera tenu compte à la marine française d'y avoir substitué une glorieuse et incontestable réalité. Vous avez vu, par ce rapport, à quel point l'escadre que j'ai l'honneur de commander méritait de réussir. L'hommage que je viens de rendre ses officiers est également dû aux équipages : jamais plus d'ardeur, de subordination et de patriotisme ne se sont trouvés réunis et je ne saurais en faire un éloge trop étendu.
J'accomplis aujourd'hui le plus doux de mes devoirs en mettant sous vos yeux la liste des principaux titres que j'ai vu acquérir, et vous suppliant de les soumettre au roi, rémunérateur des services rendus à la patrie.
Mais je consacrerai d'avance ici mes obligations envers M. le contre-amiral Hugon pour le dévouement avec lequel il m'a secondé, soit en m'amenant de Toulon une escadre parfaitement exercée par ses soins et animée du meilleur esprit, soit par l'utilité de ses conseils et de son exemple; il a justifié de nouveau l'attente de la marine, et tout ce qui peut lui assurer mon attachement et ma reconnaissance.
Baron ROUSSIN.
Saint-Jean-d'Ulloa et la Vera-Cruz
(1838)
De nombreuses violences commises au Mexique sur nos nationaux motivèrent une expédition, qui se termina par de brillants faits d'armes.
LE 1er septembre je sortais de Brest sous les ordres de l'amiral Baudin, un homme qui avait derrière lui toute une carrière de vaillance.
Amputé d'un bras, sa haute taille, sa figure énergique inspiraient tout d'abord le respect, et l'on apprenait vite à voir en lui un chef aussi intelligent que résolu, que passionné même. Il avait son pavillon sur la frégate la Néréide. Je suivais sur une petite corvette dont on m'avait donné le commandement et dont je venais de faire le rapide armement. Hors les torpilleurs, les bâtiments de flottille, je ne crois pas qu'il existe aujourd'hui, dans toute notre marine, un navire aussi petit qu'elle. Quatre canons de 50 et seize caronades, des jouets d'enfant, composaient son armement. Son équipage était d'une centaine d'hommes. Mais qu'elle était jolie, avec sa fine carène si ras sur l'eau, son immense mâture inclinée sur l'arrière, et puis quel nom charmant ! Elle s'appelait la Créole. C'était mon premier commandement. J'avais vingt ans ; nous partions pour une expédition où il y avait chance de tirer le canon et où je me flattais à mon tour d'imiter les exemples de mes frères aînés, qui avaient si bien su à Anvers et en Afrique soutenir l'honneur de la race.
Après une rapide traversée, nous arrivons à Sacrificios, l'ancrage le plus rapproché de Vera-Cruz. Nous y apprenons que le capitaine de la Médée, M. Leray, est en mission à Mexico. Puis l'amiral lui-même s'en va à Xalapa, pour y conférer avec les ministres mexicains. Pendant ce temps la routine du blocus continue, agrémentée par des privations de toute sorte, la ration d'eau, la fièvre jaune. L'eau nous est apportée de la Havane ; elle vient dans les barriques, d'où elle sort quelquefois noire et infecte.
La fièvre jaune se promène.
Peu de jours après, la danse commença. L'amiral embossa les trois frégates : Néréide, Gloire, Iphigénie, celle-ci revenue de la Havane, — avec un équipage complété par celui du brick le Duquesne, et les deux bombardes, et attaqua le fort. Je lui avais demandé à être de la fête, et, à ma grande douleur, il m'avait refusé, trouvant mon bateau trop petit, trop insignifiant. « Je ne peux pas vous admettre, j'ai laissé aussi de côté la Médée, une frégate, dont je trouve l'artillerie insuffisante. » Il m'envoya en observation pour juger le tir des bombardes et le faire rectifier au besoin.
L'amiral fait signal d'ouvrir le feu ; et la canonnade s'engage. En un instant la fumée m'enveloppe. Non seulement je n'y vois plus pour observer le tir, mais je n'y vois plus pour me conduire; la sonde donne de très petits fonds et je vois monter à la surface la vase que je remue avec ma quille. Impossible de rester en pareille situation. Je me couvre de voiles et, sortant de la fumée, je redemande par signal à l'amiral la permission de prendre part au combat. Il s'attendrit et répond par le bienheureux Oui!
Je prolonge alors la ligne des frégates chaudement engagées, l' Iphigénie surtout. À chaque instant je voyais voler en l'air les éclats de bois projetés par les boulets qui la frappaient. Elle en reçut cent huit dans sa coque, sans compter la mâture; le mât de misaine seul en eut huit; c'est miracle que tout ne tombât pas. Ce brave Parseval se promenait sur la dunette, se frottant les mains quand un coup portait près de lui. C'est vraiment beau à voir. Nous échangeâmes un salut de la main, et j'allai me poster au bout de la ligne des frégates, où je restai sous voiles, allant et venant en faisant aussi mon petit tapage.
Le fort en voyait de dures.
Plusieurs explosions s'étaient déjà produites. L'idée me vint de faire charger toute ma batterie à obus et de diriger son tir contre une espèce de tour, appelée en fortification un cavalier, dont le feu était particulièrement vif. J'avais d'excellents canonniers, mais de mon poste de commandement la fumée m'empêchait de voir où portaient les coups. Mon second, placé à l'avant, pouvait mieux en juger.
Au premier coup : « Bon ! Dans le cavalier », me crie-t-il.
Deuxième coup : « Dans le cavalier ! »
Troisième coup : « Dans le cavalier ! »
Quatrième coup ?? Mais on ne voit plus rien : un immense nuage de fumée, blanche en haut, noir au-dessous, s'élève du fort et monte lentement à une grande hauteur. Quand cette fumée, poussée par le vent, s'écarte un peu, il n'y a plus de cavalier, tout a sauté en l'air : mon équipage pousse un cri de joie, et un de mes chefs de pièce exécute un brillant rigodon. Sont-ce mes obus? Sont-ce les bombes des bombardes qui ont fait le coup ? Pas un de mes braves Créoles n'admet le plus léger doute là-dessus. Que chacun garde son opinion !
Le feu se ralentissant, j'allai prendre les ordres de l'amiral.
Dans la nuit, le fort se rendit; la garnison, forte de deux mille hommes, évacua la place, et une convention fut conclue avec le général commandant à Vera-Cruz pour s'abstenir de part et d'autre de nouveaux actes d'hostilité.
Le malheureux fort était dans une condition épouvantable. Les boulets, les bombes, les explosions avaient tout bouleversé. Nombre de cadavres partout ensevelis sous les débris répandaient une odeur infecte. Là où le combat n'avait pas fait son œuvre régnait une repoussante saleté, et tout cela sous un soleil équatorial et en pleine fièvre jaune.
L'équipage de la Créole s'occupa aussitôt des travaux d'assainissement, de concert avec le détachement de sapeurs du génie qui faisait partie de l'expédition. Nous relevâmes et traînâmes au large les cadavres, et il y eut là des actes de dévouement très méritoires, publiquement appréciés du reste par l'amiral.
M. Desfossés, mon aide de camp, avait, à tout événement, rédigé un petit code de signaux, se faisant au moyen de chemises de couleur, avec la maison de notre consul à Vera-Cruz. À peine cinq jours étaient-ils écoulés depuis la prise du fort, que ces signaux nous apprirent que les Français couraient de grands dangers en ville.
Nous envoyâmes immédiatement nos embarcations au môle, où se pressait une foule éperdue d'hommes, de femmes, d'enfants, que nous recueillîmes et transportâmes au fort. Notre consul nous informa en même temps que Santa Anna, nommé généralissime, venait d'arriver avec des troupes, qu'il avait déclaré la convention nulle, etc., etc., et qu'il fallait s'attendre à tout.
Avis en fût immédiatement transmis à l'amiral, qui était avec l'escadre assez loin, au mouillage de l'Ile Verte.
Il faisait beau heureusement, car sans cela toute communication eût été impossible. L'amiral vint, de sa personne, le soir même, et s'installa à bord de la Créole. Avec sa résolution habituelle, il avait de suite pris son parti de devancer l'action de l'ennemi et de profiter de la surprise pour exécuter, avec les faibles moyens dont nous disposions, un coup de main de nature à mettre Vera-Cruz et ses forts hors d'état de nuire, du moins depuis quelque temps.
La nuit fut donc employée en préparatifs. Les embarcations de l'escadre arrivèrent successivement, sans accident, amenant toutes les compagnies de débarquement, faisant avec les trois compagnies d'artillerie qui occupaient le fort, environ onze cents hommes.
Entre quatre et cinq heures du matin, par un brouillard épais, on se mit en marche.
La moitié des compagnies de débarquement, sous les ordres du commandant Parseval, devait escalader, avec des échelles, le fortin de gauche de la ville, puis parcourir les remparts en enclouant l'artillerie et détruisant tout ce qu'on trouverait. L'autre moitié, sous les ordres du commandant Lainé, devait faire la même besogne à droite. Enfin une troisième colonne au centre devait débarquer sur le môle, faire sauter la porte, de la marine et se diriger sur le quartier général de Santa Anna, pour essayer de s'emparer de sa personne.
Ma compagnie, de soixante hommes environ, faisait l'avant-garde de cette dernière colonne, dont les compagnies d'artillerie de marine formaient le gros.
Nous voilà partis, les avirons garnis de fourrure pour amortir le bruit. Une lueur de crépuscule éclaire à peine et nous nous écarquillons les yeux dans la brume pour apercevoir le môle ; la grande porte de la ville est fermée, il n'y a pas de sentinelle extérieure, tout dort.
Nous débarquons dans un profond silence, et la colonne se forme. Les sapeurs courent en avant, posent le sac à poudre, une table inclinée qui sert de masque, puis un sergent de mineurs allume la mèche et se colle dans un ressaut de la muraille.
Pan ! le masque du pétard nous rase la tête, un des battants de la porte est à terre; au même moment la fusillade éclate du côté de la colonne Parseval.
« En avant et vive le Roi! »
Nous apercevons le poste de la porte qui se sauve et se perd dans le brouillard. Pas un chat dans les rues; le bruit de la fusillade a fait rentrer quiconque était dehors. Conduits par un guide, nous prenons au pas gymnastique une rue qui nous conduit à la porte de Mexico, où le brouillard se lève un peu. Quelques coups de fusil ou de baïonnette nous débarrassent du poste de la porte.
En ce moment, arrive, ventre à terre, de l'intérieur de la ville, une calèche attelée de six mules, avec des postillons pittoresques en grands chapeaux. C'est la calèche ayant amené Santa Anna, qui essaye de gagner la campagne.
On fait tomber deux ou trois mules, mais la calèche est vide.
Nous recevons alors une forte décharge de mousqueterie d'environ cent cinquante soldats, qui disparaissent aussitôt dans une rue latérale. C'est la grand'garde du quartier général.
Nous courons après elle et nous arrivons à temps pour voir les derniers d'entre eux pénétrer dans une grande maison que mon guide me dit être l'Hôtel du Gouvernement militaire. Une vaste cour entourée de galeries ; au-dessus, un premier étage d'arcades garnies de pots de fleurs et de plantes grimpantes, tel est l'aspect qui se présente à nos yeux en entrant.
Une vive fusillade part immédiatement du premier étage dès que nous paraissons dans la cour. Il n'y a pas à hésiter, il faut monter là-haut pour mettre ces gens à la raison. Un escalier étroit est le chemin à suivre. Eh bien ! chacun doit confesser ses faiblesses. Quand je vis cet escalier où je devais monter le premier, pour arriver là-haut et y recevoir tout seul la première décharge, j'eus une seconde d'hésitation et je m'écriai en agitant mon sabre :
« Les hommes de bonne volonté en avant ! »
Mon fourrier, un Parisien, se précipita alors sur l'escalier et, sa vue me rendant aussitôt au sentiment de mon devoir, je me précipitai à mon tour; nous luttâmes d'enjambées et j'eus la satisfaction d'arriver en haut bon premier, suivi du reste par toute ma compagnie. Et ce ne fut pas si terrible !
D'abord nous nous trouvâmes dans une espèce de vestibule, recevant par les fenêtres et à travers les portes des coups de fusil mal dirigés, qui blessèrent seulement deux officiers.
Puis, chacun travaillant pour son compte, je me jetai avec un second maître, nommé Jadot, contre une porte que nous défonçâmes à coups d'épaule. Quand elle céda, je fus projeté en avant par mes hommes, qui se pressaient derrière moi, et lancé dans une salle pleine de fumée et de soldats mexicains. Un d'eux, en uniforme blanc à épaulettes rouges, dont je vois encore les cheveux indiens plats et l'œil mauvais, me tenait en joue et me mit le canon de son fusil presque sur la figure.
J'eus le temps de me dire : « Je suis f...! » Mais non, le coup ne partit pas, le fusil me tomba sur le pied, et je vis mon homme rouler sur un canapé, emportant avec lui, tordu entre ses côtes, le sabre que mon lieutenant Penaud, prompt comme l'éclair, lui avait passé à travers le corps. Je crois que je me défis ensuite moi-même d'un autre grand diable ; puis, l'élan étant donné, tout fut culbuté, et je me trouvai dans une autre salle au fond de laquelle je vis plusieurs officiers, dont un général, debout, le sabre au fourreau, très calme.
Je me précipitai en avant avec maître Jadot pour les protéger contre mes hommes un peu excités, et la lutte cessa.
Le général, un grand blond, beau garçon, s'appelait Arista, et est devenu plus tard président de la république mexicaine. Il me remit son sabre, et je le fis conduire en bas, le laissant aux mains du commandant d'artillerie Colombel, qui l'envoya au fort. Quant à Santa Anna, nous ne le trouvâmes plus, son lit était encore chaud ; nous prîmes ses épaulettes, sa canne de commandement, et maître Jadot, qui avait perdu son chapeau de paille dans la bagarre, se coiffa de son chapeau ferré. Je me hâtai de quitter cette maison qui était pleine de sang et où la vue de deux malheureuses femmes qui avaient été tuées par la fusillade à travers les portes me faisait horreur.
Une fois dehors, je rencontrai le commandant Lainé, qui arrivait par le rempart, accomplissant sa tâche de destruction ; il m'engagea à me diriger, avec ma compagnie, vers un point de la ville où la colonne Parseval faisait un feu nourri, en donnant un coup d'œil aux églises dont les tours étaient, dit-on, armées de canon.
Je me mis en devoir d'exécuter cette véritable course au clocher, et j'arrivai devant un grand édifice, d'où l'on tira sur nous. Nous y entrâmes ; c'était l'hôpital; il y eut encore une pétarade dans une grande salle du rez-de-chaussée, pleine de malades qui se tenaient debout sur leurs lits ou se jetaient à genoux, en disant : « Gracia », à peine couverts de couvertures rouges. C'était hideux; tous ces malheureux étaient plus ou moins atteints du vomito.
Entrés par une porte, nous nous hâtâmes de sortir par l'autre et tombâmes enfin dans une longue rue droite, au bout de laquelle on apercevait une grande maison dont les fenêtres crépitaient de mousqueterie, comme une grande pièce de feu d'artifice. Cette vaste et solide maison, à cheval sur le rempart, avec portes sur la ville et portes sur la campagne, s'appelait la caserne de la Merced. Pleine de troupes et recevant sans cesse des renforts du dehors, elle arrêtait depuis le matin la colonne Parseval et allait bientôt arrêter la colonne Lainé.
Une grande porte faisait face à la rue par laquelle nous arrivions.
Cette porte était, bien entendu, fermée; nous amenâmes dans son axe une pièce d'artillerie et lui envoyâmes un obus. Dans la fumée du coup de canon mêlée à l'espèce de brouillard qui régnait encore, nous crûmes la porte renversée et nous nous précipitâmes en avant, mais en approchant nous découvrîmes que la maudite porte était intacte, et nous dûmes nous rejeter à l'abri dans des rues latérales, car, en un instant, toute notre tête de colonne, dont six ou sept officiers, était tuée ou blessée.
Nous nous mîmes alors, sapeurs, artilleurs, marins, à pousser une barricade en travers de la rue pour y mettre en batterie du canon et abattre pour de bon la porte avant de recommencer l'attaque. Mais sur ces entrefaites l'amiral arriva et les grands chefs conférèrent avec lui.
Considérant que la moitié des équipages était à terre, que le moindre changement de temps pouvait les empêcher de se rembarquer, considérant que le but que s'était proposé l'amiral était atteint, ordre fut donné de se rembarquer.
Le retour se fit sans difficulté hors le dernier moment, quand il ne restait plus sur le môle que l'amiral et quelques officiers. On entendit alors en ville un grand bruit d'acclamations et d'instruments guerriers.
C'était Santa Anna qui arrivait pour jeter les Français dans la mer.
Il déboucha, à cheval, sur le môle, à la tête de ses hommes. Mais les chaloupes des frégates restées de chaque côté du môle tirèrent à mitraille sur cette tête de colonne et jetèrent tout par terre, Santa Anna et le reste. Quelques fanatiques coururent néanmoins jusqu'au bout du môle, pour fusiller l'amiral à bout portant, et il courut là un grand danger. Son patron et l'élève de corvée Raina Dufrétay (mort amiral et sénateur) le couvrirent de leur corps et furent grièvement blessés. Son secrétaire, qui l'accompagnait avec un fusil à deux coups, fit coup double sur deux Mexicains. Là aussi fut tué un grand ami à moi, un jeune homme charmant et plein d'avenir, Chaptal, élève de première classe.
Sachant combien je lui étais attaché, on me remit comme souvenir ses aiguillettes, que j'envoyai à sa famille.
Rentré à bord de la Créole, où je rapportais deux de mes aspirants grièvement blessés : Magnier de Maisonneuve et Gervais, l'amiral me donna l'ordre d'envoyer de cinq en cinq minutes un obus à la caserne de la Merced.
Ainsi se termina pour moi la journée où je perdis ma virginité de soldat. L'action militaire de la campagne était finie, le fort de
Saint-Jean-d'Ulloa restait entre nos mains comme garantie.
À la diplomatie d'achever l'œuvre.
(Prince de Joinville, Vieux Souvenirs.)
(Calmann Lévy éditeur.)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Retour_des_cendres
Le retour des cendres
(1840)
Le jeudi 15 octobre, les restes mortels de Napoléon furent remis, à Sainte-Hélène, entre les mains des représentants de la France. Le convoi partit de la Vallée du Tombeau pour regagner le port de James-Town, où se trouvaient mouillées les frégates la Belle-Poule, l'Oreste et la Favorite.
TOUTES les maisons étaient closes, les rues désertes; les fenêtres seules et les terrasses étaient garnies de spectateurs silencieux, la plupart en deuil; la cérémonie reçut alors son caractère auguste et solennel de réparation : de toutes parts les honneurs royaux étaient déployés pour celui qui avait reçu si longtemps, si stoïquement, avec une fierté si noble, l'insulte et l'outrage.
Le ciel, devenu d'azur, semblait illuminé par un reflet du soleil d'Austerlitz ; à la fin, le même homme à qui l'Angleterre accordait à peine le titre de général! l'Angleterre le saluait empereur et roi.
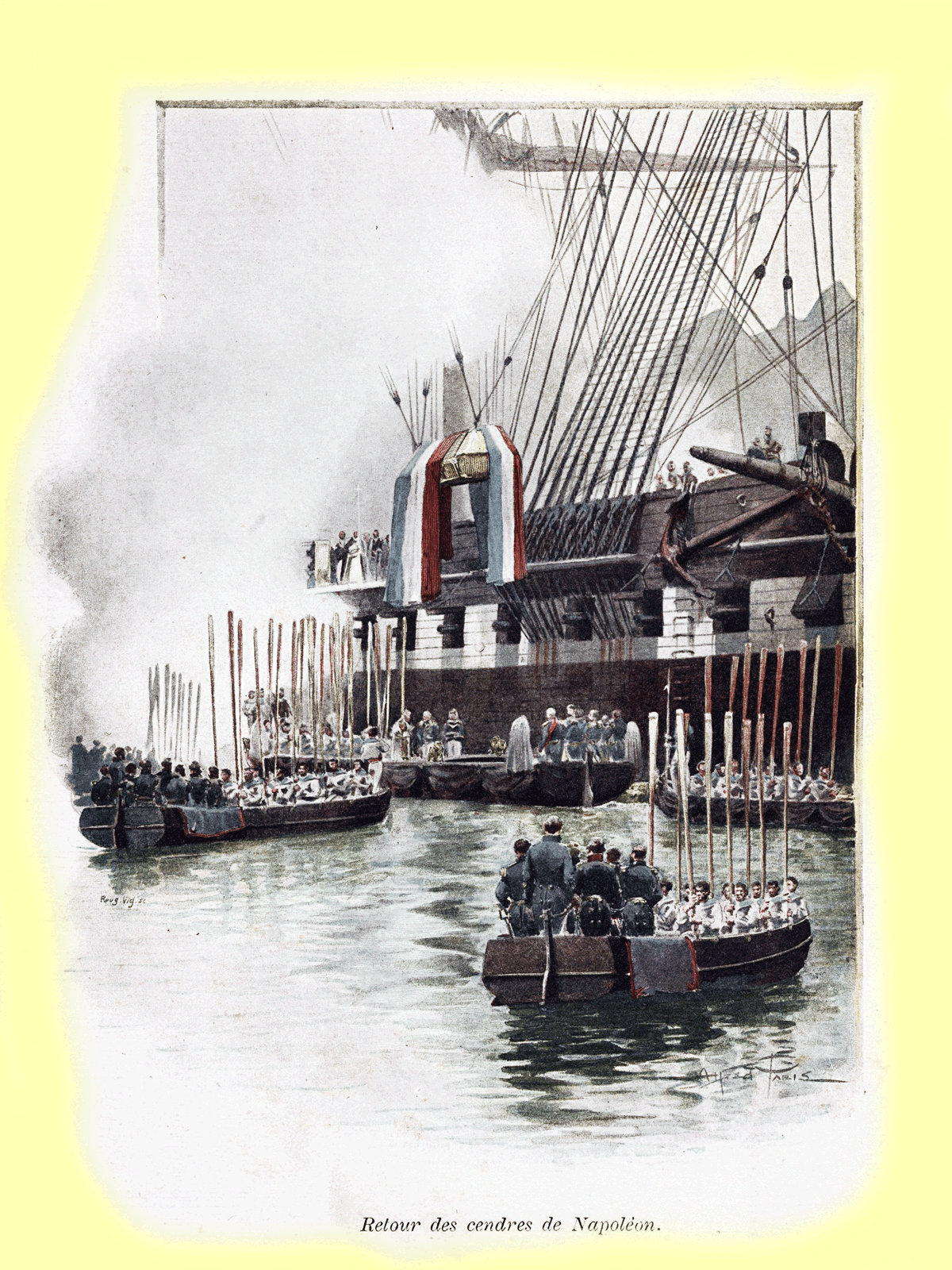 Le cortège aperçut bientôt les brillants états-majors des corvettes, en costume à la fois sévère et riche, bleu et or, et le jeune prince de Joinville, qui attendait les restes de l'Empereur avec autant d'émotion que de patience et de modestie. La musique du prince exécuta des harmonies funèbres. L'abbé Coquereau vint se placer sur les devants et offrit de l'eau bénite au jeune chef de l'expédition; c'est alors que le gouverneur anglais fit sa remise officielle des restes mortels de l'empereur Napoléon. Pendant ce temps, les chaloupes, décorées d'aigles et d'ornements noirs, avaient accosté le quai; quelques minutes après, le cercueil y était descendu.
Le cortège aperçut bientôt les brillants états-majors des corvettes, en costume à la fois sévère et riche, bleu et or, et le jeune prince de Joinville, qui attendait les restes de l'Empereur avec autant d'émotion que de patience et de modestie. La musique du prince exécuta des harmonies funèbres. L'abbé Coquereau vint se placer sur les devants et offrit de l'eau bénite au jeune chef de l'expédition; c'est alors que le gouverneur anglais fit sa remise officielle des restes mortels de l'empereur Napoléon. Pendant ce temps, les chaloupes, décorées d'aigles et d'ornements noirs, avaient accosté le quai; quelques minutes après, le cercueil y était descendu.
À six heures on poussa au large, les trois couleurs parurent à la tête du mât, un immense éclair illumina l'horizon, une ligne de feu sillonna les flancs de la Belle-Poule, de l'Oreste et de la Favorite. On y répondit de toutes parts : cent coups de canon annoncèrent enfin que tu nous appartenais de nouveau, ô toi, notre maître et le maître de l'avenir, sublime Empereur!
La marche des canots fut lente, et trois fois, pendant le trajet, des bordées de cent coups de canon les saluèrent.
Le cercueil, couvert du manteau impérial, entouré d'intrépides officiers dans la tenue d'une grave cérémonie, d'un prêtre en habits sacerdotaux, présentait un noble spectacle au milieu du calme de la mer ; les derniers feux du soleil rougissaient les flots. On présenta les armes, le tambour battit aux champs, et le cercueil, porté par nos matelots, fut placé sur les deux panneaux comme sur une estrade ; puis le prêtre prononça à la clarté des torches les prières de l'absoute. Il était sept heures.
La cérémonie religieuse terminée, l'arrière de la frégate fut interdit à tous; on n'y laissa que quatre sentinelles d'honneur, qui étaient relevées d'heure en heure ; les officiers de quart, en grand uniforme, y demeurèrent seuls.
Le corps resta toute la nuit en chapelle ardente sur le pont de la frégate.
L'autel était dressé sur des aigles ; il était adossé au mât d'artimon, entouré de panneaux de velours aux ornements d'argent. On y arrivait par quatre marches couvertes de tapis noirs. Là était un trophée militaire magnifique ; des cyprès, des palmes, des lauriers, des haches d'abordage, des canons, des piles de boulets, des faisceaux d'armes se remarquaient aux deux côtés. Au pied de l'autel, posé sur un drap de velours noir, à la croix blanche bordée d'un galon, s'élevait le catafalque, couvert de ses riches draperies de deuil, et portant sur un coussin une couronne voilée. Des cassolettes entretenues avec soin laissaient échapper incessamment la fumée de l'encens. Trente fanaux et des bougies supportées par des ifs d'argent éclairaient cette scène. Le silence le plus profond régna bientôt sur le pont, où l'on n'entendit plus que le pas mesuré et uniforme des factionnaires, le sifflement de la brise dans les cordages.
Le vendredi 16 fut fixé pour la cérémonie religieuse à bord.
À sept heures, les vergues de la Favorite, de l'Oreste, des deux bâtiments de commerce la Bonne-Aimée, de Bordeaux, capitaine Gillet, et l'Indien, du Havre, capitaine Turketill, furent mises en pantenne,
Pantene:
Apiquer les vergues en pantenne c'est quand elles sont apiquées à contre les unes des autres
c'est-à-dire celles d'un mât d'un bord et celles d'un mât voisin de l'autre bord : on dit dans ce cas que les vergues sont en pantenne.
Apiquer les vergues en pantenne est aussi un signe de deuil.
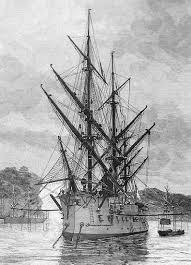 et aussitôt de nombreuses embarcations portèrent à la frégate tous les officiers présents et près de deux cents matelots de divers équipages.
et aussitôt de nombreuses embarcations portèrent à la frégate tous les officiers présents et près de deux cents matelots de divers équipages.
Le tambour rappela dans la batterie et sur le pont. M. Touchard assigna à chacun son poste : du grand mât au gaillard d'avant, huit cents hommes, tête nue, en ligne serrée ; du cabestan au grand mât, tous les états-majors en grande tenue, le consul de France avec les deux capitaines des bâtiments de commerce, leurs seconds et leurs passagers. M. le prince de Joinville était devant le cabestan, et avait à sa droite M. Hernoux, à sa gauche M. de Chabot. Le catafalque était sur une estrade; aux coins, Messieurs de la mission ; sur le même plan, les quatre plus anciens maîtres de la division ; un peu en arrière, les serviteurs de l'Empereur, formant la haie, soixante hommes en armes, commandés par les lieutenants de vaisseau Guillou et Pénaros ; au pied du mât d'artimon, l'autel, richement orné ; la musique était groupée sur la dunette. La frégate a conservé ses pavois : au grand mât flottait le pavillon impérial. À dix heures, un coup de canon fut tiré ; les tambours roulèrent, et la musique commença une marche funèbre. L'abbé Coquereau s'avança alors, précédé de la croix et des flambeaux, jusqu'au pied de l'autel, où il célébra la messe des morts.
De minute en minute, la Favorite et l'Oreste se renvoyaient le feu de leurs batteries.
À l'élévation, au moment où le prêtre, recueilli en lui-même, s'adresse seul à Dieu, la voix de l'officier traversa le silence, et les soldats présentèrent les armes, les tambours battirent aux champs : mille hommes tombaient à genoux. Le ciel était magnifique; la mer calme, étincelante de ses riches couleurs ; l'air parfumé d'encens, de mélodies. Les prières de l'absoute récitées, le prêtre répandit l'eau sainte ; le jeune prince l'imita, et tous les assistants, selon leur rang, vinrent accomplir la même cérémonie. Le cercueil fut ensuite descendu dans l'entrepont, où une chapelle ardente était préparée.
C'est là qu'il est resté jusqu'au moment du transbordement â Cherbourg.
Lorsque le procès-verbal fut arrêté, dans la matinée du samedi 18, la frégate quitta le mouillage dès huit heures du matin, immédiatement après le retour de M. de Chabot. Les trois bâtiments marchèrent quelque temps de conserve ; mais bientôt l'Oreste prit la route de la Plata.
On s'éloigna de la terre vent arrière, et poussée par des brises molles. Aussi l'île resta longtemps en vue. On remarqua encore les arêtes de Barnes' Point, désignant, comme on l'a dit, dans un profil colossal, les traits si connus de l'Empereur. Cette singularité frappa de nouveau tout l'équipage.
La navigation se continua sans événement remarquable jusque sous l'équateur. La prière des morts était récitée chaque matin ; M. l'abbé Coquereau célébrait la messe toutes les fois que l'état de la mer le permettait. Il ne cessa de régner à bord un sentiment parfait des plus hautes convenances.
Ce sentiment n'était pas seulement inspiré par le devoir, mais par l'émotion qui gouvernait tous les cœurs.
L'équipage ne reçut de nouvelles d'Europe que le 2 novembre. Ce fut la Favorite qui les lui communiqua. Ces nouvelles étaient tirées d'un journal hollandais à la date du 7 octobre ; on y parlait de tous les bruits de guerre qui agitaient la France, on y parlait de la tentative du prince Louis. Que faire alors, si l'Angleterre voulait reprendre une seconde fois son captif? « Il faudrait, disait le prince, s'abîmer dans la mer et partager en braves gens la dernière sépulture de l'Empereur.
À cette proposition de leur chef, nos soldats répondirent par un vivat! La Favorite se sépara de nouveau de la Belle-Poule. Des dispositions furent arrêtées par les officiers de l'équipage, et une raie blanche de batteries sut donner un nouvel aspect à la frégate.
Les chambres des membres de la mission disparurent, et furent remplacées par six canons de trente ; les parcs furent garnis de boulets ; les branle-bas de combat furent multipliés. Enfin tout fut mis sur un pied qui rendait la surprise impossible.
Braves gens, tous disposés à suivre dans les flots leur jeune capitaine et leur vieil Empereur.
Mais cette fois l'Hôtel royal des Invalides pouvait compter sur son hôte immortel. Les vents furent propices ; la guerre s'arrêta, comme pour ne pas troubler ce grand voyage. Enfin le dimanche 29 décembre, à six heures du soir, la frégate reconnut les feux du port et les lumières de la ville de Cherbourg.
Le lundi, jour suivant, le bateau à vapeur la Normandie s'avança au-devant de la Belle-Poule pour la remorquer ; mais la frégate, secondée par une bonne brise, arriva sans secours en rade, et à cinq heures dix minutes du matin, après quarante-deux jours de traversée, le navire funèbre entrait dans le bassin du port, salué par toute l'artillerie des remparts, à laquelle répondaient au loin le fort Royal, le fort du Hornet, et le fort de Querqueville.
L'équipage passa plus d'une semaine à Cherbourg, au milieu de l'attendrissement général. C'était à qui pourrait saluer le catafalque impérial ; religieux empressement d'un peuple qui devait à l'Empereur un demi-siècle de glorieux souvenirs. Près de cent mille âmes vinrent ainsi s'agenouiller auprès du cercueil. Les préparatifs de l'inhumation terminés à Paris, l'ordre vint de se mettre en route.
Le départ fut fixé au 8 décembre.
Le 7 au soir, un autel fut élevé au pied du mât d'artimon ; le pont couvert de tentures funèbres ; le cercueil y fut déposé le 8 au matin. La frégate se couvrit de ses pavois ; une messe solennelle précéda le transbordement.
À neuf heures, les troupes se rangèrent en bataille dans le port, que remplissaient déjà les populations.
Les autorités, le clergé montèrent à bord ; la Normandie présenta l'arrière à la coupée. Dix heures étaient l'heure indiquée pour la cérémonie ; mais la pluie rendit impossible le service religieux; on sonna seulement l'absoute.
Le cercueil de l'Empereur fut alors retiré de la chapelle ardente, et descendu à bord de la Normandie. Au même moment tous les forts et le stationnaire saluèrent d'une salve de mille coups de canon les glorieux restes.
Le cercueil fut immédiatement replacé sous un catafalque élevé au milieu du gaillard d'arrière. Ce catafalque, qui se composait d'un dôme plat soutenu par douze colonnes, était tapissé de velours à frange d'argent, entouré de lampes funèbres ; à la tête, une croix dorée ; au pied, une lampe dorée ; à l'arrière, un autel tendu de noir, une aigle d'argent à chacun de ses angles.
Lorsqu'au milieu d'un silence plein de respect et d'inquiétudes, le cercueil eut changé de navire, on partit pour la grande rade. Le tambour battit une marche funèbre ; la musique militaire éclatait en lamentations et en sanglots, les troupes présentaient les armes ; le canon retentit, les drapeaux s'inclinèrent ; la Normandie, suivie de deux autres bâtiments à vapeur, défilait lentement, couverte du pavillon impérial. Son commandement était remis à M. de Mortemart, capitaine de corvette. La foule était sur les quais, sur la plage, sur la digue, immobile, silencieuse, éperdue !
L'amiral Martineng, le préfet du département, le maire, avaient improvisé une digne réception ; Cherbourg, qui devait tout à l'Empereur, avait voulu donner un éclatant souvenir à sa mémoire.
Une couronne d'or, votée par le conseil municipal, fut déposée sur Le cercueil.
Le prince de Joinville, la mission de Sainte-Hélène et les officiers de la Belle-Poule étaient à bord de la Normandie, ainsi que la musique et cent marins de la frégate. Deux cents autres montèrent sur le Véloce et cent sur le Courrier.
La fumée tourbillonna, la mer écuma sous les roues, des points lumineux parurent, des tonnerres retentirent. La ville, le port, la rade, la digue, les forts, croisèrent leurs feux. Mille coups de canon annoncèrent que l'Empereur rentrait dans sa ville capitale à tout jamais.
La flottille s'avança rapidement dans la Manche, sans perdre de vue les côtes de France, où toutes les populations étaient accourues. Le Courrier et le Véloce étaient commandés, l'un par M. Gaubin, l'autre par M. Martineng, neveu de l'amiral. La mer était bonne, la nuit calme et sereine.
À dix heures du soir, on était en vue des feux du Havre. Le lendemain, à six heures du matin, la Normandie filait lentement le long des jetées. Le soleil rougissait de ses premiers feux. Un ciel magnifique, et, malgré l'heure matinale, autorités, légions de la garde nationale, régiments de ligne, clergé en habit de chœur, peuple en habit de fête, artillerie manœuvrant ses pièces, couvraient la plage, « et ce dut être pour cette foule avide, dit l'abbé Coquereau, un spectacle bien imposant que ce passage, au lever de l'aurore, du bateau funéraire. On ne nous avait pas vus venir ; il semblait que nous surgissions de l'océan. »
« Nous entrions en Seine ; notre flottille allait parcourir les rives que l'Empereur avait choisies pour le lieu de sa dernière demeure. Dès ce moment commença une marche vraiment triomphale : le temps était froid décembre, avec son givre glacial, son vent du nord qui dessèche et flétrit, faisait ressentir son action dans nos campagnes. Nous devions les trouver tristes et désolées, et jamais rives d'un fleuve ne furent plus brillantes de parure et d'animation. C'était une nature vivante, car des rives partaient des voix, des cris, qu'elles se renvoyaient alternativement.
Dans les villes, tout était noble, réglé avec soin ; il y avait eu convocation : municipalité, armée, milice citoyenne, prêtres chantant les cantiques des morts ; les volées des cloches et du canon : tout était bien. Rien ne manquait sans doute à cette grande solennité.
« Mais combien plus touchant ce désordre sublime des campagnes, cette spontanéité de cœur qui révèle la sincérité de l'homme vrai, naïf, grand alors, admirable dans son expression ! Le paysan avait tiré de son bahut l'habit des fêtes chômées ; il avait décroché de la crémaillère, où elle était suspendue au-dessus de l'âtre, sa vieille carabine. Depuis le temps où elle avait envoyé la mort au soldat de Wellington, elle était demeurée oisive et sans voix ; mais ce jour, sur notre passage, elle éclatait et promettait encore au pays, entre les mains de ce soldat en sabots, qu'elle éclaterait plus fort au jour de l'attaque et de la défense. Puis c'était un pêle-mêle de femmes, d'enfants, de vieillards ; les femmes se signaient, en faisant tourner sur leurs mains rougies par le froid les grains luisants de leurs chapelets ; les vieillards tombaient à deux genoux sur la terre glacée et priaient en se souvenant : ils avaient combattu sous lui. Les enfants restaient un instant ébahis, ouvrant leurs grands yeux, où l'âme, à cet âge, se peint encore ; puis, prenant leur course, ils remontaient avec nous la Seine : ils espéraient voir l'ombre du héros avec les merveilles duquel on avait bercé leur enfance ; puis c'étaient des cris, des acclamations, hommages derniers à la mémoire de l'Empereur. »
(Relation ajoutée au Mémorial de Sainte-Hélène.)
Affaire de Tanger et de Mogador
(1844)
Au mois de juin, il me survint des occupations plus sérieuses.
Je fus nommé au commandement d'une escadre envoyée sur les côtes de l'empire du Maroc, où de graves événements, intéressant à la fois la consolidation de notre conquête algérienne et nos relations internationales, étaient à la veille de se passer. Abd-el-Kader, aux abois depuis le coup terrible porté à son prestige par la prise de la smalah, jouait en désespéré sa dernière partie. Il avait de nouveau soulevé contre nous et la haine de l'envahisseur et le fanatisme musulman.
Partout nous étions obligés de combattre, et pendant que mon frère Aumale avait du côté de Constantine des engagements très vifs dans un desquels mon frère Montpensier fut blessé, le général Bugeaud était en lutte de tous les jours avec les tribus guerrières de la province d'Oran.
Ces tribus, repoussées, passaient la frontière du Maroc, formée par la rivière Moulouia, devant laquelle nos troupes devaient s'arrêter par respect pour les susceptibilités européennes, et échappaient ainsi au châtiment.
De cet arrêt de notre poursuite, nos adversaires concluaient que nous n'osions pas affronter la colère de l'empire du Maroc, ou bien que les puissances européennes, et en particulier celle dont le pavillon flottait sur Gibraltar, garantissaient le sol marocain de toutes atteintes. Ce sol devenait alors une sorte de citadelle d'où l'on pouvait tout tenter contre nous, sans crainte de représailles.
Il en résultait des irruptions continuelles, auxquelles prenaient part, non seulement les fanatiques du Maroc, mais aussi, sous le couvert de l'anonyme, les propres soldats de l'empereur, rassemblés, sous prétexte d'observation, à deux pas de la frontière, irruptions qu'il devenait à la longue insupportable d'avoir sans cesse à repousser au prix de précieuses existences.
Cette situation ne pouvait durer : le Gouvernement français résolut d'y mettre un terme, et son premier acte fut l'envoi de l'escadre que j'avais l'honneur de commander.
Je devais sommer l'empereur du Maroc de retirer à Abd-el-Kader la protection qu'il lui avait jusqu'ici accordée, de ne pas permettre à nos ennemis d'organiser sur son territoire des expéditions contre nous, et enfin de réduire h une simple force de police le rassemblement considérable, menaçant par son nombre et son attitude, qu'il avait réuni à la frontière. Faute d'un prompt acquiescement à ces demandes, je devais, pendant que le général Bugeaud emploierait la force sur terre, l'employer de mon côté sur mer, afin de contraindre Mulai Abderrahman à s'y soumettre.
Seulement il m'était expressément recommandé de pousser la longanimité jusqu'aux dernières limites, et, si nous étions obligés d'agir, de déclarer bien haut qu'aucune pensée de conquête ne nous animait.
Pendant ce temps j'organisais à Toulon ma petite escadre, à laquelle on avait adjoint environ 1200 hommes de troupes de débarquement, et j'expédiais mes navires, à mesure qu'ils étaient prêts, à Oran, comme point de rendez-vous.
Après avoir rallié mon monde à Oran, et être entré en communication avec le général Bugeaud, je me rendis droit à Gibraltar, pour conférer avant tout avec les autorités anglaises, et prendre nettement et loyalement l'initiative de toute explication qu'elles auraient pu me demander sur mes intentions pacifiques ou belliqueuses, et sur le rôle que nous réservions aux neutres. Disons de suite que, dès le premier jour et pendant toute la campagne, je n'eus qu'à me louer sans réserve des rapports que j'eus avec les commandants des forces navales anglaises, l'amiral Owen, les capitaines Lockyer et Provo Wallis en particulier.
Nos relations ont toujours été franches, cordiales, straight forward, disaient les Anglais, et par suite très agréables. Il n'en a pas été de même de mes rapports avec le gouverneur de Gibraltar, le général Sir Robert Wilson, un ennemi acharné de la France.
Nature chevaleresque à ses heures, mais passionnée, agité, incapable de se tenir tranquille, Sir Robert avait vu dans son gouvernement de Gibraltar, non seulement un grand commandement militaire, mais un poste d'action politique, et toute cette action, il l'avait tournée, par le Maroc, contre notre conquête d'Algérie, c'est-à-dire contre la France. Ses allées et venues de Gibraltar à la côte voisine étaient connues de tous ; son journal, le Gibraltar Chronicle, rédigé par son secrétaire colonial, se faisait l'écho de tout ce qui pouvait abaisser la France, dénigrer nos armées, exciter contre nous.
L'exportation des armes, des munitions de guerre à Tétouan ou autres villes marocaines se faisait ouvertement sous ses yeux.
Enfin il était facile de faire remonter à lui, en grande partie, la confiance dans l'impunité qui rendait le gouvernement de Mulai Abderrahman si hostile dans sa conduite à notre frontière, si insolent dans ses réponses à nos agents diplomatiques.
Tel était le personnage avec qui j'eus principalement affaire dès le début de ma mission.
En arrivant, ma première démarche fut vis-à-vis de lui, et je me rendis au Convent, comme s'appelle sa résidence, en grande tenue, accompagné des capitaines de l'escadre. Il me reçut avec une politesse voisine de l'obséquiosité, et me parla aussitôt des dangers qu'il entrevoyait à la présence de mon escadre sur la côte, devant les villes du Maroc, danger enfin pour la paix générale, à cause des conflits qui ne manqueraient pas de se produire, danger d'exciter encore davantage les passions belliqueuses des musulmans, dangers pour la sécurité des chrétiens, des Européens, des consuls établis au Maroc, danger enfin pour M. Hay, le consul général d'Angleterre, qui venait justement de partir, pour porter en personne à l'empereur Mulai Abderrahman des conseils de modération.
« Mais, mon général, répondis-je, je ne demande pas mieux que de ne pas aller avec mes vaisseaux à Tanger, ni sur aucun point de la côte du Maroc, pendant qu'on négocie. Nous sommes las de la situation que les insolences et les hostilités marocaines nous font à notre frontière ; nous allons présenter un ultimatum destiné à y mettre un terme ; nous donnerons un délai pour y répondre, au bout duquel, suivant la réponse, nous irons à Tanger pour punir ou pardonner.
D'ici là, nous serons heureux de tous les efforts faits pour calmer les esprits et aider à l'acceptation de nos justes demandes. D'ici là, je suis prêt à ne pas conduire l'escadre sur la côte marocaine, mais à une condition, c'est que les vaisseaux anglais n'y paraîtront pas non plus. Nous ne souffrirons pas que nos affaires soient traitées, qu'il s'agisse de protection ou d'intimidation, sous le canon d'une escadre étrangère. Si donc, vous et les autorités maritimes, me promettez que vos vaisseaux n'iront pas à Tanger, je mène l'escadre à Cadix, sans toucher à cette dernière ville, et j'attends là une réponse à notre ultimatum. Il est entendu que je n'ai aucune opposition à ce que vos bâtiments légers aillent sur la côte pour la protection de vos nationaux, les miens iront également. »
Ce que j'avais proposé à Sir Robert se réalisa. Il me fut promis que les vaisseaux anglais ne se présenteraient pas devant Tanger, et, de mon côté, je conduisis l'escadre à Cadix, pendant que M. de Nion, notre consul général, expédiait notre ultimatum à Moulai Abderrahman. Puis il s'écoula une longue période d'incertitudes.
Des vaisseaux arrivèrent directement d'Angleterre à Tanger.
Informé, je mis aussitôt à la voile pour les y suivre, mais les autorités de Gibraltar les avaient déjà rappelés quand j'y arrivai : je retournai donc Cadix.
Les réponses à notre ultimatum arrivèrent fâcheuses ; le gouvernement marocain refusait de dissoudre le rassemblement de troupes que le général Bugeaud avait devant lui et réclamait même la punition du général qui, en poursuivant les bandes venues pour l'attaquer, avait plusieurs fois violé la frontière.
Rien sur Abd-el-Kader, le sujet principal de nos réclamations.
Devant ces nouvelles, nous aurions pu agir de suite, mais il fallait auparavant pourvoir à la sécurité de nos consuls et de nos nationaux, que le premier coup de canon tiré pouvait livrer à tous les excès du fanatisme musulman. Puis il y avait la présence du consul général d'Angleterre auprès de l'empereur du Maroc, et si ce consul n'avait de mission officielle du gouvernement français, il en avait certainement une officieuse ; il fallait attendre son retour.
Pour colorer nos retards, M. de Nion envoya une nouvelle sommation à Sidi Bousselam, pacha de Larrache, un homme éclairé, chargé par Mulai Abderrahman des relations avec nous.
Un nouveau délai fut fixé.
J'en profitai pour faire retirer nos consuls et j'allai de ma personne, à Tanger, procéder à l'enlèvement par surprise de notre consul général et de sa famille. Il s'en fallut d'une minute que les Marocains n'y missent obstacle. Tous les Français et protégés qui avaient retardé leur embarquement furent arrêtés ; seul un juif, arrivant à toute course et se jetant à l'eau, put encore rattraper mon canot.
Enfin, le 4 août, M. de Nion reçut une réponse inacceptable à sa dernière note : toujours « la punition du général ».
Nous n'en étions pas là.
Le 5, un aviso m'apportait la nouvelle que le plénipotentiaire anglais, M. Hay, était en sûreté sur un navire de guerre de sa nation et que sa mission avait échouée. Le 6, j'attaquai les fortifications de Tanger, en présence de navires de guerre de tous pavillons, de vaisseaux anglais comme des frégates espagnoles.
La démonstration était claire.
Aux Marocains que nous frappions, aux étrangers qui étaient présents, nous prouvions que la France entendait faire respecter sa frontière algérienne, et qu'aucune protection étrangère ne sauverait du châtiment ceux qui la violeraient.
La canonnade de Tanger fut bien plus un bombardement politique qu'une action de guerre.
Si, au début, quatre-vingts pièces répondirent à nos coups, leur feu fut rapidement éteint par le tir admirable de nos excellents canonniers. Pas un boulet ne s'écarta des embrasures de l'ennemi; pas un boulet n'atteignit les maisons, le quartier consulaire. Nos pertes furent insignifiantes; je n'en ai plus le chiffre ; je crois que nous n'eûmes que quinze ou vingt hommes hors de combat ; nos avaries nulles; mon vaisseau, le Suffren, ne reçut pas cinquante boulets dans sa coque et sa mâture (1).
Le général Bugeaud, informé aussitôt, m'écrivait peu après : « Je vous disais le 11 que l'armée ne tarderait pas à acquitter la lettre de change que la flotte avait tirée sur elle. La copie ci-jointe d'une dépêche télégraphique à Son Excellence M. le ministre de la guerre vous fera voir que nous avons tenu parole. » La dépêche contenait le récit de la bataille d'Isly, qu'il venait de livrer, et la lettre qu'il m'écrivait était datée du champ de bataille, le 14 août. Ce même 14 août, j'étais avec l'escadre devant Mogador. Des reconnaissances faites par des officiers très intelligents, le lieutenant-colonel du génie Chauchard, le capitaine de la même arme Coffinières et un capitaine de frégate, héritier d'un beau nom, le vicomte Duquesne, m'avaient décidé à choisir cette ville et son port, comme offrant à une attaque le plus de chances de succès. Une autre raison m'avait déterminé : le produit des douanes de Mogador était le principal revenu de Mulai Abderrahman.
Nous avions dissipé ses illusions à Tanger. Pendant que le général allait abattre son orgueil sur le champ de bataille d'Isly, j'allais faire un trou à sa bourse.
Le mauvais temps, la grosse mer, des avaries graves de chaînes, d'ancres brisées sur cette côte inhospitalière, nous causèrent bien des ennuis ; enfin, le 15 août, une mer plus calme et une brise favorable nous permirent d'aller prendre nos positions d'attaque devant Mogador. Bien fortifiée, pourvue d'une nombreuse artillerie et ayant eu le temps de se préparer, la ville fit une défense plus sérieuse que Tanger. Mais nous en vînmes à bout, et le feu de la place ayant été éteint par l'artillerie des vaisseaux le Suffren, le Jemmapes, le Triton et de la frégate la Belle-Poule, je fis entrer la flottille dans la passe, et jeter cinq cents hommes sur l'île qui forme le port. Le débarquement se fit sous un feu de mousqueterie très vif, mais avec un entrain admirable, les hommes blessés dans les canots sautant à terre les premiers.

Les batteries furent enlevées à la course et toute la garnison de l'île, environ quatre cents hommes, tués, noyés ou rejetés à la nuit dans une grande mosquée qui se rendit le lendemain.
Rien de pittoresque comme cette fin de combat par un soleil couchant, semblable à celui que j'ai vu peindre à Horace Vernet dans son beau tableau de la bataille de Montmirail.
Les Marocains aux costumes éclatants se retiraient, en tiraillant, vers la mosquée dont la haute tour s'élevait en silhouette vers le ciel, pendant que nos embarcations, longeant la côte sur une mer dorée, joignaient leur fusillade à l'action de nos soldats. Je me souviens qu'à ce moment je me trouvai à côté d'un jeune sous-lieutenant tout frais sorti de Saint-Cyr, M. Martin des Pallières, à qui, sur ses instances, j'avais permis de descendre à terre en volontaire, bien que sa compagnie ne dût pas débarquer. Il me montra avec fierté son bras fracassé par une balle en me disant : « Vous voyez que vous avez bien fait de me laisser venir! » Toute cette prise de l'île fut très bien menée par le colonel Chanchard et le commandant Duquesne, qui y fut blessé.
Le lendemain mon premier soin fut de renvoyer au pacha de Mogador quelques-uns des prisonniers avec la déclaration que s'il était touché un cheveu de la tête du consul anglais, de sa famille et de quelques autres Européens qu'il avait refusé de laisser embarquer avant l'attaque, je ferais passer par les armes en représailles tous les autres prisonniers. J'eus la satisfaction de recueillir ce consul et les siens et de les faire reconduire à bord de la frégate anglaise Warspite, qui suivait nos opérations. Il était temps ; car les Arabes, les Kabyles de la campagne, envahissaient la ville pour la piller, la saccager.
Le pacha débordé, n'ayant plus les moyens de maintenir l'ordre, obligé de s'enfuir, aucun chrétien n'aurait pu rester en ville sans courir les plus grands dangers.
Peu après, nous débarquâmes à Mogador même, pour y achever l'œuvre de destruction de la ville, enclouer les canons, briser les affûts, détruire les munitions de toutes les batteries de la marine, tout cela sans l'ombre d'opposition. Puis je mis une garnison dans l'île, que j'armai de canons de gros calibre, afin de tenir en respect la ville que nous ne voulions pas occuper, et je déclarai le port en état de blocus.
(1). Le prince dit dans son rapport officiel : « À dix heures du matin, tout était fini. Je suis resté avec le Suffren devant la ville jusqu'à cinq heures du soir afin de bien constater qu'on ne songeait plus à se défendre, puis je me suis retiré. Mon but était atteint du moment que, par le silence de ses batteries, cette ville se reconnaissait vaincue.
(Prince de Joinville, Vieux Souvenirs.)
(Calmann Levy, éditeur.)
Le débarquement sur la côte de Crimée
(SEPTEMBRE 1854)
LE débarquement avait été décidé pour le surlendemain ; mais dans la nuit du 12 au 15 une violente bourrasque du nord-ouest mit du désordre parmi le convoi ; pendant qu'il se ralliait, les navires armés bornèrent leur action à se montrer devant Eupatoria, qui se rendit à la première sommation.
Les alliés y trouvèrent un fort approvisionnement de grains.
Dans la soirée, les abords d'Old-fort furent examinés en détail, et des bouées, mouillées au large, jalonnèrent les lignes suivant lesquelles devaient se ranger les divisions des flottes.
La plage, parfaitement unie, d'une étendue immense, offrait deux points de débarquement très distincts, sur des bourrelets de sable limités par la mer d'une part, et de l'autre par deux lagunes, dont la plus considérable était au nord. Entre ces deux lagunes se prolongeait, sur une longueur de trois ou quatre kilomètres, une falaise haute de quelques mètres seulement : c'était la base d'un plateau qui s'élevait insensiblement vers l'intérieur, champ de tir à souhait pour l'artillerie des flottes.
Les emplacements que devait occuper chacune d'elles étaient si nettement, si distinctement indiqués par la nature et la disposition du terrain, qu'il ne pouvait y avoir entre elles, pendant l'opération même, ni confusion, ni contestation; ni difficulté, ni plus tard aucune récrimination de bonne foi. Les Anglais devaient prendre pied sur le bourrelet du nord, les Français et les Turcs — sur le bourrelet du sud.
Le contre-amiral sir Edmund Lyons, pour la flotte anglaise, le contre-amiral Bouet-Willaumez, pour la flotte française, avaient tracé le dispositif du débarquement; chaque commandant de navire était instruit de ce qu'il avait à faire.
Le 14 septembre, à deux heures du matin, le signal d'appareillage était donné; le temps était magnifique, le ciel pur, la mer belle. Les vaisseaux de ligne s'avançaient lentement, remorqués par des frégates ou des corvettes à vapeur ; à mesure qu'ils arrivaient sur les bouées d'embossage, ils laissaient tomber l'ancre et prenaient leur rang de bataille, les remorqueurs se plaçant dans les intervalles; à sept heures, tous étaient rangés à leur poste, les Anglais à gauche, les Français au centre, les Turcs à droite. Les escadres de guerre formaient ainsi quatre lignes, la première à six cents mètres environ de la plage, les autres successivement à deux cents mètres de distance.
Les lignes françaises se suivaient dans l'ordre numérique des divisions d'infanterie qui allaient être débarquées, chacune à son tour. La quatrième ligne, qui portait la quatrième division, ne fit que paraître à la place que lui assignait le plan général ; elle se remit presque aussitôt en colonne, suivie de trois frégates anglaises, pour aller distraire l'attention des Russes par un simulacre de débarquement aux embouchures de l'Alma et de la Katcha.
Un peu avant huit heures, un signal du vaisseau amiral la Ville de Paris, répété sur toute la première ligne, donna l'ordre de mettre les embarcations à la mer. Tandis que les chalands, traînés en remorque par les vaisseaux depuis la veille, venaient accoster le bord qui n'était pas vu de terre et recevaient l'artillerie de bataille, tandis que les soldats d'infanterie descendaient par groupes dans les canots, les avisos à vapeur, les grandes chaloupes armées de canon, s'approchaient de la côte pour flanquer le débarquement sur les deux ailes, précaution excellente, mais qui fut inutile, car on ne vit de tout le jour aucun ennemi paraître.
Des fanions de diverses couleurs, plantés par les soins de l'état-major général sur le sable, indiquaient à chaque brigade, à chaque régiment, à chaque bataillon, le point précis où il devait atterrir. À neuf heures, les premiers canots atteignaient la plage ; à midi, toute la première division débarquée s'avançait en ordre au-dessus de la falaise ; à trois heures, la deuxième venait se placer auprès d'elle ; à six heures, la troisième les rejoignait, et l'artillerie avait déjà 59 pièces de campagne prêtes pour le combat. Deux divisions anglaises bivouaquaient sur la gauche.
Le soleil, déclinant à l'horizon, éclairait d'une lumière empourprée un spectacle admirable ; d'un côté, sur ce plateau, la veille morne et désert, l'activité d'une vie nouvelle, tous ces hommes aux uniformes variés, aux armes étincelantes, alertes, joyeux, s'installant gaiement pour le bivouac, les tentes dressées, les feux qui s'allumaient, et plus loin, vers l'orient assombri, les grand'gardes qui s'en allaient tendre, pour la sécurité de tous, le réseau des avant-postes et la chaîne des sentinelles; de l'autre coté, les innombrables navires dessinant sur les ondulations miroitantes de la mer la silhouette de leurs flancs noirs, et sur le fond rouge du ciel la fine dentelle de leur mâture et de leurs agrès ; enfin, pour achever la mise en scène, l'accompagnement lointain du canon qu'on entendait gronder depuis le milieu du jour.
C'était la démonstration que la quatrième division française avait d'abord faite à l'embouchure de l'Alma et qu'elle prolongeait devant la Katcha ; à la nuit tombante, elle vint reprendre sa place au mouillage d'Old-fort.
Le vent s'était élevé ; dans la nuit, un orage éclata ; les soldats français, sous leurs tentes-abris, se tinrent à peu près à couvert, tandis que les Anglais, qui n'avaient pas encore leurs grandes tentes, souffrirent beaucoup de la tempête.
Le 15, au point du jour, la houle était si forte que le débarquement des trois dernières divisions anglaises, de la quatrième division française et des Turcs ne se fit pas sans difficulté ; la peine fut plus grande encore pour la mise à terre des chevaux et d'une partie du matériel, l'autre partie devant demeurer provisoirement à bord des navires.
L'opération ne fut terminée que le 16 au soir pour les Français; pour les Anglais, elle ne l'était pas encore.
Le 17, on mit à leur disposition des chalands ; cependant, malgré cette assistance, ils ne se trouvèrent prêts à marcher que dans la soirée du 18.
En touchant la terre de Crimée, le maréchal de Saint-Arnaud avait repris des forces ; le 14, il était resté six heures à cheval, visitant les bivouacs, s'assurant que les grand'gardes étaient bien placées, les petits postes dûment répartis, les sentinelles avancées à bonne distance. Il était impatient de voir l'ennemi ou d'en avoir au moins des nouvelles.
Le 15, des spahis de son escorte, en reconnaissance â cinq ou six kilomètres, avaient surpris dans un village et ramené douze soldats russes avec un sergent ; il voulut les interroger lui-même.
Pour le ravitaillement de l'armée, sinon pour le combat, les Tatars pouvaient être de précieux auxiliaires, à condition qu'on les traitât bien, qu'on respectât leurs aouls, leurs familles, leurs troupeaux; malheureusement, entraînés par les pires habitudes d'Afrique, et persuadés qu'en terre ennemie tout était de bonne prise, des zouaves avaient commis des actes de pillage et de violence dans un de ces aouls ; un autre jour, des troupeaux étaient enlevés.
Résolu à protéger les gens du pays et â maintenir une stricte discipline, le maréchal réprouva, par une flétrissure publique, « les instincts pillards de certains soldats », et commanda de faire une rigoureuse punition des coupables.
Enfin, dans les deux armées, les ordres de départ purent être donnés pour le 19 septembre.
Eupatoria restait gardée, sous le commandement supérieur du chef d'escadron d'état-major Osmont, par deux compagnies d'infanterie de marine, auxquelles pouvaient se joindre, au besoin, des matelots débarqués du vaisseau l'Iéna, laissé en station sur la rade avec un navire anglais.
Aux environs d'Old-fort devaient demeurer provisoirement un détachement de la quatrième division d'infanterie britannique et un régiment de cavalerie légère, sous les ordres du brigadier général Torrens.
Le 19, sept heures du matin, tous les autres bivouacs furent levés, et les deux armées commencèrent leur première étape dans la direction de Sébastopol.
(Camille Rousset, Histoire de la guerre de Crimée.)
(Hachette et Cie, éditeurs.)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Crim%C3%A9e
Le combat du 17 octobre 1854
LE parc de siège que nous avions apporté de Varna ne pouvait tenir tête aux pièces de gros calibre que nous opposaient les Russes. L'armée dut demander des canons plus puissants à la flotte.
Le 3 octobre, l'escadre française débarqua 19 pièces et 1100 hommes.
Au bout d'un an, des appels successifs avaient porté ce contingent à 128 bouches à feu et à 2434 hommes. L'escadre anglaise forma de son côté une brigade navale destinée à servir les premiers canons à boulets ogivaux dont il ait été fait usage.
Cette batterie prit le nom des pièces dont on l'avait armée; ce fut la fameuse batterie de Lancastre.
Comme des cavaliers qui ont mis pied à terre, les marins de la flotte assiégée et ceux de la flotte assiégeante se trouvèrent pendant onze mois face à face. L'œil constamment fixé sur la même embrasure, ils étonnèrent les deux armées par la précision de leur tir, non moins que par la constance de leur courage.
Nos travaux avaient été plus d'une fois rasés. On les avait repris avec persévérance. Le moment d'ouvrir le feu approchait. Pendant que le gros des escadres alliées restait mouillé à l'embouchure de la Katcha, l'amiral Brual, détaché devant Kamiesh, exécutait les reconnaissances qui lui avaient été prescrites, et faisait baliser les approches de la rade.
La marine et l'armée espéraient pouvoir foudroyer de concert les défenses de Sébastopol.
Le 17 octobre, nous fûmes éveillés par un feu terrible. Les batteries de siège avaient, dès les premiers rayons du jour, dégorgé leurs embrasures. Muettes jusque-là, elles essayaient pour la première fois leur puissance. Les batteries russes ripostaient avec énergie, la terre en tremblait, et l'ébranlement du sol semblait se prolonger jusqu'à bord.
Vers dix heures, tout à coup le feu cesse; nous n'avions rien prévu de semblable. Le canon de l'armée se taisait au moment où celui de la flotte allait parler.
Déjà en effet accourait du mouillage de la Katcha l'escadre de l'amiral Hamelin.
Une brume épaisse l'avait jusqu'alors dérobée à nos yeux. Nous nous hâtons. Les vaisseaux à voiles et les frégates à vapeur s'accouplent; les vaisseaux à hélice appareillent. La corvette le Pluton éclaire la route; le Charlemagne et le Montebello arrivent les premiers sous le canon des forts. Des boulets ont fait jaillir l'eau près de nous. Une forte secousse ébranle le vaisseau. C'est un obus qui vient de traverser la dunette sous les pieds mêmes de l'amiral.
D'autres obus sifflent dans la mâture ou frappent à la flottaison.
Des boulets rouges ont mis trois fois le feu à bord. Debout sur les parapets, les canonniers russes rechargent leurs pièces. Nous jetons l'ancre enfin, et travaillons à nous embosser.
Les escadres alliées se développent lentement sur deux rangs endentés.
Quatorze vaisseaux français, dix vaisseaux anglais et deux vaisseaux turcs forment autour des fortifications de Sébastopol un double croissant qui s'étend des batteries de la Quarantaine aux batteries du Télégraphe. On se bat au milieu d'une fumée intense. L'Agamemnon, que monte l'amiral Lyons, a pénétré dans un des replis du récif qui défend, mieux encore que les feux croisés des deux rives, l'entrée de la rade de Sébastopol.
Il mouille à 760 mètres du fort Constantin.
Le Sans-Pareil et le London ont suivi l'Agamemnon.
Cette division se trouve assaillie par des feux plongeants; elle appelle bientôt de nouveaux vaisseaux à son aide.
Le Rodney le premier répond à ce signal ; malheureusement il va donner sur l'extrémité du récif. L'Albion, le Queen, le Bellérophon, se sont approchés à leur tour.
Vigoureusement attaqué par les vaisseaux anglais et par quelques-uns des vaisseaux de notre aile gauche, le fort Constantin chancelle sous ses trois étages de batteries.
Les hauteurs du Télégraphe n'en font pas moins pleuvoir sur le détachement que commande l'amiral Lyons une grêle de projectiles. La moitié de la flotte anglaise ne peut plus avoir qu'une pensée : sortir du mauvais pas où l'audace de son chef l'a conduite. Des frégates se dévouent et enlèvent le Rodney du banc sur lequel, au début de l'action, ce vaisseau s'est échoué. Aucun trophée ne restera entre les mains de l'ennemi, mais ce n'est pas de ce côté que le feu des Russes sera éteint.
Le Charlemagne, le Montebello, le Friedland, la Ville de Paris, le Valmy, le Henri IV, le Napoléon, ont attaqué les forts du sud. Ils sont appuyés par l'Alger, le Jean-Bart, le Marengo, la Ville-de-Marseille, le Suffren, le Bayard, le Jupiter, qui tirent dans les créneaux de la première ligne.
Belle photographie du Montebello, vaisseau de premier rang français nommé ainsi en hommage à Jean Lannes, Maréchal d'Empire, et Duc de Montebello.
Le Montebello était un vaisseau de type 118 canons de Sané. Lancé à Toulon le 6 décembre 1812, il est motorisé en 1851, participe à la guerre de Crimée en Mer Noire en 1855 avant d'être désarmé en 1857 puis réarmé en 1860 afin de servir de navire école pour les canonniers. Il est à nouveau désarmé en 1865 puis rayé des listes le 25 juin 1867, après 55 ans de bons et loyaux services rendus à la Marine française.
https://fr-fr.facebook.com/TroisPonts/photos/a.458341244209904/1359161254127894/?type=3&theater
Les hauts-fonds dont la ligne d'embossage a du suivre le contour ont obligé notre escadre à jeter l'ancre à 1800 mètres environ des batteries de la Quarantaine.
Malgré la distance, qui enlève à notre tir une partie de son efficacité, la défense sur la rive méridionale paraît à peu près réduite. Vers quatre heures, le feu reprend avec une vivacité nouvelle; les bastions mêmes de la place se joignent aux batteries du bord de la mer. Les bombes, les obus pleuvent autour de nous. L'ennemi heureusement ne peut apercevoir que la pointe de nos mâts, qui surgissent comme des balises au-dessus d'un océan de fumée; ses coups portent trop haut. Le nuage protecteur qui nous environne ne lui permet pas de les rectifier; si ce nuage se dissipait, si les Russes abaissaient de quelques degrés leur tir, notre position deviendrait critique. Les boulets ne cessent de siffler au-dessus de nos têtes, bien peu s'enfoncent dans les flancs de nos navires. Sous le canon des Russes dès midi et demi, embossés vers une heure, nous n'avons pas eu à bord du Montebello trente minutes de combat sérieux.
Les vapeurs opaques étendues autour des deux flottes ont aussi envahi le ciel. Le soleil apparaît à travers ce brouillard comme un globe de sang. Nous le voyons descendre lentement vers l'horizon et annoncer la fin prochaine du jour; nous n'attendons que ce moment pour nous éloigner.
Les vaisseaux anglais, plus maltraités que les nôtres, ont déjà commencé leur mouvement de retraite.
L'impunité relative dont nous avons joui et un meilleur succès ne nous abusent pas sur le résultat de nos efforts.
Lorsque nous nous serons retirés, l'ennemi n'aura qu'à relever ou à remplacer ses pièces démontées, ses terrassements seront intacts; l'enjeu n'est pas égal : nous engageons dans la partie un capital de 50 ou 60 millions, les Russes en seront quittes pour quelques pelletées de terre.
(La Marine d'aujourd'hui, par Jurien de la Gravière.)
(Hachette et Co, éditeurs.)
https://en.wikipedia.org/wiki/French_frigate_S%C3%A9millante_(1841)
La perte de la "Sémillante"
dans le détroit de Bonifacio
(1855)
C’était un trois mâts à coque de bois fort bien armé. La Sémillante était l'une des 27 frégates de 60 canons construites de 1822 à 1849, les dernières étant équipées de machines à vapeur. Longue de 54 m et large de 14 m, elle représentait l'aboutissement de trois siècles de recherches en architecture navale. Mise sur cale à Lorient le 19 mars 1827, elle ne fut lancée que 14 ans plus tard, le 16 février 1841.
« ... Comment la chose s'est passée, me répondit le bon Lionetti avec un gros soupir, hélas !
Monsieur, personne au monde ne pourrait le dire. Tout ce que nous savons, c'est que la Sémillante, chargée de troupes pour la Crimée, était partie de Toulon, la veille au soir, avec le mauvais temps. La nuit, ça se gâta encore. Du vent, de la pluie, la mer énorme comme on ne l'avait jamais vue.... Le matin le vent tomba un peu, mais la mer était dans tous ses états, et cela avec une sacrée brume du diable à ne pas distinguer un fanal à quatre pas....
Ces brumes-là, monsieur, on ne se doute pas comme c'est traître. Ça ne fait rien, j'ai idée que la Sémillante a dû perdre son gouvernail dans la matinée, car il n'y a pas de brume qui tienne ; sans une avarie, jamais le capitaine ne serait venu s'aplatir ici contre. C'était un rude marin, que nous connaissions tous. Il avait commandé la station en Corse pendant trois ans, et savait sa côte aussi bien que moi, qui ne sais pas autre chose.
— Et à quelle heure pense-t-on que la Sémillante a péri?
— Ce doit être à midi ; oui, monsieur, en plein midi....
Mais, dame! avec la brume de mer, ce plein midi-là ne valait guère mieux qu'une nuit noire comme la gueule d'un lion.... Un douanier de la côte m'a raconté que ce jour-là, vers onze heures et demie, étant sorti de sa maisonnette pour rattacher ses volets, il avait eu sa casquette emportée par un coup de vent, et qu'au risque d'être enlevé lui-même par la lame, il s'était mis à courir après, le long du rivage, à quatre pattes. Vous comprenez, les douaniers ne sont pas riches, et une casquette, ça coûte cher. Or il paraîtrait qu'à un moment notre homme, en relevant la tête, aurait aperçu tout près de lui, dans la brume, un gros navire à sec de toile qui fuyait sous le vent du côté des îles Lavezzi. Ce navire allait si vite, si vite, que le douanier n'eut guère le temps de bien voir. Tout fait croire cependant que c'était la Sémillante, puisque une demi-heure après, le berger des îles a entendu sur ces roches.... Mais précisément voici le berger dont je vous parle, monsieur; il va vous conter la chose lui-même.... Bonjour, Palombo..., viens te chauffer un peu ; n'aie pas peur. »
Un homme encapuchonné, que je voyais rôder depuis un moment autour de notre feu et que j'aurais pris pour quelqu'un de l'équipage, car j'ignorais qu'il y eût un berger dans l'île, s'approcha de nous craintivement.
C'était un vieux lépreux, aux trois quarts idiot, atteint de je ne sais quel mal scorbutique qui lui faisait des lèvres lippues, horribles à voir. On lui expliqua à grand'peine de quoi il s'agissait. Alors, soulevant du doigt sa lèvre malade, le vieux nous raconta qu'en effet le jour en question, vers midi, il entendit dans sa cabane un craquement effroyable sur les roches. Comme l'île était toute couverte d'eau, il n'avait pas pu sortir, et c'est le lendemain seulement qu'en ouvrant sa porte, il avait vu le rivage encombré de débris et de cadavres laissés là par la mer. Épouvanté, il s'était enfui en courant vers sa barque, pour aller à Bonifacio chercher du monde.
Fatigué d'en avoir tant dit, le berger s'assit, et le patron reprit la parole :
Oui, monsieur, c'est ce pauvre vieux qui est venu nous prévenir. Il était presque fou de peur, et, de l'affaire, sa cervelle en est restée détraquée. Le fait est qu'il y avait de quoi.... Figurez-vous six cents cadavres en tas sur le sable, pêle-mêle avec les éclats de bois et les lambeaux de toiles.... Pauvre Sémillante !... la mer l'avait broyée du coup, et si bien mise en miettes que dans tous ses débris le berger Palombo n'a trouvé qu'à grand'peine de quoi faire une palissade autour de sa hutte....
Quant aux hommes, presque tous défigurés, mutilés affreusement, c'était pitié de les voir accrochés les uns aux autres, par grappes.... Nous trouvâmes le capitaine en grand costume, l'aumônier son étole au cou ; dans un coin, entre deux roches, un petit mousse, les yeux ouverts : on aurait cru qu'il vivait encore ; mais non ! Il était dit que pas un n'en échapperait. »
Ici le patron s'interrompit
Attention, Mardi ! cria-t-il, le feu s'éteint. »
Mardi jeta sur la braise deux ou trois morceaux de planches goudronnées qui s'enflammèrent, et Lionetti continua :
« Ce qu'il y a de plus triste dans cette histoire, le voici.... Trois semaines avant le sinistre, une petite corvette, qui allait en Crimée comme la Sémillante, avait fait naufrage de la même façon, presque au même endroit; seulement, cette fois-là, nous étions parvenus à sauver l'équipage et vingt soldats du train qui se trouvaient à bord....
Ces pauvres tringlots n'étaient pas à leur affaire, vous pensez !
On les emmena à Bonifacio, et nous les gardâmes pendant deux jours avec nous, à la marine.... Une fois bien secs et remis sur pieds, bonsoir ! bonne chance ! ils retournèrent à Toulon, où, quelque temps après, on les embarqua de nouveau pour la Crimée.... Devinez sur quel navire? ...
Sur la Sémillante, monsieur.... Nous les avons retrouvés tous, tous les vingt, couchés parmi les morts, à la place où nous sommes....
Je relevai moi-même un joli brigadier à fine moustache, un blondin de Paris que j'avais couché à la maison et qui nous avait fait rire tout le temps avec ses histoires.... De le voir là, ça me creva le cœur.... Ah ! Santa Madre »
Là-dessus le brave Lionetti, tout ému, secoua les cendres de sa pipe et se roula dans son caban en me souhaitant la bonne nuit. Pendant quelque temps encore les matelots causèrent entre eux à demi-voix.... Puis, l'une après l'autre, les pipes s'éteignirent.... On ne parla plus.... Le vieux berger s'en alla, et je restai seul à rêver au milieu de l'équipage endormi.
Encore sous l'impression du lugubre récit que je venais d'entendre, j'essayais de reconstruire dans ma pensée le pauvre navire défunt et l'histoire de cette agonie dont les goélands ont été seuls témoins. Quelques détails qui m'avaient frappé, le capitaine en grand costume, l'étole de l'aumônier, les vingt soldats du train, m'aidaient à deviner toutes les péripéties du drame.... Je voyais la frégate partant de Toulon dans la nuit. Elle sort du port. La mer est mauvaise, le vent terrible ; mais on a pour capitaine un vaillant marin, et tout le monde est tranquille à bord.
Le matin, la brume de mer se lève. On commence à être inquiet. Tout l'équipage est en haut. Le capitaine ne quitte pas la dunette. Dans l'entre-pont où les soldats sont renfermés, il fait noir ; l'atmosphère est chaude. Quelques-uns sont malades, couchés sur leurs sacs. Le navire tangue horriblement; impossible de se tenir debout. On cause assis à terre par groupes, en se cramponnant aux bancs ; il faut crier pour s'entendre. II y en a qui commencent à avoir peur....
Écoutez donc ! Les naufrages sont fréquents dans ces parages- ci ; les tringlots sont là pour le dire, et ce qu'ils racontent n'est pas rassurant. Leur brigadier surtout, un Parisien qui blague toujours vous donne la chair de poule avec ses plaisanteries : « Un naufrage !... mais c'est très amusant, un naufrage. Nous en serons quittes pour un bain à, la glace, et puis on nous mènera à Bonifacio, histoire de manger des merles chez le patron Lionetti. Et les tringlots de rire....
Tout à coup un craquement.... Qu'est-ce que c'est? Qu'arrive-t-il? ... « Le gouvernail vient de partir », dit un matelot tout mouillé qui traverse l'entrepont en courant. « Bon voyage ! » crie cet enragé de brigadier ; mais cela ne fait plus rire personne.
Grand tumulte sur le pont. La brume empêche de se voir. Les matelots vont et viennent effrayés, à tâtons.... Plus de gouvernail ! La manœuvre est impossible.... La Sémillante, en dérive, file comme le vent.... C'est à ce moment que le douanier la voit passer; il est onze heures et demie. A l'avant de la frégate, on entend comme des coups de canon.... Les brisants ! les brisants!... C'est fini, il n'y a plus d'espoir, on va droit à la côte. Le capitaine descend dans sa cabine. Au bout d'un moment, il vient reprendre sa place sur la dunette — en grand costume. Il a voulu se faire beau pour mourir.
Dans l'entre-pont, les soldats, anxieux, se regardent, sans rien dire.... Les malades essayent de se redresser.... Le petit brigadier ne rit plus.... C'est alors que la porte s'ouvre et que l'aumônier paraît sur le seuil avec son étole : « À genoux, mes enfants ! » Tout le monde obéit. D'une voix retentissante, le prêtre commence la prière des agonisants.
Soudain un choc formidable, un cri, un seul cri, un cri immense, des bras tendus, des mains qui se cramponnent, des regards effarés où la vision de la mort passe comme un éclair.... Miséricorde !..
C'est ainsi que je passai toute la nuit à rêver, évoquant, à dix ans de distance, l'âme du pauvre navire dont les débris m'entouraient.... Au loin, dans le détroit, la tempête faisait rage ; la flamme du bivouac se courbait sous la rafale, et j'entendais notre barque danser au pied des roches en faisant crier son amarre.
(Alphonse Daudet, Contes choisis.)
(Charpentier, éditeur.)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_guerre_de_Crim%C3%A9e  Un parlementaire
Un parlementaire
pendant la guerre de Crimée
(1855)
LES troupes alliées étaient assez bien établies sur les bords du détroit de Kertch, au camp Saint-Paul. Cependant l'eau fournie par deux puits était insuffisante et de médiocre qualité. On y suppléa en installant, près de la plage, des cuisines distillatoires que l'on fit venir de Kamiesch.
Les bâtiments s'approvisionnaient à un puits situé à cinq ou six kilomètres au nord de la ville, mais lorsque les glaces rendirent la côte inabordable, ils durent avoir recours à la neige fondue. Très peu d'entre eux possédaient alors les précieux appareils grâce auxquels on est sûr désormais de ne plus manquer d'une eau excellente, tant que l'on a du combustible.
Les ressources alimentaires qui existaient dans l'étroite bande de terre que nous occupions furent vite épuisées, mais dans les premiers mois qui suivirent l'évacuation d'Anapa par les Russes, les bâtiments de la station s'y procurèrent, d'abord facilement et à bas prix, quelques moutons et surtout des volailles de toute espèce et même des faisans. Malheureusement pour les occupants du détroit des vapeurs envoyés par des industriels de Balaclava et de Kamiesch vinrent visiter ce point privilégié, et en peu de voyages ils eurent drainé tout ce que ses environs renfermaient de denrées comestibles.
Dès le commencement de l'hiver, les ressources d'Anapa étaient épuisées, et marins et soldats furent réduits aux vivres de campagne.
L'Intendance envoyait des bœufs au camp Saint-Paul et cédait aux équipages deux repas de viande fraîche par semaine, mais pendant quatre mois nous ne vîmes pas une feuille de chou. La pêche, fructueuse en toute saison devant Sébastopol, l'avait aussi été dans le détroit jusqu'à l'apparition des glaces, alors les poissons émigrèrent et la capture de deux ou trois poissons ayant l'aspect de harengs, véritables paquets d'arêtes, était une bonne fortune ; on en faisait une soupe.
Le pays était très giboyeux, mais il fallait rester en dedans de la ligne des vedettes, et comme par les temps brumeux, très fréquents en hiver, ces vedettes se rapprochaient des postes pour ne pas être cernées ou surprises, la zone de chasse était très limitée. Malgré toutes les précautions, cette utile distraction n'était pas sans danger et plusieurs chasseurs furent enlevés par de hardis cavaliers.
Un matin du mois de février, deux officiers français, accompagnés d'un soldat, sortirent du camp pour chasser le lièvre entre Saint-Paul et Kertch. Au moment où ils quittaient la route se dirigeant vers l'intérieur, ils croisèrent une patrouille de chasseurs d'Afrique. « Vous savez que les vedettes sont repliées, leur dit le brigadier; on ne voit pas loin aujourd'hui, prenez garde!
— Oh ! nous serons prudents. »
Quelques minutes plus tard, à 500 mètres de la grande route, ils tirèrent presque en même temps sur deux lièvres, dont l'un fut tué et l'autre blessé; et tout en rechargeant leurs armes, ils se mirent à la poursuite de ce dernier. Ils étaient à peine à 50 mètres en dehors de la ligne des vedettes, lorsqu'une douzaine de cosaques, blottis derrière deux meules de foin, les entourèrent et les enlevèrent; en un clin d'œil ils étaient hors de vue, perdus dans la brume.
Une vedette voisine tira un coup de fusil; les postes prirent les armes et accoururent, mais le coup était fait; l'ordonnance rentra seul au camp. Une mésaventure semblable était arrivée, au mois de novembre, à trois officiers du Vautour près de Kinbourn.
Quelques jours après, un paysan apporta aux avant-postes une lettre de l'un des officiers; il disait comment ils avaient été pris et conduits à Caffa ; ils étaient bien traités, mais manquaient de vêtements et d'argent.
Le général russe les autorisait à écrire qu'un parlementaire serait reçu par mer, si on jugeait devoir leur envoyer ce qu'ils demandaient.
Le Ténare fut désigné pour cette mission, et, après avoir reçu les malles, un paquet de lettres et l'argent qui leur étaient destinés, j'appareillai pour Caffa par un temps clair et une très forte brise du nord-ouest.
Bien que le thermomètre ne marquât que huit degrés au-dessous de zéro, je ne me souviens pas d'avoir jamais autant souffert du froid que pendant cette journée. Les lames, en frappant contre les joues et les tambours du bâtiment, envoyaient sur le pont et sur la passerelle une pluie qui se congelait immédiatement ; le pont, le gréement inférieur, les bastingages, les vêtements de tous ceux que le service retenait sous cette pluie ou plutôt sous cette grêle étaient couverts d'une épaisse couche de glace.
La mer tomba en approchant du mouillage, nous avions hissé nos couleurs et le pavillon parlementaire.
Une embarcation vint au-devant de nous, l'officier qui la commandait m'interrogea sur le but de notre visite, et après toutes les questions d'usage et l'engagement de ma part de ne pas essayer de relever la position des batteries, il nous conduisit au point où nous devions mouiller.
Le point indiqué était un peu dans l'ouest d'un grand débarcadère en bois, et à 300 mètres environ d'une belle batterie. L'officier russe retourna à terre en m'invitant à ne pas quitter le bord avant son retour ; il allait rendre compte au gouverneur et prendre ses ordres.
Je profitai de ce répit pour changer de vêtements, je pensai qu'il était convenable de me présenter en habit, et quand l'officier vint m'annoncer que j'étais autorisé à descendre à terre, j'embarquai dans ma baleinière qui portait à l'arrière le pavillon tricolore et à l'avant le pavillon blanc.
En sautant sur le débarcadère, je rejetai dans l'embarcation le manteau qui protégeait mes épaulettes et je restai en une tenue d'inspection que ne comportait guère la saison. Je fus reçu par un colonel d'état-major (amputé d'un bras à la suite d'une blessure reçue au Caucase) et par plusieurs officiers. Il y avait à proximité un piquet d'infanterie l'arme au pied, et, aux limites d'une belle place, des cosaques circulaient, empêchant la foule d'approcher; ils semblaient faire un fréquent usage de la hampe de leurs lances.
Au milieu de la place, beaucoup d'officiers et parmi eux nos deux camarades.
Après les salutations, le colonel me dit que je pouvais communiquer et causer avec mes compatriotes, mais que je prenais l'engagement d'honneur de ne recevoir d'eux aucune correspondance ni chercher à me procurer pendant mon séjour aucun renseignement sur les défenses de la place. Je pris cet engagement, en ajoutant que, s'il le désirait, je lui indiquerais sur la carte l'emplacement de toutes les batteries ayant vue sur la mer.
Les deux officiers français arrivèrent, ils étaient enchantés de voir un camarade leur apportant avec des nouvelles de leurs familles et de leurs amis tout ce qui leur manquait, sauf, hélas ! la liberté ; ils étaient heureux de pouvoir désormais payer leur part de dépense à la table d'officiers où ils avaient été admis.
Pendant qu'ils prenaient connaissance de leurs lettres, les officiers russes s'approchèrent de moi et nous entrâmes en conversation. Ils s'étonnèrent de me voir si légèrement vêtu par un temps aussi rigoureux et alors qu'ils étaient couverts de fourrures; je leur répondis qu'il faisait froid, mais que cette température était très supportable et que je n'en souffrais nullement.
C'était horriblement faux !
On apporta à plusieurs reprises du thé bouillant fortement additionné de rhum et du vin chaud ; mes canotiers ne furent pas oubliés.
Le colonel me dit qu'une paix prochaine était probable et qu'elle serait déjà faite sans nos alliés, qui y mettaient peu de bon vouloir.
Je ne répondis pas à cette allusion aux sentiments de nos alliés, mais je dis que si les conditions de la paix étaient honorables et remplissaient le but poursuivi par notre gouvernement, elle serait la bienvenue. Il me parla ensuite de l'occupation d'Eupatoria, sur laquelle je fus surpris de le voir aussi mal renseigné; il croyait que nous y avions 20 ou 25 000 hommes, je me gardai bien de le détromper. Le stratagème des amiraux Bruat et Lyons, dont nous avions ri à l'époque, avait réussi. Les deux amiraux s'étaient présentés devant Eupatoria avec de nombreux bâtiments de guerre et des transports. On avait mis à terre avec ostentation les troupes d'occupation qui devaient suffire avec quelques canonnières; puis, jusqu'à la nuit, des détachements de marins et de soldats firent la navette entre les navires et la plage ; nous ne pensions pas que les espions de l'adversaire s'y laissaient prendre, nous nous trompions !
Puis il me parla de la prise de Kinbourn, à laquelle le Ténare avait aussi pris part, des bombardes et surtout des batteries flottantes qui avaient, pour la première fois, opposé un blindage en fer aux projectiles de la forteresse, qui avait même commencé à tirer sur elles à mitraille, les prenant pour d'immenses chalands chargés de monde. Enfin il me demanda si ce n'était pas mon bâtiment qui, au commencement de décembre, avait lancé des bombes dans la direction du camp d'Arabat. Sur ma réponse affirmative, il me dit :
« Eh bien, commandant, vous avez bien failli passer le reste de votre hiver à Caffa. Quand on vous a vu quitter votre mouillage, on était persuadé à Arabat que vous ne sortiriez pas de la mer d'Azof. »
Les officiers français remirent au colonel des lettres qu'ils désiraient faire parvenir au camp Saint-Paul; il les ouvrit pour la forme et m'autorisa à m'en charger.
Le soleil baissait et j'annonçai que j'allais retourner à mon bord, en remerciant de l'accueil qui m'avait été fait. « Mais, remarqua le colonel, vous ne pourrez peut-être pas entrer dans le détroit cette nuit, et le temps doit être bien mauvais au large ?
— C'est plus que probable, car la nuit paraît devoir être assez sombre et le vent ne mollit pas.... »
Après avoir consulté du regard un autre officier supérieur, l'excellent colonel me dit :
« Veuillez attendre un instant, je vais demander au Gouverneur de vous autoriser à rester au mouillage jusqu'à demain matin; j'espère aussi qu'il vous autorisera ainsi que vos officiers à partager notre dîner au cercle militaire, et ce soir vous entendrez de la musique, plusieurs dames de la colonie sont d'excellentes musiciennes. »
Je n'avais certes aucune objection à faire à d'aussi séduisantes propositions.
Le colonel revint au bout de quelques minutes, assez décontenancé : le Gouverneur refusait et m'invitait à partir avant la nuit close. Il n'y avait qu'à s'incliner : je pris congé, tout en maugréant contre le vieux général à idées étroites (j'avais 35 ans!) et rentrai à bord.
Je donnai l'ordre de faire rapidement souper l'équipage et de se tenir prêt à appareiller. Quant à moi, je m'empressai de remplacer mon habit, qui avait produit son effet, par un vêtement plus approprié à la température, et je me mis à table : soupe à la julienne desséchée, haricots, lard salé, figues et amandes ; je comparais par supposition ce menu à celui du cercle des officiers. Mais le froid donne de l'appétit !
Je n'avais pas terminé mon repas, qu'un aide de camp du Gouverneur vint le long du bord prévenir que cet officier général m'autorisait à rester au mouillage jusqu'au matin, mais que toute nouvelle communication avec la terre nous était interdite. Nous devions certainement cette demi-gracieuseté à l'excellent colonel dont je regrette de ne pas me rappeler le nom.
La nuit se passa aussi tranquillement que sur une rade française ; nous étions du reste étroitement surveillés, je ne sais trop pourquoi, par des rondes d'embarcations, et des patrouilles parcourant la côte.
À l'aube le Ténare fit route pour Saint-Paul, où, poussé par une bonne brise, il arriva vers le milieu du jour.
VICE-AMIRAL KRANTZ.
La mort de l'Amiral Bruat
(18 NOVEMBRE 1855)
APRÈS avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de leur conquête, les escadres avaient fait route pour Kamiesh.
Les armées alliées s'étaient solidement établies dans la presqu'île de Chersonèse, les Russes restaient en possession de la rive septentrionale du port ; l'hiver devait amener une trêve forcée entre les belligérants.
L'ordre arriva de Paris de renvoyer en France la garde impériale. Ces magnifiques régiments furent reçus à bord des bâtiments qui revenaient de Kinbourn; l'amiral Bruat, relevé de son laborieux commandement, se chargea de les ramener à Toulon.
Quel retour triomphal nous présageait ce départ salué des acclamations des deux flottes!
S'il convient d'être modeste dans la fortune, c'est surtout quand cette fortune est faite du deuil et des larmes des autres. Malheureusement il n'en est pas ainsi, et la joie des soldats est peut-être, de toutes les joies humaines, la plus insouciante dans son égoïsme. Je suis presque tenté aujourd'hui de me reprocher cette exaltation bruyante, cette gaieté sans remords qui, du jour où nous quittâmes Kamiesh, s'emparèrent du Montebello.
Nous nous arrêtâmes à Constantinople pour y renouveler notre approvisionnement de charbon.
Notre séjour dans le Bosphore ne fut qu'une succession de fêtes. Le sultan fit à l'amiral l'accueil auquel avait droit un des chefs qui avaient le plus contribué à le raffermir sur son trône. Les ministres enchérirent encore sur la réception du souverain ; ils savaient que l'amiral Bruat avait souvent consolé Omer-Pacha et le commandant de la flotte ottomane des dédains par lesquels on leur faisait si chèrement payer notre alliance ; ils tenaient à lui prouver que ces procédés délicats ne les avaient pas laissés insensibles.
Leurs hommages et leurs intentions allèrent droit au cœur de notre excellent amiral ; les grandeurs n'avaient pas altéré sa simplicité. Dans le haut rang où ses services l'avaient fait parvenir, il était resté le plus aimable et le moins pompeux des chefs.
Il commençait cependant à comprendre le rôle important qu'allait lui assigner l'éclat de cette campagne. La vivacité et la solidité de son jugement le rendaient propre à toutes les situations.
La santé seule pouvait lui faire défaut, mais il semblait que le bonheur dont son âme se montrait inondée dût prolonger sa vie et lui refaire en quelque sorte une constitution. Nous rêvions pour lui de longs jours. Son énergie nous trompait; il était de ces soldats qui meurent debout et pour ainsi dire sous les armes.
L'escadre avait quitté Constantinople ; elle avait doublé le cap Matapan. Quelques jours encore, et nous étions au port.
La mort se dressa sur notre passage.
Le 18 novembre, vers six heures du soir, l'amiral, qui n'avait cessé de diriger lui-même les mouvements de ses vaisseaux, fut trouvé défaillant et presque évanoui dans sa chambre.
Ses traits décomposés excitèrent nos alarmes. Ses joues étaient caves, et ce terrible signe du fléau qui avait fait tant de victimes dans l'armée de Crimée, la cyanose cholérique, marquait déjà d'un large cercle bleuâtre les yeux enfoncés dans leur orbite.
La nuit ne fut qu'une lutte douloureuse et sans espoir avec la mort.
Cette âme indomptable ne pouvait se résoudre à quitter ce corps de fer.
Dans la matinée qui suivit, l'abattement succéda aux douleurs et aux angoisses. Il y eut comme une amélioration subite dans l'état du malade, mais l'œil exercé des médecins ne s'y trompa point. On fit appeler l'aumônier, et les dernières prières furent récitées en présence de tous les officiers de l'état-major général, agenouillés auprès du lit du mourant.
L'amiral, depuis que le mal avait fait, vers quatre heures du matin, de rapides progrès, n'avait pas proféré une parole.
Jusque-là rien n'avait trahi chez lui l'inquiétude.
S'il interrompait parfois ses gémissements, c'était pour s'informer de la situation de l'escadre, de l'état du temps, des précautions prises.
L'amertume du terrible passage paraissait lui avoir été épargnée. Nous pouvions croire qu'il avait perdu le sentiment avant d'avoir eu conscience du danger qu'il courait ; mais, au moment où le prêtre prononçait les paroles suprêmes, son regard presque éteint sembla se ranimer. Il le promena lentement autour de lui. On eût dit qu'il cherchait je ne sais quel objet et qu'il s'inquiétait de ne pas le retrouver.
Ses yeux rencontrèrent enfin un portrait en pied qui était appendu à une des cloisons de la galerie. Ce portrait était celui d'une femme qui n'avait pas seulement embelli l'existence à laquelle le sort l'avait associée, mais qui, jeune encore, parée de toutes les vertus et de toutes les grâces, avait su montrer à cette existence, aujourd'hui si noblement remplie, autrefois si prompte à se prodiguer, la voie qu'elle devait suivre et le but où elle devait tendre.
Dès qu'ils eurent retrouvé cette chère image, les yeux de l'amiral ne s'en détournèrent plus.
Bientôt les lèvres déjà glacées s'entr'ouvrirent, la tête, qui s'était légèrement soulevée, retomba inerte.
Nous n'avions plus devant nous que des dépouilles insensibles, honorées encore de nos larmes.
La nouvelle de la perte immense que venaient de faire la marine et la France fut transmise à l'escadre par signal. Elle porta la consternation à bord de tous les bâtiments. L'amiral était adoré des officiers et des équipages. Il avait ces qualités brillantes qui séduisent les masses : la bravoure héroïque et l'affabilité; mais ce qui ajoutait encore à l'impression générale, c'était cet effroi dont on ne pouvait se défendre en songeant qu'un bonheur, bâti pierre à pierre, s'écroulait au moment même où rien ne lui manquait. La fortune semblait n'avoir comblé cet illustre favori que pour rendre plus amère la déception qu'elle lui préparait.
(Jurien de la Gravière, la Marine d'aujourd'hui.)
(Hachette et Cie, éditeurs.)
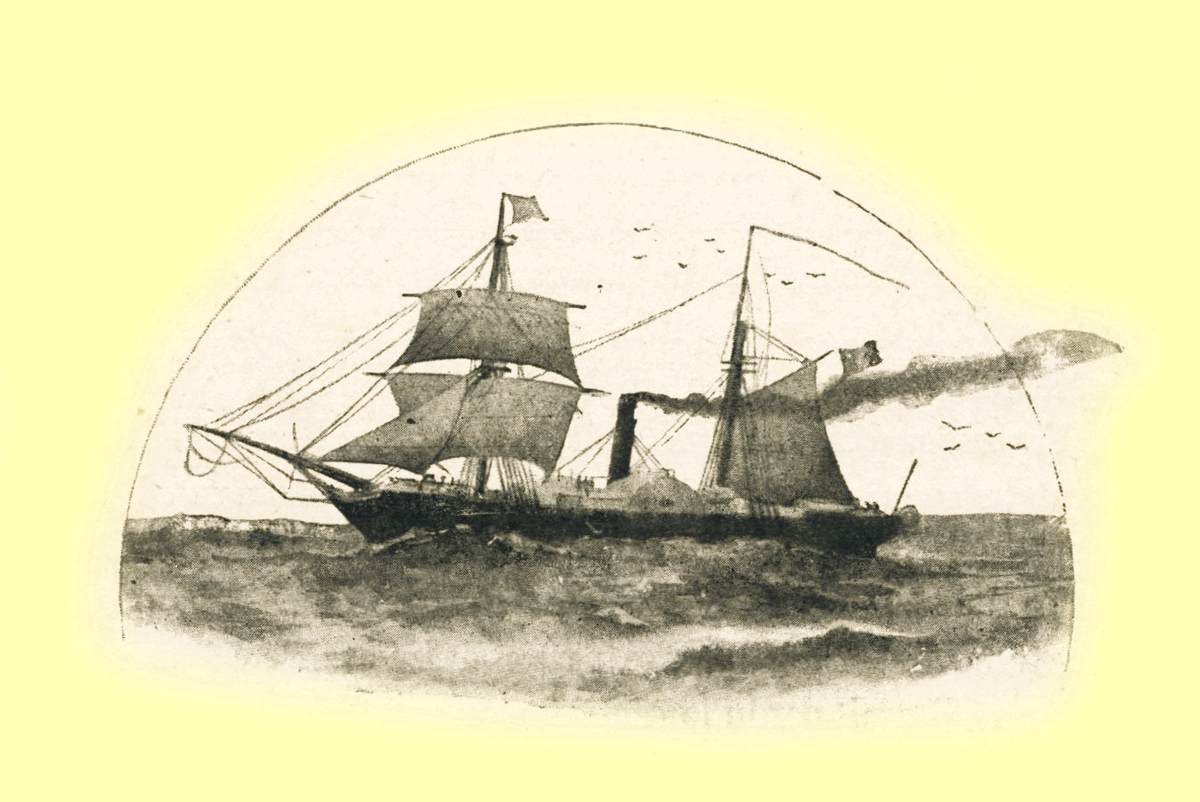
Évolution de la construction navale
Avec la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle, la construction navale militaire évolua:
Propulsion:
Le vent — gratuit, fut remplacé par le charbon — qu'il fallait extraire, transporter et entreposer.
Les voiles furent remplacées par des machines à vapeur et bien plus tard par des machines fonctionnant au fuel.
La propulsion se faisait grâce à des roues à aubes au début et ensuite par des hélices.
Armement:
Les épais bordages en chêne des navires furent renforcés par des plaques métalliques en bronze et en fer dans un premier temps … et …
… ensuite, les navires en bois furent remplacés par des navires en fer.
Les navires Trois-ponts  devinrent des Dreadnoughts
devinrent des Dreadnoughts  et ensuite des Cuirassés
et ensuite des Cuirassés  .
.
Les canons alimentés par la gueule avec des boulets sphériques devinrent des canons rayés propulsant des projectiles en forme d'ogive … avec chargement par la culasse !
De progrès en progrès, les marins s'entretuèrent plus efficacement et massivement.
etc., etc.

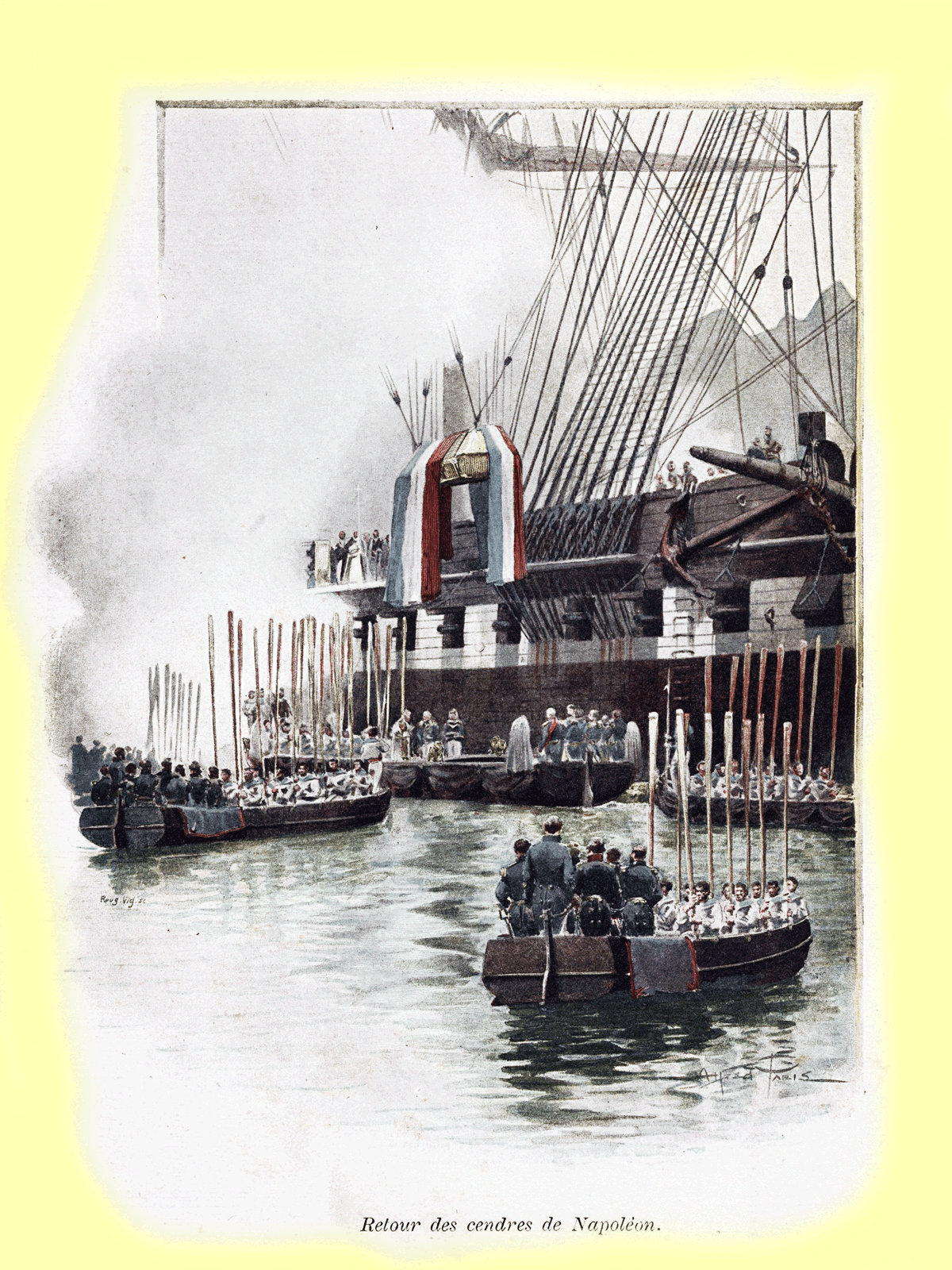
Pantene:
Apiquer les vergues en pantenne c'est quand elles sont apiquées à contre les unes des autres
c'est-à-dire celles d'un mât d'un bord et celles d'un mât voisin de l'autre bord : on dit dans ce cas que les vergues sont en pantenne.
Apiquer les vergues en pantenne est aussi un signe de deuil.
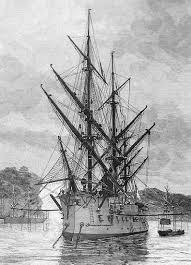
Je fus nommé au commandement d'une escadre envoyée sur les côtes de l'empire du Maroc, où de graves événements, intéressant à la fois la consolidation de notre conquête algérienne et nos relations internationales, étaient à la veille de se passer. Abd-el-Kader, aux abois depuis le coup terrible porté à son prestige par la prise de la smalah, jouait en désespéré sa dernière partie. Il avait de nouveau soulevé contre nous et la haine de l'envahisseur et le fanatisme musulman.
Partout nous étions obligés de combattre, et pendant que mon frère Aumale avait du côté de Constantine des engagements très vifs dans un desquels mon frère Montpensier fut blessé, le général Bugeaud était en lutte de tous les jours avec les tribus guerrières de la province d'Oran.
Ces tribus, repoussées, passaient la frontière du Maroc, formée par la rivière Moulouia, devant laquelle nos troupes devaient s'arrêter par respect pour les susceptibilités européennes, et échappaient ainsi au châtiment.
De cet arrêt de notre poursuite, nos adversaires concluaient que nous n'osions pas affronter la colère de l'empire du Maroc, ou bien que les puissances européennes, et en particulier celle dont le pavillon flottait sur Gibraltar, garantissaient le sol marocain de toutes atteintes. Ce sol devenait alors une sorte de citadelle d'où l'on pouvait tout tenter contre nous, sans crainte de représailles.
Il en résultait des irruptions continuelles, auxquelles prenaient part, non seulement les fanatiques du Maroc, mais aussi, sous le couvert de l'anonyme, les propres soldats de l'empereur, rassemblés, sous prétexte d'observation, à deux pas de la frontière, irruptions qu'il devenait à la longue insupportable d'avoir sans cesse à repousser au prix de précieuses existences.
Cette situation ne pouvait durer : le Gouvernement français résolut d'y mettre un terme, et son premier acte fut l'envoi de l'escadre que j'avais l'honneur de commander.
Je devais sommer l'empereur du Maroc de retirer à Abd-el-Kader la protection qu'il lui avait jusqu'ici accordée, de ne pas permettre à nos ennemis d'organiser sur son territoire des expéditions contre nous, et enfin de réduire h une simple force de police le rassemblement considérable, menaçant par son nombre et son attitude, qu'il avait réuni à la frontière. Faute d'un prompt acquiescement à ces demandes, je devais, pendant que le général Bugeaud emploierait la force sur terre, l'employer de mon côté sur mer, afin de contraindre Mulai Abderrahman à s'y soumettre.
Seulement il m'était expressément recommandé de pousser la longanimité jusqu'aux dernières limites, et, si nous étions obligés d'agir, de déclarer bien haut qu'aucune pensée de conquête ne nous animait.
Pendant ce temps j'organisais à Toulon ma petite escadre, à laquelle on avait adjoint environ 1200 hommes de troupes de débarquement, et j'expédiais mes navires, à mesure qu'ils étaient prêts, à Oran, comme point de rendez-vous.
Après avoir rallié mon monde à Oran, et être entré en communication avec le général Bugeaud, je me rendis droit à Gibraltar, pour conférer avant tout avec les autorités anglaises, et prendre nettement et loyalement l'initiative de toute explication qu'elles auraient pu me demander sur mes intentions pacifiques ou belliqueuses, et sur le rôle que nous réservions aux neutres. Disons de suite que, dès le premier jour et pendant toute la campagne, je n'eus qu'à me louer sans réserve des rapports que j'eus avec les commandants des forces navales anglaises, l'amiral Owen, les capitaines Lockyer et Provo Wallis en particulier.
Nos relations ont toujours été franches, cordiales, straight forward, disaient les Anglais, et par suite très agréables. Il n'en a pas été de même de mes rapports avec le gouverneur de Gibraltar, le général Sir Robert Wilson, un ennemi acharné de la France.
Nature chevaleresque à ses heures, mais passionnée, agité, incapable de se tenir tranquille, Sir Robert avait vu dans son gouvernement de Gibraltar, non seulement un grand commandement militaire, mais un poste d'action politique, et toute cette action, il l'avait tournée, par le Maroc, contre notre conquête d'Algérie, c'est-à-dire contre la France. Ses allées et venues de Gibraltar à la côte voisine étaient connues de tous ; son journal, le Gibraltar Chronicle, rédigé par son secrétaire colonial, se faisait l'écho de tout ce qui pouvait abaisser la France, dénigrer nos armées, exciter contre nous.
L'exportation des armes, des munitions de guerre à Tétouan ou autres villes marocaines se faisait ouvertement sous ses yeux.
Enfin il était facile de faire remonter à lui, en grande partie, la confiance dans l'impunité qui rendait le gouvernement de Mulai Abderrahman si hostile dans sa conduite à notre frontière, si insolent dans ses réponses à nos agents diplomatiques.
Tel était le personnage avec qui j'eus principalement affaire dès le début de ma mission.
En arrivant, ma première démarche fut vis-à-vis de lui, et je me rendis au Convent, comme s'appelle sa résidence, en grande tenue, accompagné des capitaines de l'escadre. Il me reçut avec une politesse voisine de l'obséquiosité, et me parla aussitôt des dangers qu'il entrevoyait à la présence de mon escadre sur la côte, devant les villes du Maroc, danger enfin pour la paix générale, à cause des conflits qui ne manqueraient pas de se produire, danger d'exciter encore davantage les passions belliqueuses des musulmans, dangers pour la sécurité des chrétiens, des Européens, des consuls établis au Maroc, danger enfin pour M. Hay, le consul général d'Angleterre, qui venait justement de partir, pour porter en personne à l'empereur Mulai Abderrahman des conseils de modération.
« Mais, mon général, répondis-je, je ne demande pas mieux que de ne pas aller avec mes vaisseaux à Tanger, ni sur aucun point de la côte du Maroc, pendant qu'on négocie. Nous sommes las de la situation que les insolences et les hostilités marocaines nous font à notre frontière ; nous allons présenter un ultimatum destiné à y mettre un terme ; nous donnerons un délai pour y répondre, au bout duquel, suivant la réponse, nous irons à Tanger pour punir ou pardonner.
D'ici là, nous serons heureux de tous les efforts faits pour calmer les esprits et aider à l'acceptation de nos justes demandes. D'ici là, je suis prêt à ne pas conduire l'escadre sur la côte marocaine, mais à une condition, c'est que les vaisseaux anglais n'y paraîtront pas non plus. Nous ne souffrirons pas que nos affaires soient traitées, qu'il s'agisse de protection ou d'intimidation, sous le canon d'une escadre étrangère. Si donc, vous et les autorités maritimes, me promettez que vos vaisseaux n'iront pas à Tanger, je mène l'escadre à Cadix, sans toucher à cette dernière ville, et j'attends là une réponse à notre ultimatum. Il est entendu que je n'ai aucune opposition à ce que vos bâtiments légers aillent sur la côte pour la protection de vos nationaux, les miens iront également. »
Ce que j'avais proposé à Sir Robert se réalisa. Il me fut promis que les vaisseaux anglais ne se présenteraient pas devant Tanger, et, de mon côté, je conduisis l'escadre à Cadix, pendant que M. de Nion, notre consul général, expédiait notre ultimatum à Moulai Abderrahman. Puis il s'écoula une longue période d'incertitudes.
Des vaisseaux arrivèrent directement d'Angleterre à Tanger.
Informé, je mis aussitôt à la voile pour les y suivre, mais les autorités de Gibraltar les avaient déjà rappelés quand j'y arrivai : je retournai donc Cadix.
Les réponses à notre ultimatum arrivèrent fâcheuses ; le gouvernement marocain refusait de dissoudre le rassemblement de troupes que le général Bugeaud avait devant lui et réclamait même la punition du général qui, en poursuivant les bandes venues pour l'attaquer, avait plusieurs fois violé la frontière.
Rien sur Abd-el-Kader, le sujet principal de nos réclamations.
Devant ces nouvelles, nous aurions pu agir de suite, mais il fallait auparavant pourvoir à la sécurité de nos consuls et de nos nationaux, que le premier coup de canon tiré pouvait livrer à tous les excès du fanatisme musulman. Puis il y avait la présence du consul général d'Angleterre auprès de l'empereur du Maroc, et si ce consul n'avait de mission officielle du gouvernement français, il en avait certainement une officieuse ; il fallait attendre son retour.
Pour colorer nos retards, M. de Nion envoya une nouvelle sommation à Sidi Bousselam, pacha de Larrache, un homme éclairé, chargé par Mulai Abderrahman des relations avec nous.
Un nouveau délai fut fixé.
J'en profitai pour faire retirer nos consuls et j'allai de ma personne, à Tanger, procéder à l'enlèvement par surprise de notre consul général et de sa famille. Il s'en fallut d'une minute que les Marocains n'y missent obstacle. Tous les Français et protégés qui avaient retardé leur embarquement furent arrêtés ; seul un juif, arrivant à toute course et se jetant à l'eau, put encore rattraper mon canot. Enfin, le 4 août, M. de Nion reçut une réponse inacceptable à sa dernière note : toujours « la punition du général ».
Nous n'en étions pas là.
Le 5, un aviso m'apportait la nouvelle que le plénipotentiaire anglais, M. Hay, était en sûreté sur un navire de guerre de sa nation et que sa mission avait échouée. Le 6, j'attaquai les fortifications de Tanger, en présence de navires de guerre de tous pavillons, de vaisseaux anglais comme des frégates espagnoles.
La démonstration était claire.
Aux Marocains que nous frappions, aux étrangers qui étaient présents, nous prouvions que la France entendait faire respecter sa frontière algérienne, et qu'aucune protection étrangère ne sauverait du châtiment ceux qui la violeraient.
La canonnade de Tanger fut bien plus un bombardement politique qu'une action de guerre.
Si, au début, quatre-vingts pièces répondirent à nos coups, leur feu fut rapidement éteint par le tir admirable de nos excellents canonniers. Pas un boulet ne s'écarta des embrasures de l'ennemi; pas un boulet n'atteignit les maisons, le quartier consulaire. Nos pertes furent insignifiantes; je n'en ai plus le chiffre ; je crois que nous n'eûmes que quinze ou vingt hommes hors de combat ; nos avaries nulles; mon vaisseau, le Suffren, ne reçut pas cinquante boulets dans sa coque et sa mâture (1).
Le général Bugeaud, informé aussitôt, m'écrivait peu après : « Je vous disais le 11 que l'armée ne tarderait pas à acquitter la lettre de change que la flotte avait tirée sur elle. La copie ci-jointe d'une dépêche télégraphique à Son Excellence M. le ministre de la guerre vous fera voir que nous avons tenu parole. » La dépêche contenait le récit de la bataille d'Isly, qu'il venait de livrer, et la lettre qu'il m'écrivait était datée du champ de bataille, le 14 août. Ce même 14 août, j'étais avec l'escadre devant Mogador. Des reconnaissances faites par des officiers très intelligents, le lieutenant-colonel du génie Chauchard, le capitaine de la même arme Coffinières et un capitaine de frégate, héritier d'un beau nom, le vicomte Duquesne, m'avaient décidé à choisir cette ville et son port, comme offrant à une attaque le plus de chances de succès. Une autre raison m'avait déterminé : le produit des douanes de Mogador était le principal revenu de Mulai Abderrahman. Nous avions dissipé ses illusions à Tanger. Pendant que le général allait abattre son orgueil sur le champ de bataille d'Isly, j'allais faire un trou à sa bourse.
Le mauvais temps, la grosse mer, des avaries graves de chaînes, d'ancres brisées sur cette côte inhospitalière, nous causèrent bien des ennuis ; enfin, le 15 août, une mer plus calme et une brise favorable nous permirent d'aller prendre nos positions d'attaque devant Mogador. Bien fortifiée, pourvue d'une nombreuse artillerie et ayant eu le temps de se préparer, la ville fit une défense plus sérieuse que Tanger. Mais nous en vînmes à bout, et le feu de la place ayant été éteint par l'artillerie des vaisseaux le Suffren, le Jemmapes, le Triton et de la frégate la Belle-Poule, je fis entrer la flottille dans la passe, et jeter cinq cents hommes sur l'île qui forme le port. Le débarquement se fit sous un feu de mousqueterie très vif, mais avec un entrain admirable, les hommes blessés dans les canots sautant à terre les premiers.

Les batteries furent enlevées à la course et toute la garnison de l'île, environ quatre cents hommes, tués, noyés ou rejetés à la nuit dans une grande mosquée qui se rendit le lendemain.
Rien de pittoresque comme cette fin de combat par un soleil couchant, semblable à celui que j'ai vu peindre à Horace Vernet dans son beau tableau de la bataille de Montmirail.
Les Marocains aux costumes éclatants se retiraient, en tiraillant, vers la mosquée dont la haute tour s'élevait en silhouette vers le ciel, pendant que nos embarcations, longeant la côte sur une mer dorée, joignaient leur fusillade à l'action de nos soldats. Je me souviens qu'à ce moment je me trouvai à côté d'un jeune sous-lieutenant tout frais sorti de Saint-Cyr, M. Martin des Pallières, à qui, sur ses instances, j'avais permis de descendre à terre en volontaire, bien que sa compagnie ne dût pas débarquer. Il me montra avec fierté son bras fracassé par une balle en me disant : « Vous voyez que vous avez bien fait de me laisser venir! » Toute cette prise de l'île fut très bien menée par le colonel Chanchard et le commandant Duquesne, qui y fut blessé.
Le lendemain mon premier soin fut de renvoyer au pacha de Mogador quelques-uns des prisonniers avec la déclaration que s'il était touché un cheveu de la tête du consul anglais, de sa famille et de quelques autres Européens qu'il avait refusé de laisser embarquer avant l'attaque, je ferais passer par les armes en représailles tous les autres prisonniers. J'eus la satisfaction de recueillir ce consul et les siens et de les faire reconduire à bord de la frégate anglaise Warspite, qui suivait nos opérations. Il était temps ; car les Arabes, les Kabyles de la campagne, envahissaient la ville pour la piller, la saccager.
Le pacha débordé, n'ayant plus les moyens de maintenir l'ordre, obligé de s'enfuir, aucun chrétien n'aurait pu rester en ville sans courir les plus grands dangers.
Peu après, nous débarquâmes à Mogador même, pour y achever l'œuvre de destruction de la ville, enclouer les canons, briser les affûts, détruire les munitions de toutes les batteries de la marine, tout cela sans l'ombre d'opposition. Puis je mis une garnison dans l'île, que j'armai de canons de gros calibre, afin de tenir en respect la ville que nous ne voulions pas occuper, et je déclarai le port en état de blocus.
(Calmann Levy, éditeur.)
Les alliés y trouvèrent un fort approvisionnement de grains.
Dans la soirée, les abords d'Old-fort furent examinés en détail, et des bouées, mouillées au large, jalonnèrent les lignes suivant lesquelles devaient se ranger les divisions des flottes.
La plage, parfaitement unie, d'une étendue immense, offrait deux points de débarquement très distincts, sur des bourrelets de sable limités par la mer d'une part, et de l'autre par deux lagunes, dont la plus considérable était au nord. Entre ces deux lagunes se prolongeait, sur une longueur de trois ou quatre kilomètres, une falaise haute de quelques mètres seulement : c'était la base d'un plateau qui s'élevait insensiblement vers l'intérieur, champ de tir à souhait pour l'artillerie des flottes.
Les emplacements que devait occuper chacune d'elles étaient si nettement, si distinctement indiqués par la nature et la disposition du terrain, qu'il ne pouvait y avoir entre elles, pendant l'opération même, ni confusion, ni contestation; ni difficulté, ni plus tard aucune récrimination de bonne foi. Les Anglais devaient prendre pied sur le bourrelet du nord, les Français et les Turcs — sur le bourrelet du sud.
Le contre-amiral sir Edmund Lyons, pour la flotte anglaise, le contre-amiral Bouet-Willaumez, pour la flotte française, avaient tracé le dispositif du débarquement; chaque commandant de navire était instruit de ce qu'il avait à faire.
Le 14 septembre, à deux heures du matin, le signal d'appareillage était donné; le temps était magnifique, le ciel pur, la mer belle. Les vaisseaux de ligne s'avançaient lentement, remorqués par des frégates ou des corvettes à vapeur ; à mesure qu'ils arrivaient sur les bouées d'embossage, ils laissaient tomber l'ancre et prenaient leur rang de bataille, les remorqueurs se plaçant dans les intervalles; à sept heures, tous étaient rangés à leur poste, les Anglais à gauche, les Français au centre, les Turcs à droite. Les escadres de guerre formaient ainsi quatre lignes, la première à six cents mètres environ de la plage, les autres successivement à deux cents mètres de distance.
Les lignes françaises se suivaient dans l'ordre numérique des divisions d'infanterie qui allaient être débarquées, chacune à son tour. La quatrième ligne, qui portait la quatrième division, ne fit que paraître à la place que lui assignait le plan général ; elle se remit presque aussitôt en colonne, suivie de trois frégates anglaises, pour aller distraire l'attention des Russes par un simulacre de débarquement aux embouchures de l'Alma et de la Katcha.
Un peu avant huit heures, un signal du vaisseau amiral la Ville de Paris, répété sur toute la première ligne, donna l'ordre de mettre les embarcations à la mer. Tandis que les chalands, traînés en remorque par les vaisseaux depuis la veille, venaient accoster le bord qui n'était pas vu de terre et recevaient l'artillerie de bataille, tandis que les soldats d'infanterie descendaient par groupes dans les canots, les avisos à vapeur, les grandes chaloupes armées de canon, s'approchaient de la côte pour flanquer le débarquement sur les deux ailes, précaution excellente, mais qui fut inutile, car on ne vit de tout le jour aucun ennemi paraître.
Des fanions de diverses couleurs, plantés par les soins de l'état-major général sur le sable, indiquaient à chaque brigade, à chaque régiment, à chaque bataillon, le point précis où il devait atterrir. À neuf heures, les premiers canots atteignaient la plage ; à midi, toute la première division débarquée s'avançait en ordre au-dessus de la falaise ; à trois heures, la deuxième venait se placer auprès d'elle ; à six heures, la troisième les rejoignait, et l'artillerie avait déjà 59 pièces de campagne prêtes pour le combat. Deux divisions anglaises bivouaquaient sur la gauche.
Le soleil, déclinant à l'horizon, éclairait d'une lumière empourprée un spectacle admirable ; d'un côté, sur ce plateau, la veille morne et désert, l'activité d'une vie nouvelle, tous ces hommes aux uniformes variés, aux armes étincelantes, alertes, joyeux, s'installant gaiement pour le bivouac, les tentes dressées, les feux qui s'allumaient, et plus loin, vers l'orient assombri, les grand'gardes qui s'en allaient tendre, pour la sécurité de tous, le réseau des avant-postes et la chaîne des sentinelles; de l'autre coté, les innombrables navires dessinant sur les ondulations miroitantes de la mer la silhouette de leurs flancs noirs, et sur le fond rouge du ciel la fine dentelle de leur mâture et de leurs agrès ; enfin, pour achever la mise en scène, l'accompagnement lointain du canon qu'on entendait gronder depuis le milieu du jour.
C'était la démonstration que la quatrième division française avait d'abord faite à l'embouchure de l'Alma et qu'elle prolongeait devant la Katcha ; à la nuit tombante, elle vint reprendre sa place au mouillage d'Old-fort.
Le vent s'était élevé ; dans la nuit, un orage éclata ; les soldats français, sous leurs tentes-abris, se tinrent à peu près à couvert, tandis que les Anglais, qui n'avaient pas encore leurs grandes tentes, souffrirent beaucoup de la tempête.
Le 15, au point du jour, la houle était si forte que le débarquement des trois dernières divisions anglaises, de la quatrième division française et des Turcs ne se fit pas sans difficulté ; la peine fut plus grande encore pour la mise à terre des chevaux et d'une partie du matériel, l'autre partie devant demeurer provisoirement à bord des navires.
L'opération ne fut terminée que le 16 au soir pour les Français; pour les Anglais, elle ne l'était pas encore.
Le 17, on mit à leur disposition des chalands ; cependant, malgré cette assistance, ils ne se trouvèrent prêts à marcher que dans la soirée du 18.
En touchant la terre de Crimée, le maréchal de Saint-Arnaud avait repris des forces ; le 14, il était resté six heures à cheval, visitant les bivouacs, s'assurant que les grand'gardes étaient bien placées, les petits postes dûment répartis, les sentinelles avancées à bonne distance. Il était impatient de voir l'ennemi ou d'en avoir au moins des nouvelles.
Le 15, des spahis de son escorte, en reconnaissance â cinq ou six kilomètres, avaient surpris dans un village et ramené douze soldats russes avec un sergent ; il voulut les interroger lui-même.
Pour le ravitaillement de l'armée, sinon pour le combat, les Tatars pouvaient être de précieux auxiliaires, à condition qu'on les traitât bien, qu'on respectât leurs aouls, leurs familles, leurs troupeaux; malheureusement, entraînés par les pires habitudes d'Afrique, et persuadés qu'en terre ennemie tout était de bonne prise, des zouaves avaient commis des actes de pillage et de violence dans un de ces aouls ; un autre jour, des troupeaux étaient enlevés.
Résolu à protéger les gens du pays et â maintenir une stricte discipline, le maréchal réprouva, par une flétrissure publique, « les instincts pillards de certains soldats », et commanda de faire une rigoureuse punition des coupables.
Enfin, dans les deux armées, les ordres de départ purent être donnés pour le 19 septembre.
Eupatoria restait gardée, sous le commandement supérieur du chef d'escadron d'état-major Osmont, par deux compagnies d'infanterie de marine, auxquelles pouvaient se joindre, au besoin, des matelots débarqués du vaisseau l'Iéna, laissé en station sur la rade avec un navire anglais.
Aux environs d'Old-fort devaient demeurer provisoirement un détachement de la quatrième division d'infanterie britannique et un régiment de cavalerie légère, sous les ordres du brigadier général Torrens.
Le 19, sept heures du matin, tous les autres bivouacs furent levés, et les deux armées commencèrent leur première étape dans la direction de Sébastopol.
(Camille Rousset, Histoire de la guerre de Crimée.)
(Hachette et Cie, éditeurs.)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Crim%C3%A9e
Le combat du 17 octobre 1854
LE parc de siège que nous avions apporté de Varna ne pouvait tenir tête aux pièces de gros calibre que nous opposaient les Russes. L'armée dut demander des canons plus puissants à la flotte.
Le 3 octobre, l'escadre française débarqua 19 pièces et 1100 hommes.
Au bout d'un an, des appels successifs avaient porté ce contingent à 128 bouches à feu et à 2434 hommes. L'escadre anglaise forma de son côté une brigade navale destinée à servir les premiers canons à boulets ogivaux dont il ait été fait usage.
Cette batterie prit le nom des pièces dont on l'avait armée; ce fut la fameuse batterie de Lancastre.
Comme des cavaliers qui ont mis pied à terre, les marins de la flotte assiégée et ceux de la flotte assiégeante se trouvèrent pendant onze mois face à face. L'œil constamment fixé sur la même embrasure, ils étonnèrent les deux armées par la précision de leur tir, non moins que par la constance de leur courage.
Nos travaux avaient été plus d'une fois rasés. On les avait repris avec persévérance. Le moment d'ouvrir le feu approchait. Pendant que le gros des escadres alliées restait mouillé à l'embouchure de la Katcha, l'amiral Brual, détaché devant Kamiesh, exécutait les reconnaissances qui lui avaient été prescrites, et faisait baliser les approches de la rade.
La marine et l'armée espéraient pouvoir foudroyer de concert les défenses de Sébastopol.
Le 17 octobre, nous fûmes éveillés par un feu terrible. Les batteries de siège avaient, dès les premiers rayons du jour, dégorgé leurs embrasures. Muettes jusque-là, elles essayaient pour la première fois leur puissance. Les batteries russes ripostaient avec énergie, la terre en tremblait, et l'ébranlement du sol semblait se prolonger jusqu'à bord.
Vers dix heures, tout à coup le feu cesse; nous n'avions rien prévu de semblable. Le canon de l'armée se taisait au moment où celui de la flotte allait parler.
Déjà en effet accourait du mouillage de la Katcha l'escadre de l'amiral Hamelin.
Une brume épaisse l'avait jusqu'alors dérobée à nos yeux. Nous nous hâtons. Les vaisseaux à voiles et les frégates à vapeur s'accouplent; les vaisseaux à hélice appareillent. La corvette le Pluton éclaire la route; le Charlemagne et le Montebello arrivent les premiers sous le canon des forts. Des boulets ont fait jaillir l'eau près de nous. Une forte secousse ébranle le vaisseau. C'est un obus qui vient de traverser la dunette sous les pieds mêmes de l'amiral.
D'autres obus sifflent dans la mâture ou frappent à la flottaison.
Des boulets rouges ont mis trois fois le feu à bord. Debout sur les parapets, les canonniers russes rechargent leurs pièces. Nous jetons l'ancre enfin, et travaillons à nous embosser.
Les escadres alliées se développent lentement sur deux rangs endentés.
Quatorze vaisseaux français, dix vaisseaux anglais et deux vaisseaux turcs forment autour des fortifications de Sébastopol un double croissant qui s'étend des batteries de la Quarantaine aux batteries du Télégraphe. On se bat au milieu d'une fumée intense. L'Agamemnon, que monte l'amiral Lyons, a pénétré dans un des replis du récif qui défend, mieux encore que les feux croisés des deux rives, l'entrée de la rade de Sébastopol.
Il mouille à 760 mètres du fort Constantin.
Le Sans-Pareil et le London ont suivi l'Agamemnon.
Cette division se trouve assaillie par des feux plongeants; elle appelle bientôt de nouveaux vaisseaux à son aide.
Le Rodney le premier répond à ce signal ; malheureusement il va donner sur l'extrémité du récif. L'Albion, le Queen, le Bellérophon, se sont approchés à leur tour.
Vigoureusement attaqué par les vaisseaux anglais et par quelques-uns des vaisseaux de notre aile gauche, le fort Constantin chancelle sous ses trois étages de batteries.
Les hauteurs du Télégraphe n'en font pas moins pleuvoir sur le détachement que commande l'amiral Lyons une grêle de projectiles. La moitié de la flotte anglaise ne peut plus avoir qu'une pensée : sortir du mauvais pas où l'audace de son chef l'a conduite. Des frégates se dévouent et enlèvent le Rodney du banc sur lequel, au début de l'action, ce vaisseau s'est échoué. Aucun trophée ne restera entre les mains de l'ennemi, mais ce n'est pas de ce côté que le feu des Russes sera éteint.
Le Charlemagne, le Montebello, le Friedland, la Ville de Paris, le Valmy, le Henri IV, le Napoléon, ont attaqué les forts du sud. Ils sont appuyés par l'Alger, le Jean-Bart, le Marengo, la Ville-de-Marseille, le Suffren, le Bayard, le Jupiter, qui tirent dans les créneaux de la première ligne.
Belle photographie du Montebello, vaisseau de premier rang français nommé ainsi en hommage à Jean Lannes, Maréchal d'Empire, et Duc de Montebello.
Le Montebello était un vaisseau de type 118 canons de Sané. Lancé à Toulon le 6 décembre 1812, il est motorisé en 1851, participe à la guerre de Crimée en Mer Noire en 1855 avant d'être désarmé en 1857 puis réarmé en 1860 afin de servir de navire école pour les canonniers. Il est à nouveau désarmé en 1865 puis rayé des listes le 25 juin 1867, après 55 ans de bons et loyaux services rendus à la Marine française.
https://fr-fr.facebook.com/TroisPonts/photos/a.458341244209904/1359161254127894/?type=3&theater
Les hauts-fonds dont la ligne d'embossage a du suivre le contour ont obligé notre escadre à jeter l'ancre à 1800 mètres environ des batteries de la Quarantaine.
Malgré la distance, qui enlève à notre tir une partie de son efficacité, la défense sur la rive méridionale paraît à peu près réduite. Vers quatre heures, le feu reprend avec une vivacité nouvelle; les bastions mêmes de la place se joignent aux batteries du bord de la mer. Les bombes, les obus pleuvent autour de nous. L'ennemi heureusement ne peut apercevoir que la pointe de nos mâts, qui surgissent comme des balises au-dessus d'un océan de fumée; ses coups portent trop haut. Le nuage protecteur qui nous environne ne lui permet pas de les rectifier; si ce nuage se dissipait, si les Russes abaissaient de quelques degrés leur tir, notre position deviendrait critique. Les boulets ne cessent de siffler au-dessus de nos têtes, bien peu s'enfoncent dans les flancs de nos navires. Sous le canon des Russes dès midi et demi, embossés vers une heure, nous n'avons pas eu à bord du Montebello trente minutes de combat sérieux.
Les vapeurs opaques étendues autour des deux flottes ont aussi envahi le ciel. Le soleil apparaît à travers ce brouillard comme un globe de sang. Nous le voyons descendre lentement vers l'horizon et annoncer la fin prochaine du jour; nous n'attendons que ce moment pour nous éloigner.
Les vaisseaux anglais, plus maltraités que les nôtres, ont déjà commencé leur mouvement de retraite.
L'impunité relative dont nous avons joui et un meilleur succès ne nous abusent pas sur le résultat de nos efforts.
Lorsque nous nous serons retirés, l'ennemi n'aura qu'à relever ou à remplacer ses pièces démontées, ses terrassements seront intacts; l'enjeu n'est pas égal : nous engageons dans la partie un capital de 50 ou 60 millions, les Russes en seront quittes pour quelques pelletées de terre.
(La Marine d'aujourd'hui, par Jurien de la Gravière.)
(Hachette et Co, éditeurs.)
https://en.wikipedia.org/wiki/French_frigate_S%C3%A9millante_(1841)
La perte de la "Sémillante"
dans le détroit de Bonifacio
(1855)
C’était un trois mâts à coque de bois fort bien armé. La Sémillante était l'une des 27 frégates de 60 canons construites de 1822 à 1849, les dernières étant équipées de machines à vapeur. Longue de 54 m et large de 14 m, elle représentait l'aboutissement de trois siècles de recherches en architecture navale. Mise sur cale à Lorient le 19 mars 1827, elle ne fut lancée que 14 ans plus tard, le 16 février 1841.
« ... Comment la chose s'est passée, me répondit le bon Lionetti avec un gros soupir, hélas !
Monsieur, personne au monde ne pourrait le dire. Tout ce que nous savons, c'est que la Sémillante, chargée de troupes pour la Crimée, était partie de Toulon, la veille au soir, avec le mauvais temps. La nuit, ça se gâta encore. Du vent, de la pluie, la mer énorme comme on ne l'avait jamais vue.... Le matin le vent tomba un peu, mais la mer était dans tous ses états, et cela avec une sacrée brume du diable à ne pas distinguer un fanal à quatre pas....
Ces brumes-là, monsieur, on ne se doute pas comme c'est traître. Ça ne fait rien, j'ai idée que la Sémillante a dû perdre son gouvernail dans la matinée, car il n'y a pas de brume qui tienne ; sans une avarie, jamais le capitaine ne serait venu s'aplatir ici contre. C'était un rude marin, que nous connaissions tous. Il avait commandé la station en Corse pendant trois ans, et savait sa côte aussi bien que moi, qui ne sais pas autre chose.
— Et à quelle heure pense-t-on que la Sémillante a péri?
— Ce doit être à midi ; oui, monsieur, en plein midi....
Mais, dame! avec la brume de mer, ce plein midi-là ne valait guère mieux qu'une nuit noire comme la gueule d'un lion.... Un douanier de la côte m'a raconté que ce jour-là, vers onze heures et demie, étant sorti de sa maisonnette pour rattacher ses volets, il avait eu sa casquette emportée par un coup de vent, et qu'au risque d'être enlevé lui-même par la lame, il s'était mis à courir après, le long du rivage, à quatre pattes. Vous comprenez, les douaniers ne sont pas riches, et une casquette, ça coûte cher. Or il paraîtrait qu'à un moment notre homme, en relevant la tête, aurait aperçu tout près de lui, dans la brume, un gros navire à sec de toile qui fuyait sous le vent du côté des îles Lavezzi. Ce navire allait si vite, si vite, que le douanier n'eut guère le temps de bien voir. Tout fait croire cependant que c'était la Sémillante, puisque une demi-heure après, le berger des îles a entendu sur ces roches.... Mais précisément voici le berger dont je vous parle, monsieur; il va vous conter la chose lui-même.... Bonjour, Palombo..., viens te chauffer un peu ; n'aie pas peur. »
Un homme encapuchonné, que je voyais rôder depuis un moment autour de notre feu et que j'aurais pris pour quelqu'un de l'équipage, car j'ignorais qu'il y eût un berger dans l'île, s'approcha de nous craintivement.
C'était un vieux lépreux, aux trois quarts idiot, atteint de je ne sais quel mal scorbutique qui lui faisait des lèvres lippues, horribles à voir. On lui expliqua à grand'peine de quoi il s'agissait. Alors, soulevant du doigt sa lèvre malade, le vieux nous raconta qu'en effet le jour en question, vers midi, il entendit dans sa cabane un craquement effroyable sur les roches. Comme l'île était toute couverte d'eau, il n'avait pas pu sortir, et c'est le lendemain seulement qu'en ouvrant sa porte, il avait vu le rivage encombré de débris et de cadavres laissés là par la mer. Épouvanté, il s'était enfui en courant vers sa barque, pour aller à Bonifacio chercher du monde.
Fatigué d'en avoir tant dit, le berger s'assit, et le patron reprit la parole :
Oui, monsieur, c'est ce pauvre vieux qui est venu nous prévenir. Il était presque fou de peur, et, de l'affaire, sa cervelle en est restée détraquée. Le fait est qu'il y avait de quoi.... Figurez-vous six cents cadavres en tas sur le sable, pêle-mêle avec les éclats de bois et les lambeaux de toiles.... Pauvre Sémillante !... la mer l'avait broyée du coup, et si bien mise en miettes que dans tous ses débris le berger Palombo n'a trouvé qu'à grand'peine de quoi faire une palissade autour de sa hutte....
Quant aux hommes, presque tous défigurés, mutilés affreusement, c'était pitié de les voir accrochés les uns aux autres, par grappes.... Nous trouvâmes le capitaine en grand costume, l'aumônier son étole au cou ; dans un coin, entre deux roches, un petit mousse, les yeux ouverts : on aurait cru qu'il vivait encore ; mais non ! Il était dit que pas un n'en échapperait. »
Ici le patron s'interrompit
Attention, Mardi ! cria-t-il, le feu s'éteint. »
Mardi jeta sur la braise deux ou trois morceaux de planches goudronnées qui s'enflammèrent, et Lionetti continua :
« Ce qu'il y a de plus triste dans cette histoire, le voici.... Trois semaines avant le sinistre, une petite corvette, qui allait en Crimée comme la Sémillante, avait fait naufrage de la même façon, presque au même endroit; seulement, cette fois-là, nous étions parvenus à sauver l'équipage et vingt soldats du train qui se trouvaient à bord....
Ces pauvres tringlots n'étaient pas à leur affaire, vous pensez !
On les emmena à Bonifacio, et nous les gardâmes pendant deux jours avec nous, à la marine.... Une fois bien secs et remis sur pieds, bonsoir ! bonne chance ! ils retournèrent à Toulon, où, quelque temps après, on les embarqua de nouveau pour la Crimée.... Devinez sur quel navire? ...
Sur la Sémillante, monsieur.... Nous les avons retrouvés tous, tous les vingt, couchés parmi les morts, à la place où nous sommes....
Je relevai moi-même un joli brigadier à fine moustache, un blondin de Paris que j'avais couché à la maison et qui nous avait fait rire tout le temps avec ses histoires.... De le voir là, ça me creva le cœur.... Ah ! Santa Madre »
Là-dessus le brave Lionetti, tout ému, secoua les cendres de sa pipe et se roula dans son caban en me souhaitant la bonne nuit. Pendant quelque temps encore les matelots causèrent entre eux à demi-voix.... Puis, l'une après l'autre, les pipes s'éteignirent.... On ne parla plus.... Le vieux berger s'en alla, et je restai seul à rêver au milieu de l'équipage endormi.
Encore sous l'impression du lugubre récit que je venais d'entendre, j'essayais de reconstruire dans ma pensée le pauvre navire défunt et l'histoire de cette agonie dont les goélands ont été seuls témoins. Quelques détails qui m'avaient frappé, le capitaine en grand costume, l'étole de l'aumônier, les vingt soldats du train, m'aidaient à deviner toutes les péripéties du drame.... Je voyais la frégate partant de Toulon dans la nuit. Elle sort du port. La mer est mauvaise, le vent terrible ; mais on a pour capitaine un vaillant marin, et tout le monde est tranquille à bord.
Le matin, la brume de mer se lève. On commence à être inquiet. Tout l'équipage est en haut. Le capitaine ne quitte pas la dunette. Dans l'entre-pont où les soldats sont renfermés, il fait noir ; l'atmosphère est chaude. Quelques-uns sont malades, couchés sur leurs sacs. Le navire tangue horriblement; impossible de se tenir debout. On cause assis à terre par groupes, en se cramponnant aux bancs ; il faut crier pour s'entendre. II y en a qui commencent à avoir peur....
Écoutez donc ! Les naufrages sont fréquents dans ces parages- ci ; les tringlots sont là pour le dire, et ce qu'ils racontent n'est pas rassurant. Leur brigadier surtout, un Parisien qui blague toujours vous donne la chair de poule avec ses plaisanteries : « Un naufrage !... mais c'est très amusant, un naufrage. Nous en serons quittes pour un bain à, la glace, et puis on nous mènera à Bonifacio, histoire de manger des merles chez le patron Lionetti. Et les tringlots de rire....
Tout à coup un craquement.... Qu'est-ce que c'est? Qu'arrive-t-il? ... « Le gouvernail vient de partir », dit un matelot tout mouillé qui traverse l'entrepont en courant. « Bon voyage ! » crie cet enragé de brigadier ; mais cela ne fait plus rire personne.
Grand tumulte sur le pont. La brume empêche de se voir. Les matelots vont et viennent effrayés, à tâtons.... Plus de gouvernail ! La manœuvre est impossible.... La Sémillante, en dérive, file comme le vent.... C'est à ce moment que le douanier la voit passer; il est onze heures et demie. A l'avant de la frégate, on entend comme des coups de canon.... Les brisants ! les brisants!... C'est fini, il n'y a plus d'espoir, on va droit à la côte. Le capitaine descend dans sa cabine. Au bout d'un moment, il vient reprendre sa place sur la dunette — en grand costume. Il a voulu se faire beau pour mourir.
Dans l'entre-pont, les soldats, anxieux, se regardent, sans rien dire.... Les malades essayent de se redresser.... Le petit brigadier ne rit plus.... C'est alors que la porte s'ouvre et que l'aumônier paraît sur le seuil avec son étole : « À genoux, mes enfants ! » Tout le monde obéit. D'une voix retentissante, le prêtre commence la prière des agonisants.
Soudain un choc formidable, un cri, un seul cri, un cri immense, des bras tendus, des mains qui se cramponnent, des regards effarés où la vision de la mort passe comme un éclair.... Miséricorde !..
C'est ainsi que je passai toute la nuit à rêver, évoquant, à dix ans de distance, l'âme du pauvre navire dont les débris m'entouraient.... Au loin, dans le détroit, la tempête faisait rage ; la flamme du bivouac se courbait sous la rafale, et j'entendais notre barque danser au pied des roches en faisant crier son amarre.
(Alphonse Daudet, Contes choisis.)
(Charpentier, éditeur.)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_guerre_de_Crim%C3%A9e  Un parlementaire
Un parlementaire
pendant la guerre de Crimée
(1855)
LES troupes alliées étaient assez bien établies sur les bords du détroit de Kertch, au camp Saint-Paul. Cependant l'eau fournie par deux puits était insuffisante et de médiocre qualité. On y suppléa en installant, près de la plage, des cuisines distillatoires que l'on fit venir de Kamiesch.
Les bâtiments s'approvisionnaient à un puits situé à cinq ou six kilomètres au nord de la ville, mais lorsque les glaces rendirent la côte inabordable, ils durent avoir recours à la neige fondue. Très peu d'entre eux possédaient alors les précieux appareils grâce auxquels on est sûr désormais de ne plus manquer d'une eau excellente, tant que l'on a du combustible.
Les ressources alimentaires qui existaient dans l'étroite bande de terre que nous occupions furent vite épuisées, mais dans les premiers mois qui suivirent l'évacuation d'Anapa par les Russes, les bâtiments de la station s'y procurèrent, d'abord facilement et à bas prix, quelques moutons et surtout des volailles de toute espèce et même des faisans. Malheureusement pour les occupants du détroit des vapeurs envoyés par des industriels de Balaclava et de Kamiesch vinrent visiter ce point privilégié, et en peu de voyages ils eurent drainé tout ce que ses environs renfermaient de denrées comestibles.
Dès le commencement de l'hiver, les ressources d'Anapa étaient épuisées, et marins et soldats furent réduits aux vivres de campagne.
L'Intendance envoyait des bœufs au camp Saint-Paul et cédait aux équipages deux repas de viande fraîche par semaine, mais pendant quatre mois nous ne vîmes pas une feuille de chou. La pêche, fructueuse en toute saison devant Sébastopol, l'avait aussi été dans le détroit jusqu'à l'apparition des glaces, alors les poissons émigrèrent et la capture de deux ou trois poissons ayant l'aspect de harengs, véritables paquets d'arêtes, était une bonne fortune ; on en faisait une soupe.
Le pays était très giboyeux, mais il fallait rester en dedans de la ligne des vedettes, et comme par les temps brumeux, très fréquents en hiver, ces vedettes se rapprochaient des postes pour ne pas être cernées ou surprises, la zone de chasse était très limitée. Malgré toutes les précautions, cette utile distraction n'était pas sans danger et plusieurs chasseurs furent enlevés par de hardis cavaliers.
Un matin du mois de février, deux officiers français, accompagnés d'un soldat, sortirent du camp pour chasser le lièvre entre Saint-Paul et Kertch. Au moment où ils quittaient la route se dirigeant vers l'intérieur, ils croisèrent une patrouille de chasseurs d'Afrique. « Vous savez que les vedettes sont repliées, leur dit le brigadier; on ne voit pas loin aujourd'hui, prenez garde!
— Oh ! nous serons prudents. »
Quelques minutes plus tard, à 500 mètres de la grande route, ils tirèrent presque en même temps sur deux lièvres, dont l'un fut tué et l'autre blessé; et tout en rechargeant leurs armes, ils se mirent à la poursuite de ce dernier. Ils étaient à peine à 50 mètres en dehors de la ligne des vedettes, lorsqu'une douzaine de cosaques, blottis derrière deux meules de foin, les entourèrent et les enlevèrent; en un clin d'œil ils étaient hors de vue, perdus dans la brume.
Une vedette voisine tira un coup de fusil; les postes prirent les armes et accoururent, mais le coup était fait; l'ordonnance rentra seul au camp. Une mésaventure semblable était arrivée, au mois de novembre, à trois officiers du Vautour près de Kinbourn.
Quelques jours après, un paysan apporta aux avant-postes une lettre de l'un des officiers; il disait comment ils avaient été pris et conduits à Caffa ; ils étaient bien traités, mais manquaient de vêtements et d'argent.
Le général russe les autorisait à écrire qu'un parlementaire serait reçu par mer, si on jugeait devoir leur envoyer ce qu'ils demandaient.
Le Ténare fut désigné pour cette mission, et, après avoir reçu les malles, un paquet de lettres et l'argent qui leur étaient destinés, j'appareillai pour Caffa par un temps clair et une très forte brise du nord-ouest.
Bien que le thermomètre ne marquât que huit degrés au-dessous de zéro, je ne me souviens pas d'avoir jamais autant souffert du froid que pendant cette journée. Les lames, en frappant contre les joues et les tambours du bâtiment, envoyaient sur le pont et sur la passerelle une pluie qui se congelait immédiatement ; le pont, le gréement inférieur, les bastingages, les vêtements de tous ceux que le service retenait sous cette pluie ou plutôt sous cette grêle étaient couverts d'une épaisse couche de glace.
La mer tomba en approchant du mouillage, nous avions hissé nos couleurs et le pavillon parlementaire.
Une embarcation vint au-devant de nous, l'officier qui la commandait m'interrogea sur le but de notre visite, et après toutes les questions d'usage et l'engagement de ma part de ne pas essayer de relever la position des batteries, il nous conduisit au point où nous devions mouiller.
Le point indiqué était un peu dans l'ouest d'un grand débarcadère en bois, et à 300 mètres environ d'une belle batterie. L'officier russe retourna à terre en m'invitant à ne pas quitter le bord avant son retour ; il allait rendre compte au gouverneur et prendre ses ordres.
Je profitai de ce répit pour changer de vêtements, je pensai qu'il était convenable de me présenter en habit, et quand l'officier vint m'annoncer que j'étais autorisé à descendre à terre, j'embarquai dans ma baleinière qui portait à l'arrière le pavillon tricolore et à l'avant le pavillon blanc.
En sautant sur le débarcadère, je rejetai dans l'embarcation le manteau qui protégeait mes épaulettes et je restai en une tenue d'inspection que ne comportait guère la saison. Je fus reçu par un colonel d'état-major (amputé d'un bras à la suite d'une blessure reçue au Caucase) et par plusieurs officiers. Il y avait à proximité un piquet d'infanterie l'arme au pied, et, aux limites d'une belle place, des cosaques circulaient, empêchant la foule d'approcher; ils semblaient faire un fréquent usage de la hampe de leurs lances.
Au milieu de la place, beaucoup d'officiers et parmi eux nos deux camarades.
Après les salutations, le colonel me dit que je pouvais communiquer et causer avec mes compatriotes, mais que je prenais l'engagement d'honneur de ne recevoir d'eux aucune correspondance ni chercher à me procurer pendant mon séjour aucun renseignement sur les défenses de la place. Je pris cet engagement, en ajoutant que, s'il le désirait, je lui indiquerais sur la carte l'emplacement de toutes les batteries ayant vue sur la mer.
Les deux officiers français arrivèrent, ils étaient enchantés de voir un camarade leur apportant avec des nouvelles de leurs familles et de leurs amis tout ce qui leur manquait, sauf, hélas ! la liberté ; ils étaient heureux de pouvoir désormais payer leur part de dépense à la table d'officiers où ils avaient été admis.
Pendant qu'ils prenaient connaissance de leurs lettres, les officiers russes s'approchèrent de moi et nous entrâmes en conversation. Ils s'étonnèrent de me voir si légèrement vêtu par un temps aussi rigoureux et alors qu'ils étaient couverts de fourrures; je leur répondis qu'il faisait froid, mais que cette température était très supportable et que je n'en souffrais nullement.
C'était horriblement faux !
On apporta à plusieurs reprises du thé bouillant fortement additionné de rhum et du vin chaud ; mes canotiers ne furent pas oubliés.
Le colonel me dit qu'une paix prochaine était probable et qu'elle serait déjà faite sans nos alliés, qui y mettaient peu de bon vouloir.
Je ne répondis pas à cette allusion aux sentiments de nos alliés, mais je dis que si les conditions de la paix étaient honorables et remplissaient le but poursuivi par notre gouvernement, elle serait la bienvenue. Il me parla ensuite de l'occupation d'Eupatoria, sur laquelle je fus surpris de le voir aussi mal renseigné; il croyait que nous y avions 20 ou 25 000 hommes, je me gardai bien de le détromper. Le stratagème des amiraux Bruat et Lyons, dont nous avions ri à l'époque, avait réussi. Les deux amiraux s'étaient présentés devant Eupatoria avec de nombreux bâtiments de guerre et des transports. On avait mis à terre avec ostentation les troupes d'occupation qui devaient suffire avec quelques canonnières; puis, jusqu'à la nuit, des détachements de marins et de soldats firent la navette entre les navires et la plage ; nous ne pensions pas que les espions de l'adversaire s'y laissaient prendre, nous nous trompions !
Puis il me parla de la prise de Kinbourn, à laquelle le Ténare avait aussi pris part, des bombardes et surtout des batteries flottantes qui avaient, pour la première fois, opposé un blindage en fer aux projectiles de la forteresse, qui avait même commencé à tirer sur elles à mitraille, les prenant pour d'immenses chalands chargés de monde. Enfin il me demanda si ce n'était pas mon bâtiment qui, au commencement de décembre, avait lancé des bombes dans la direction du camp d'Arabat. Sur ma réponse affirmative, il me dit :
« Eh bien, commandant, vous avez bien failli passer le reste de votre hiver à Caffa. Quand on vous a vu quitter votre mouillage, on était persuadé à Arabat que vous ne sortiriez pas de la mer d'Azof. »
Les officiers français remirent au colonel des lettres qu'ils désiraient faire parvenir au camp Saint-Paul; il les ouvrit pour la forme et m'autorisa à m'en charger.
Le soleil baissait et j'annonçai que j'allais retourner à mon bord, en remerciant de l'accueil qui m'avait été fait. « Mais, remarqua le colonel, vous ne pourrez peut-être pas entrer dans le détroit cette nuit, et le temps doit être bien mauvais au large ?
— C'est plus que probable, car la nuit paraît devoir être assez sombre et le vent ne mollit pas.... »
Après avoir consulté du regard un autre officier supérieur, l'excellent colonel me dit :
« Veuillez attendre un instant, je vais demander au Gouverneur de vous autoriser à rester au mouillage jusqu'à demain matin; j'espère aussi qu'il vous autorisera ainsi que vos officiers à partager notre dîner au cercle militaire, et ce soir vous entendrez de la musique, plusieurs dames de la colonie sont d'excellentes musiciennes. »
Je n'avais certes aucune objection à faire à d'aussi séduisantes propositions.
Le colonel revint au bout de quelques minutes, assez décontenancé : le Gouverneur refusait et m'invitait à partir avant la nuit close. Il n'y avait qu'à s'incliner : je pris congé, tout en maugréant contre le vieux général à idées étroites (j'avais 35 ans!) et rentrai à bord.
Je donnai l'ordre de faire rapidement souper l'équipage et de se tenir prêt à appareiller. Quant à moi, je m'empressai de remplacer mon habit, qui avait produit son effet, par un vêtement plus approprié à la température, et je me mis à table : soupe à la julienne desséchée, haricots, lard salé, figues et amandes ; je comparais par supposition ce menu à celui du cercle des officiers. Mais le froid donne de l'appétit !
Je n'avais pas terminé mon repas, qu'un aide de camp du Gouverneur vint le long du bord prévenir que cet officier général m'autorisait à rester au mouillage jusqu'au matin, mais que toute nouvelle communication avec la terre nous était interdite. Nous devions certainement cette demi-gracieuseté à l'excellent colonel dont je regrette de ne pas me rappeler le nom.
La nuit se passa aussi tranquillement que sur une rade française ; nous étions du reste étroitement surveillés, je ne sais trop pourquoi, par des rondes d'embarcations, et des patrouilles parcourant la côte.
À l'aube le Ténare fit route pour Saint-Paul, où, poussé par une bonne brise, il arriva vers le milieu du jour.
VICE-AMIRAL KRANTZ.
La mort de l'Amiral Bruat
(18 NOVEMBRE 1855)
APRÈS avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de leur conquête, les escadres avaient fait route pour Kamiesh.
Les armées alliées s'étaient solidement établies dans la presqu'île de Chersonèse, les Russes restaient en possession de la rive septentrionale du port ; l'hiver devait amener une trêve forcée entre les belligérants.
L'ordre arriva de Paris de renvoyer en France la garde impériale. Ces magnifiques régiments furent reçus à bord des bâtiments qui revenaient de Kinbourn; l'amiral Bruat, relevé de son laborieux commandement, se chargea de les ramener à Toulon.
Quel retour triomphal nous présageait ce départ salué des acclamations des deux flottes!
S'il convient d'être modeste dans la fortune, c'est surtout quand cette fortune est faite du deuil et des larmes des autres. Malheureusement il n'en est pas ainsi, et la joie des soldats est peut-être, de toutes les joies humaines, la plus insouciante dans son égoïsme. Je suis presque tenté aujourd'hui de me reprocher cette exaltation bruyante, cette gaieté sans remords qui, du jour où nous quittâmes Kamiesh, s'emparèrent du Montebello.
Nous nous arrêtâmes à Constantinople pour y renouveler notre approvisionnement de charbon.
Notre séjour dans le Bosphore ne fut qu'une succession de fêtes. Le sultan fit à l'amiral l'accueil auquel avait droit un des chefs qui avaient le plus contribué à le raffermir sur son trône. Les ministres enchérirent encore sur la réception du souverain ; ils savaient que l'amiral Bruat avait souvent consolé Omer-Pacha et le commandant de la flotte ottomane des dédains par lesquels on leur faisait si chèrement payer notre alliance ; ils tenaient à lui prouver que ces procédés délicats ne les avaient pas laissés insensibles.
Leurs hommages et leurs intentions allèrent droit au cœur de notre excellent amiral ; les grandeurs n'avaient pas altéré sa simplicité. Dans le haut rang où ses services l'avaient fait parvenir, il était resté le plus aimable et le moins pompeux des chefs.
Il commençait cependant à comprendre le rôle important qu'allait lui assigner l'éclat de cette campagne. La vivacité et la solidité de son jugement le rendaient propre à toutes les situations.
La santé seule pouvait lui faire défaut, mais il semblait que le bonheur dont son âme se montrait inondée dût prolonger sa vie et lui refaire en quelque sorte une constitution. Nous rêvions pour lui de longs jours. Son énergie nous trompait; il était de ces soldats qui meurent debout et pour ainsi dire sous les armes.
L'escadre avait quitté Constantinople ; elle avait doublé le cap Matapan. Quelques jours encore, et nous étions au port.
La mort se dressa sur notre passage.
Le 18 novembre, vers six heures du soir, l'amiral, qui n'avait cessé de diriger lui-même les mouvements de ses vaisseaux, fut trouvé défaillant et presque évanoui dans sa chambre.
Ses traits décomposés excitèrent nos alarmes. Ses joues étaient caves, et ce terrible signe du fléau qui avait fait tant de victimes dans l'armée de Crimée, la cyanose cholérique, marquait déjà d'un large cercle bleuâtre les yeux enfoncés dans leur orbite.
La nuit ne fut qu'une lutte douloureuse et sans espoir avec la mort.
Cette âme indomptable ne pouvait se résoudre à quitter ce corps de fer.
Dans la matinée qui suivit, l'abattement succéda aux douleurs et aux angoisses. Il y eut comme une amélioration subite dans l'état du malade, mais l'œil exercé des médecins ne s'y trompa point. On fit appeler l'aumônier, et les dernières prières furent récitées en présence de tous les officiers de l'état-major général, agenouillés auprès du lit du mourant.
L'amiral, depuis que le mal avait fait, vers quatre heures du matin, de rapides progrès, n'avait pas proféré une parole.
Jusque-là rien n'avait trahi chez lui l'inquiétude.
S'il interrompait parfois ses gémissements, c'était pour s'informer de la situation de l'escadre, de l'état du temps, des précautions prises.
L'amertume du terrible passage paraissait lui avoir été épargnée. Nous pouvions croire qu'il avait perdu le sentiment avant d'avoir eu conscience du danger qu'il courait ; mais, au moment où le prêtre prononçait les paroles suprêmes, son regard presque éteint sembla se ranimer. Il le promena lentement autour de lui. On eût dit qu'il cherchait je ne sais quel objet et qu'il s'inquiétait de ne pas le retrouver.
Ses yeux rencontrèrent enfin un portrait en pied qui était appendu à une des cloisons de la galerie. Ce portrait était celui d'une femme qui n'avait pas seulement embelli l'existence à laquelle le sort l'avait associée, mais qui, jeune encore, parée de toutes les vertus et de toutes les grâces, avait su montrer à cette existence, aujourd'hui si noblement remplie, autrefois si prompte à se prodiguer, la voie qu'elle devait suivre et le but où elle devait tendre.
Dès qu'ils eurent retrouvé cette chère image, les yeux de l'amiral ne s'en détournèrent plus.
Bientôt les lèvres déjà glacées s'entr'ouvrirent, la tête, qui s'était légèrement soulevée, retomba inerte.
Nous n'avions plus devant nous que des dépouilles insensibles, honorées encore de nos larmes.
La nouvelle de la perte immense que venaient de faire la marine et la France fut transmise à l'escadre par signal. Elle porta la consternation à bord de tous les bâtiments. L'amiral était adoré des officiers et des équipages. Il avait ces qualités brillantes qui séduisent les masses : la bravoure héroïque et l'affabilité; mais ce qui ajoutait encore à l'impression générale, c'était cet effroi dont on ne pouvait se défendre en songeant qu'un bonheur, bâti pierre à pierre, s'écroulait au moment même où rien ne lui manquait. La fortune semblait n'avoir comblé cet illustre favori que pour rendre plus amère la déception qu'elle lui préparait.
(Jurien de la Gravière, la Marine d'aujourd'hui.)
(Hachette et Cie, éditeurs.)
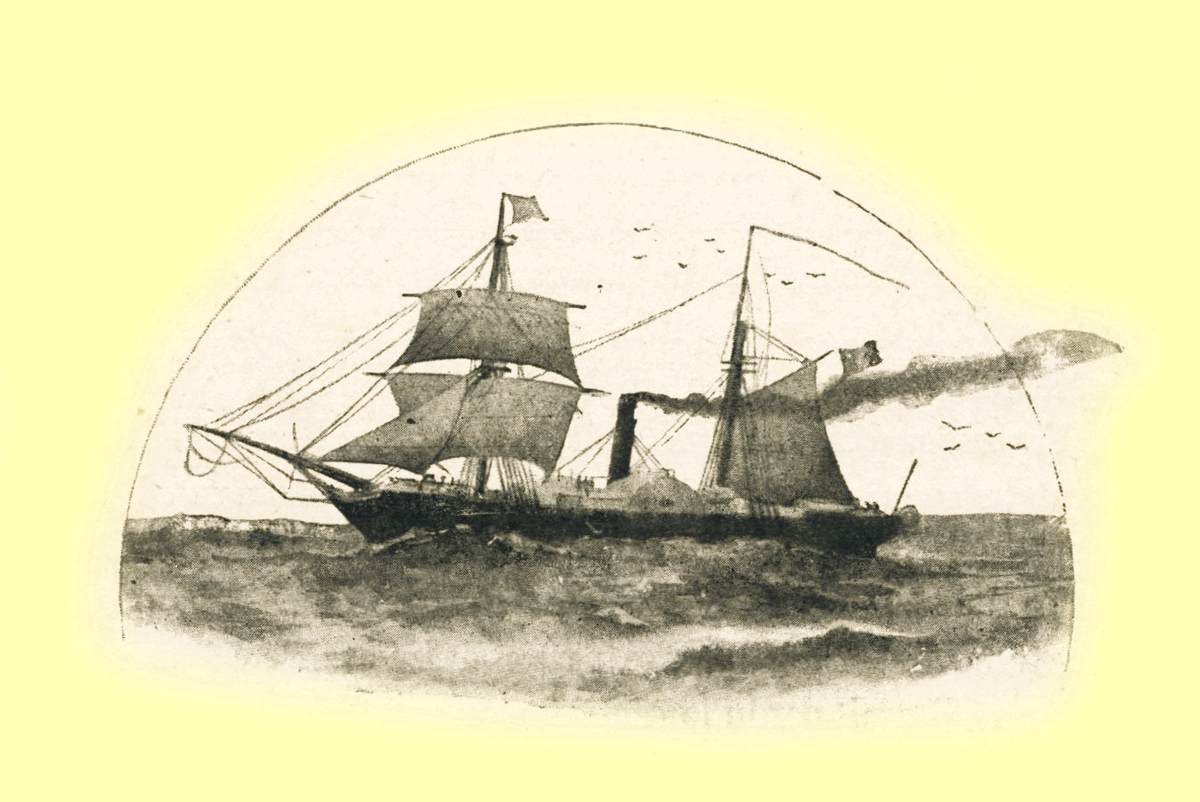
Évolution de la construction navale
Avec la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle, la construction navale militaire évolua:
Propulsion:
Le vent — gratuit, fut remplacé par le charbon — qu'il fallait extraire, transporter et entreposer.
Les voiles furent remplacées par des machines à vapeur et bien plus tard par des machines fonctionnant au fuel.
La propulsion se faisait grâce à des roues à aubes au début et ensuite par des hélices.
Armement:
Les épais bordages en chêne des navires furent renforcés par des plaques métalliques en bronze et en fer dans un premier temps … et …
… ensuite, les navires en bois furent remplacés par des navires en fer.
Les navires Trois-ponts  devinrent des Dreadnoughts
devinrent des Dreadnoughts  et ensuite des Cuirassés
et ensuite des Cuirassés  .
.
Les canons alimentés par la gueule avec des boulets sphériques devinrent des canons rayés propulsant des projectiles en forme d'ogive … avec chargement par la culasse !
De progrès en progrès, les marins s'entretuèrent plus efficacement et massivement.
etc., etc.

(Hachette et Cie, éditeurs.)
Le 3 octobre, l'escadre française débarqua 19 pièces et 1100 hommes.
Au bout d'un an, des appels successifs avaient porté ce contingent à 128 bouches à feu et à 2434 hommes. L'escadre anglaise forma de son côté une brigade navale destinée à servir les premiers canons à boulets ogivaux dont il ait été fait usage.
Cette batterie prit le nom des pièces dont on l'avait armée; ce fut la fameuse batterie de Lancastre.
Comme des cavaliers qui ont mis pied à terre, les marins de la flotte assiégée et ceux de la flotte assiégeante se trouvèrent pendant onze mois face à face. L'œil constamment fixé sur la même embrasure, ils étonnèrent les deux armées par la précision de leur tir, non moins que par la constance de leur courage.
Nos travaux avaient été plus d'une fois rasés. On les avait repris avec persévérance. Le moment d'ouvrir le feu approchait. Pendant que le gros des escadres alliées restait mouillé à l'embouchure de la Katcha, l'amiral Brual, détaché devant Kamiesh, exécutait les reconnaissances qui lui avaient été prescrites, et faisait baliser les approches de la rade.
La marine et l'armée espéraient pouvoir foudroyer de concert les défenses de Sébastopol.
Le 17 octobre, nous fûmes éveillés par un feu terrible. Les batteries de siège avaient, dès les premiers rayons du jour, dégorgé leurs embrasures. Muettes jusque-là, elles essayaient pour la première fois leur puissance. Les batteries russes ripostaient avec énergie, la terre en tremblait, et l'ébranlement du sol semblait se prolonger jusqu'à bord.
Vers dix heures, tout à coup le feu cesse; nous n'avions rien prévu de semblable. Le canon de l'armée se taisait au moment où celui de la flotte allait parler.
Déjà en effet accourait du mouillage de la Katcha l'escadre de l'amiral Hamelin.
Une brume épaisse l'avait jusqu'alors dérobée à nos yeux. Nous nous hâtons. Les vaisseaux à voiles et les frégates à vapeur s'accouplent; les vaisseaux à hélice appareillent. La corvette le Pluton éclaire la route; le Charlemagne et le Montebello arrivent les premiers sous le canon des forts. Des boulets ont fait jaillir l'eau près de nous. Une forte secousse ébranle le vaisseau. C'est un obus qui vient de traverser la dunette sous les pieds mêmes de l'amiral.
D'autres obus sifflent dans la mâture ou frappent à la flottaison.
Des boulets rouges ont mis trois fois le feu à bord. Debout sur les parapets, les canonniers russes rechargent leurs pièces. Nous jetons l'ancre enfin, et travaillons à nous embosser.
Les escadres alliées se développent lentement sur deux rangs endentés.
Quatorze vaisseaux français, dix vaisseaux anglais et deux vaisseaux turcs forment autour des fortifications de Sébastopol un double croissant qui s'étend des batteries de la Quarantaine aux batteries du Télégraphe. On se bat au milieu d'une fumée intense. L'Agamemnon, que monte l'amiral Lyons, a pénétré dans un des replis du récif qui défend, mieux encore que les feux croisés des deux rives, l'entrée de la rade de Sébastopol.
Il mouille à 760 mètres du fort Constantin.
Le Sans-Pareil et le London ont suivi l'Agamemnon.
Cette division se trouve assaillie par des feux plongeants; elle appelle bientôt de nouveaux vaisseaux à son aide.
Le Rodney le premier répond à ce signal ; malheureusement il va donner sur l'extrémité du récif. L'Albion, le Queen, le Bellérophon, se sont approchés à leur tour.
Vigoureusement attaqué par les vaisseaux anglais et par quelques-uns des vaisseaux de notre aile gauche, le fort Constantin chancelle sous ses trois étages de batteries.
Les hauteurs du Télégraphe n'en font pas moins pleuvoir sur le détachement que commande l'amiral Lyons une grêle de projectiles. La moitié de la flotte anglaise ne peut plus avoir qu'une pensée : sortir du mauvais pas où l'audace de son chef l'a conduite. Des frégates se dévouent et enlèvent le Rodney du banc sur lequel, au début de l'action, ce vaisseau s'est échoué. Aucun trophée ne restera entre les mains de l'ennemi, mais ce n'est pas de ce côté que le feu des Russes sera éteint.
Le Charlemagne, le Montebello, le Friedland, la Ville de Paris, le Valmy, le Henri IV, le Napoléon, ont attaqué les forts du sud. Ils sont appuyés par l'Alger, le Jean-Bart, le Marengo, la Ville-de-Marseille, le Suffren, le Bayard, le Jupiter, qui tirent dans les créneaux de la première ligne.
Belle photographie du Montebello, vaisseau de premier rang français nommé ainsi en hommage à Jean Lannes, Maréchal d'Empire, et Duc de Montebello.
Le Montebello était un vaisseau de type 118 canons de Sané. Lancé à Toulon le 6 décembre 1812, il est motorisé en 1851, participe à la guerre de Crimée en Mer Noire en 1855 avant d'être désarmé en 1857 puis réarmé en 1860 afin de servir de navire école pour les canonniers. Il est à nouveau désarmé en 1865 puis rayé des listes le 25 juin 1867, après 55 ans de bons et loyaux services rendus à la Marine française.
https://fr-fr.facebook.com/TroisPonts/photos/a.458341244209904/1359161254127894/?type=3&theaterLes hauts-fonds dont la ligne d'embossage a du suivre le contour ont obligé notre escadre à jeter l'ancre à 1800 mètres environ des batteries de la Quarantaine.
Malgré la distance, qui enlève à notre tir une partie de son efficacité, la défense sur la rive méridionale paraît à peu près réduite. Vers quatre heures, le feu reprend avec une vivacité nouvelle; les bastions mêmes de la place se joignent aux batteries du bord de la mer. Les bombes, les obus pleuvent autour de nous. L'ennemi heureusement ne peut apercevoir que la pointe de nos mâts, qui surgissent comme des balises au-dessus d'un océan de fumée; ses coups portent trop haut. Le nuage protecteur qui nous environne ne lui permet pas de les rectifier; si ce nuage se dissipait, si les Russes abaissaient de quelques degrés leur tir, notre position deviendrait critique. Les boulets ne cessent de siffler au-dessus de nos têtes, bien peu s'enfoncent dans les flancs de nos navires. Sous le canon des Russes dès midi et demi, embossés vers une heure, nous n'avons pas eu à bord du Montebello trente minutes de combat sérieux.
Les vapeurs opaques étendues autour des deux flottes ont aussi envahi le ciel. Le soleil apparaît à travers ce brouillard comme un globe de sang. Nous le voyons descendre lentement vers l'horizon et annoncer la fin prochaine du jour; nous n'attendons que ce moment pour nous éloigner.
Les vaisseaux anglais, plus maltraités que les nôtres, ont déjà commencé leur mouvement de retraite.
L'impunité relative dont nous avons joui et un meilleur succès ne nous abusent pas sur le résultat de nos efforts.
Lorsque nous nous serons retirés, l'ennemi n'aura qu'à relever ou à remplacer ses pièces démontées, ses terrassements seront intacts; l'enjeu n'est pas égal : nous engageons dans la partie un capital de 50 ou 60 millions, les Russes en seront quittes pour quelques pelletées de terre.
dans le détroit de Bonifacio
C’était un trois mâts à coque de bois fort bien armé. La Sémillante était l'une des 27 frégates de 60 canons construites de 1822 à 1849, les dernières étant équipées de machines à vapeur. Longue de 54 m et large de 14 m, elle représentait l'aboutissement de trois siècles de recherches en architecture navale. Mise sur cale à Lorient le 19 mars 1827, elle ne fut lancée que 14 ans plus tard, le 16 février 1841.
Ces brumes-là, monsieur, on ne se doute pas comme c'est traître. Ça ne fait rien, j'ai idée que la Sémillante a dû perdre son gouvernail dans la matinée, car il n'y a pas de brume qui tienne ; sans une avarie, jamais le capitaine ne serait venu s'aplatir ici contre. C'était un rude marin, que nous connaissions tous. Il avait commandé la station en Corse pendant trois ans, et savait sa côte aussi bien que moi, qui ne sais pas autre chose.
— Et à quelle heure pense-t-on que la Sémillante a péri?
— Ce doit être à midi ; oui, monsieur, en plein midi....
Mais, dame! avec la brume de mer, ce plein midi-là ne valait guère mieux qu'une nuit noire comme la gueule d'un lion.... Un douanier de la côte m'a raconté que ce jour-là, vers onze heures et demie, étant sorti de sa maisonnette pour rattacher ses volets, il avait eu sa casquette emportée par un coup de vent, et qu'au risque d'être enlevé lui-même par la lame, il s'était mis à courir après, le long du rivage, à quatre pattes. Vous comprenez, les douaniers ne sont pas riches, et une casquette, ça coûte cher. Or il paraîtrait qu'à un moment notre homme, en relevant la tête, aurait aperçu tout près de lui, dans la brume, un gros navire à sec de toile qui fuyait sous le vent du côté des îles Lavezzi. Ce navire allait si vite, si vite, que le douanier n'eut guère le temps de bien voir. Tout fait croire cependant que c'était la Sémillante, puisque une demi-heure après, le berger des îles a entendu sur ces roches.... Mais précisément voici le berger dont je vous parle, monsieur; il va vous conter la chose lui-même.... Bonjour, Palombo..., viens te chauffer un peu ; n'aie pas peur. »
Un homme encapuchonné, que je voyais rôder depuis un moment autour de notre feu et que j'aurais pris pour quelqu'un de l'équipage, car j'ignorais qu'il y eût un berger dans l'île, s'approcha de nous craintivement.
C'était un vieux lépreux, aux trois quarts idiot, atteint de je ne sais quel mal scorbutique qui lui faisait des lèvres lippues, horribles à voir. On lui expliqua à grand'peine de quoi il s'agissait. Alors, soulevant du doigt sa lèvre malade, le vieux nous raconta qu'en effet le jour en question, vers midi, il entendit dans sa cabane un craquement effroyable sur les roches. Comme l'île était toute couverte d'eau, il n'avait pas pu sortir, et c'est le lendemain seulement qu'en ouvrant sa porte, il avait vu le rivage encombré de débris et de cadavres laissés là par la mer. Épouvanté, il s'était enfui en courant vers sa barque, pour aller à Bonifacio chercher du monde.
Fatigué d'en avoir tant dit, le berger s'assit, et le patron reprit la parole :
Oui, monsieur, c'est ce pauvre vieux qui est venu nous prévenir. Il était presque fou de peur, et, de l'affaire, sa cervelle en est restée détraquée. Le fait est qu'il y avait de quoi.... Figurez-vous six cents cadavres en tas sur le sable, pêle-mêle avec les éclats de bois et les lambeaux de toiles.... Pauvre Sémillante !... la mer l'avait broyée du coup, et si bien mise en miettes que dans tous ses débris le berger Palombo n'a trouvé qu'à grand'peine de quoi faire une palissade autour de sa hutte....
Quant aux hommes, presque tous défigurés, mutilés affreusement, c'était pitié de les voir accrochés les uns aux autres, par grappes.... Nous trouvâmes le capitaine en grand costume, l'aumônier son étole au cou ; dans un coin, entre deux roches, un petit mousse, les yeux ouverts : on aurait cru qu'il vivait encore ; mais non ! Il était dit que pas un n'en échapperait. »
Ici le patron s'interrompit
Attention, Mardi ! cria-t-il, le feu s'éteint. »
Mardi jeta sur la braise deux ou trois morceaux de planches goudronnées qui s'enflammèrent, et Lionetti continua :
« Ce qu'il y a de plus triste dans cette histoire, le voici.... Trois semaines avant le sinistre, une petite corvette, qui allait en Crimée comme la Sémillante, avait fait naufrage de la même façon, presque au même endroit; seulement, cette fois-là, nous étions parvenus à sauver l'équipage et vingt soldats du train qui se trouvaient à bord....
Ces pauvres tringlots n'étaient pas à leur affaire, vous pensez !
On les emmena à Bonifacio, et nous les gardâmes pendant deux jours avec nous, à la marine.... Une fois bien secs et remis sur pieds, bonsoir ! bonne chance ! ils retournèrent à Toulon, où, quelque temps après, on les embarqua de nouveau pour la Crimée.... Devinez sur quel navire? ...
Sur la Sémillante, monsieur.... Nous les avons retrouvés tous, tous les vingt, couchés parmi les morts, à la place où nous sommes....
Je relevai moi-même un joli brigadier à fine moustache, un blondin de Paris que j'avais couché à la maison et qui nous avait fait rire tout le temps avec ses histoires.... De le voir là, ça me creva le cœur.... Ah ! Santa Madre »
Là-dessus le brave Lionetti, tout ému, secoua les cendres de sa pipe et se roula dans son caban en me souhaitant la bonne nuit. Pendant quelque temps encore les matelots causèrent entre eux à demi-voix.... Puis, l'une après l'autre, les pipes s'éteignirent.... On ne parla plus.... Le vieux berger s'en alla, et je restai seul à rêver au milieu de l'équipage endormi.
Encore sous l'impression du lugubre récit que je venais d'entendre, j'essayais de reconstruire dans ma pensée le pauvre navire défunt et l'histoire de cette agonie dont les goélands ont été seuls témoins. Quelques détails qui m'avaient frappé, le capitaine en grand costume, l'étole de l'aumônier, les vingt soldats du train, m'aidaient à deviner toutes les péripéties du drame.... Je voyais la frégate partant de Toulon dans la nuit. Elle sort du port. La mer est mauvaise, le vent terrible ; mais on a pour capitaine un vaillant marin, et tout le monde est tranquille à bord.
Le matin, la brume de mer se lève. On commence à être inquiet. Tout l'équipage est en haut. Le capitaine ne quitte pas la dunette. Dans l'entre-pont où les soldats sont renfermés, il fait noir ; l'atmosphère est chaude. Quelques-uns sont malades, couchés sur leurs sacs. Le navire tangue horriblement; impossible de se tenir debout. On cause assis à terre par groupes, en se cramponnant aux bancs ; il faut crier pour s'entendre. II y en a qui commencent à avoir peur....
Écoutez donc ! Les naufrages sont fréquents dans ces parages- ci ; les tringlots sont là pour le dire, et ce qu'ils racontent n'est pas rassurant. Leur brigadier surtout, un Parisien qui blague toujours vous donne la chair de poule avec ses plaisanteries : « Un naufrage !... mais c'est très amusant, un naufrage. Nous en serons quittes pour un bain à, la glace, et puis on nous mènera à Bonifacio, histoire de manger des merles chez le patron Lionetti. Et les tringlots de rire....
Tout à coup un craquement.... Qu'est-ce que c'est? Qu'arrive-t-il? ... « Le gouvernail vient de partir », dit un matelot tout mouillé qui traverse l'entrepont en courant. « Bon voyage ! » crie cet enragé de brigadier ; mais cela ne fait plus rire personne.
Grand tumulte sur le pont. La brume empêche de se voir. Les matelots vont et viennent effrayés, à tâtons.... Plus de gouvernail ! La manœuvre est impossible.... La Sémillante, en dérive, file comme le vent.... C'est à ce moment que le douanier la voit passer; il est onze heures et demie. A l'avant de la frégate, on entend comme des coups de canon.... Les brisants ! les brisants!... C'est fini, il n'y a plus d'espoir, on va droit à la côte. Le capitaine descend dans sa cabine. Au bout d'un moment, il vient reprendre sa place sur la dunette — en grand costume. Il a voulu se faire beau pour mourir.
Dans l'entre-pont, les soldats, anxieux, se regardent, sans rien dire.... Les malades essayent de se redresser.... Le petit brigadier ne rit plus.... C'est alors que la porte s'ouvre et que l'aumônier paraît sur le seuil avec son étole : « À genoux, mes enfants ! » Tout le monde obéit. D'une voix retentissante, le prêtre commence la prière des agonisants.
Soudain un choc formidable, un cri, un seul cri, un cri immense, des bras tendus, des mains qui se cramponnent, des regards effarés où la vision de la mort passe comme un éclair.... Miséricorde !..
C'est ainsi que je passai toute la nuit à rêver, évoquant, à dix ans de distance, l'âme du pauvre navire dont les débris m'entouraient.... Au loin, dans le détroit, la tempête faisait rage ; la flamme du bivouac se courbait sous la rafale, et j'entendais notre barque danser au pied des roches en faisant crier son amarre.
(Charpentier, éditeur.)
pendant la guerre de Crimée
Les bâtiments s'approvisionnaient à un puits situé à cinq ou six kilomètres au nord de la ville, mais lorsque les glaces rendirent la côte inabordable, ils durent avoir recours à la neige fondue. Très peu d'entre eux possédaient alors les précieux appareils grâce auxquels on est sûr désormais de ne plus manquer d'une eau excellente, tant que l'on a du combustible.
Les ressources alimentaires qui existaient dans l'étroite bande de terre que nous occupions furent vite épuisées, mais dans les premiers mois qui suivirent l'évacuation d'Anapa par les Russes, les bâtiments de la station s'y procurèrent, d'abord facilement et à bas prix, quelques moutons et surtout des volailles de toute espèce et même des faisans. Malheureusement pour les occupants du détroit des vapeurs envoyés par des industriels de Balaclava et de Kamiesch vinrent visiter ce point privilégié, et en peu de voyages ils eurent drainé tout ce que ses environs renfermaient de denrées comestibles.
Dès le commencement de l'hiver, les ressources d'Anapa étaient épuisées, et marins et soldats furent réduits aux vivres de campagne.
L'Intendance envoyait des bœufs au camp Saint-Paul et cédait aux équipages deux repas de viande fraîche par semaine, mais pendant quatre mois nous ne vîmes pas une feuille de chou. La pêche, fructueuse en toute saison devant Sébastopol, l'avait aussi été dans le détroit jusqu'à l'apparition des glaces, alors les poissons émigrèrent et la capture de deux ou trois poissons ayant l'aspect de harengs, véritables paquets d'arêtes, était une bonne fortune ; on en faisait une soupe.
Le pays était très giboyeux, mais il fallait rester en dedans de la ligne des vedettes, et comme par les temps brumeux, très fréquents en hiver, ces vedettes se rapprochaient des postes pour ne pas être cernées ou surprises, la zone de chasse était très limitée. Malgré toutes les précautions, cette utile distraction n'était pas sans danger et plusieurs chasseurs furent enlevés par de hardis cavaliers.
Un matin du mois de février, deux officiers français, accompagnés d'un soldat, sortirent du camp pour chasser le lièvre entre Saint-Paul et Kertch. Au moment où ils quittaient la route se dirigeant vers l'intérieur, ils croisèrent une patrouille de chasseurs d'Afrique. « Vous savez que les vedettes sont repliées, leur dit le brigadier; on ne voit pas loin aujourd'hui, prenez garde!
— Oh ! nous serons prudents. »
Quelques minutes plus tard, à 500 mètres de la grande route, ils tirèrent presque en même temps sur deux lièvres, dont l'un fut tué et l'autre blessé; et tout en rechargeant leurs armes, ils se mirent à la poursuite de ce dernier. Ils étaient à peine à 50 mètres en dehors de la ligne des vedettes, lorsqu'une douzaine de cosaques, blottis derrière deux meules de foin, les entourèrent et les enlevèrent; en un clin d'œil ils étaient hors de vue, perdus dans la brume.
Une vedette voisine tira un coup de fusil; les postes prirent les armes et accoururent, mais le coup était fait; l'ordonnance rentra seul au camp. Une mésaventure semblable était arrivée, au mois de novembre, à trois officiers du Vautour près de Kinbourn.
Quelques jours après, un paysan apporta aux avant-postes une lettre de l'un des officiers; il disait comment ils avaient été pris et conduits à Caffa ; ils étaient bien traités, mais manquaient de vêtements et d'argent.
Le général russe les autorisait à écrire qu'un parlementaire serait reçu par mer, si on jugeait devoir leur envoyer ce qu'ils demandaient. Le Ténare fut désigné pour cette mission, et, après avoir reçu les malles, un paquet de lettres et l'argent qui leur étaient destinés, j'appareillai pour Caffa par un temps clair et une très forte brise du nord-ouest.
Bien que le thermomètre ne marquât que huit degrés au-dessous de zéro, je ne me souviens pas d'avoir jamais autant souffert du froid que pendant cette journée. Les lames, en frappant contre les joues et les tambours du bâtiment, envoyaient sur le pont et sur la passerelle une pluie qui se congelait immédiatement ; le pont, le gréement inférieur, les bastingages, les vêtements de tous ceux que le service retenait sous cette pluie ou plutôt sous cette grêle étaient couverts d'une épaisse couche de glace.
La mer tomba en approchant du mouillage, nous avions hissé nos couleurs et le pavillon parlementaire.
Une embarcation vint au-devant de nous, l'officier qui la commandait m'interrogea sur le but de notre visite, et après toutes les questions d'usage et l'engagement de ma part de ne pas essayer de relever la position des batteries, il nous conduisit au point où nous devions mouiller.
Le point indiqué était un peu dans l'ouest d'un grand débarcadère en bois, et à 300 mètres environ d'une belle batterie. L'officier russe retourna à terre en m'invitant à ne pas quitter le bord avant son retour ; il allait rendre compte au gouverneur et prendre ses ordres.
Je profitai de ce répit pour changer de vêtements, je pensai qu'il était convenable de me présenter en habit, et quand l'officier vint m'annoncer que j'étais autorisé à descendre à terre, j'embarquai dans ma baleinière qui portait à l'arrière le pavillon tricolore et à l'avant le pavillon blanc.
En sautant sur le débarcadère, je rejetai dans l'embarcation le manteau qui protégeait mes épaulettes et je restai en une tenue d'inspection que ne comportait guère la saison. Je fus reçu par un colonel d'état-major (amputé d'un bras à la suite d'une blessure reçue au Caucase) et par plusieurs officiers. Il y avait à proximité un piquet d'infanterie l'arme au pied, et, aux limites d'une belle place, des cosaques circulaient, empêchant la foule d'approcher; ils semblaient faire un fréquent usage de la hampe de leurs lances.
Au milieu de la place, beaucoup d'officiers et parmi eux nos deux camarades.
Après les salutations, le colonel me dit que je pouvais communiquer et causer avec mes compatriotes, mais que je prenais l'engagement d'honneur de ne recevoir d'eux aucune correspondance ni chercher à me procurer pendant mon séjour aucun renseignement sur les défenses de la place. Je pris cet engagement, en ajoutant que, s'il le désirait, je lui indiquerais sur la carte l'emplacement de toutes les batteries ayant vue sur la mer.
Les deux officiers français arrivèrent, ils étaient enchantés de voir un camarade leur apportant avec des nouvelles de leurs familles et de leurs amis tout ce qui leur manquait, sauf, hélas ! la liberté ; ils étaient heureux de pouvoir désormais payer leur part de dépense à la table d'officiers où ils avaient été admis.
Pendant qu'ils prenaient connaissance de leurs lettres, les officiers russes s'approchèrent de moi et nous entrâmes en conversation. Ils s'étonnèrent de me voir si légèrement vêtu par un temps aussi rigoureux et alors qu'ils étaient couverts de fourrures; je leur répondis qu'il faisait froid, mais que cette température était très supportable et que je n'en souffrais nullement.
C'était horriblement faux !
On apporta à plusieurs reprises du thé bouillant fortement additionné de rhum et du vin chaud ; mes canotiers ne furent pas oubliés.
Le colonel me dit qu'une paix prochaine était probable et qu'elle serait déjà faite sans nos alliés, qui y mettaient peu de bon vouloir.
Je ne répondis pas à cette allusion aux sentiments de nos alliés, mais je dis que si les conditions de la paix étaient honorables et remplissaient le but poursuivi par notre gouvernement, elle serait la bienvenue. Il me parla ensuite de l'occupation d'Eupatoria, sur laquelle je fus surpris de le voir aussi mal renseigné; il croyait que nous y avions 20 ou 25 000 hommes, je me gardai bien de le détromper. Le stratagème des amiraux Bruat et Lyons, dont nous avions ri à l'époque, avait réussi. Les deux amiraux s'étaient présentés devant Eupatoria avec de nombreux bâtiments de guerre et des transports. On avait mis à terre avec ostentation les troupes d'occupation qui devaient suffire avec quelques canonnières; puis, jusqu'à la nuit, des détachements de marins et de soldats firent la navette entre les navires et la plage ; nous ne pensions pas que les espions de l'adversaire s'y laissaient prendre, nous nous trompions !
Puis il me parla de la prise de Kinbourn, à laquelle le Ténare avait aussi pris part, des bombardes et surtout des batteries flottantes qui avaient, pour la première fois, opposé un blindage en fer aux projectiles de la forteresse, qui avait même commencé à tirer sur elles à mitraille, les prenant pour d'immenses chalands chargés de monde. Enfin il me demanda si ce n'était pas mon bâtiment qui, au commencement de décembre, avait lancé des bombes dans la direction du camp d'Arabat. Sur ma réponse affirmative, il me dit :
« Eh bien, commandant, vous avez bien failli passer le reste de votre hiver à Caffa. Quand on vous a vu quitter votre mouillage, on était persuadé à Arabat que vous ne sortiriez pas de la mer d'Azof. »
Les officiers français remirent au colonel des lettres qu'ils désiraient faire parvenir au camp Saint-Paul; il les ouvrit pour la forme et m'autorisa à m'en charger.
Le soleil baissait et j'annonçai que j'allais retourner à mon bord, en remerciant de l'accueil qui m'avait été fait. « Mais, remarqua le colonel, vous ne pourrez peut-être pas entrer dans le détroit cette nuit, et le temps doit être bien mauvais au large ?
— C'est plus que probable, car la nuit paraît devoir être assez sombre et le vent ne mollit pas.... »
Après avoir consulté du regard un autre officier supérieur, l'excellent colonel me dit :
« Veuillez attendre un instant, je vais demander au Gouverneur de vous autoriser à rester au mouillage jusqu'à demain matin; j'espère aussi qu'il vous autorisera ainsi que vos officiers à partager notre dîner au cercle militaire, et ce soir vous entendrez de la musique, plusieurs dames de la colonie sont d'excellentes musiciennes. »
Je n'avais certes aucune objection à faire à d'aussi séduisantes propositions.
Le colonel revint au bout de quelques minutes, assez décontenancé : le Gouverneur refusait et m'invitait à partir avant la nuit close. Il n'y avait qu'à s'incliner : je pris congé, tout en maugréant contre le vieux général à idées étroites (j'avais 35 ans!) et rentrai à bord.
Je donnai l'ordre de faire rapidement souper l'équipage et de se tenir prêt à appareiller. Quant à moi, je m'empressai de remplacer mon habit, qui avait produit son effet, par un vêtement plus approprié à la température, et je me mis à table : soupe à la julienne desséchée, haricots, lard salé, figues et amandes ; je comparais par supposition ce menu à celui du cercle des officiers. Mais le froid donne de l'appétit !
Je n'avais pas terminé mon repas, qu'un aide de camp du Gouverneur vint le long du bord prévenir que cet officier général m'autorisait à rester au mouillage jusqu'au matin, mais que toute nouvelle communication avec la terre nous était interdite. Nous devions certainement cette demi-gracieuseté à l'excellent colonel dont je regrette de ne pas me rappeler le nom.
La nuit se passa aussi tranquillement que sur une rade française ; nous étions du reste étroitement surveillés, je ne sais trop pourquoi, par des rondes d'embarcations, et des patrouilles parcourant la côte.
À l'aube le Ténare fit route pour Saint-Paul, où, poussé par une bonne brise, il arriva vers le milieu du jour.
Les armées alliées s'étaient solidement établies dans la presqu'île de Chersonèse, les Russes restaient en possession de la rive septentrionale du port ; l'hiver devait amener une trêve forcée entre les belligérants.
L'ordre arriva de Paris de renvoyer en France la garde impériale. Ces magnifiques régiments furent reçus à bord des bâtiments qui revenaient de Kinbourn; l'amiral Bruat, relevé de son laborieux commandement, se chargea de les ramener à Toulon.
Quel retour triomphal nous présageait ce départ salué des acclamations des deux flottes!
S'il convient d'être modeste dans la fortune, c'est surtout quand cette fortune est faite du deuil et des larmes des autres. Malheureusement il n'en est pas ainsi, et la joie des soldats est peut-être, de toutes les joies humaines, la plus insouciante dans son égoïsme. Je suis presque tenté aujourd'hui de me reprocher cette exaltation bruyante, cette gaieté sans remords qui, du jour où nous quittâmes Kamiesh, s'emparèrent du Montebello.
Nous nous arrêtâmes à Constantinople pour y renouveler notre approvisionnement de charbon.
Notre séjour dans le Bosphore ne fut qu'une succession de fêtes. Le sultan fit à l'amiral l'accueil auquel avait droit un des chefs qui avaient le plus contribué à le raffermir sur son trône. Les ministres enchérirent encore sur la réception du souverain ; ils savaient que l'amiral Bruat avait souvent consolé Omer-Pacha et le commandant de la flotte ottomane des dédains par lesquels on leur faisait si chèrement payer notre alliance ; ils tenaient à lui prouver que ces procédés délicats ne les avaient pas laissés insensibles.
Leurs hommages et leurs intentions allèrent droit au cœur de notre excellent amiral ; les grandeurs n'avaient pas altéré sa simplicité. Dans le haut rang où ses services l'avaient fait parvenir, il était resté le plus aimable et le moins pompeux des chefs.
Il commençait cependant à comprendre le rôle important qu'allait lui assigner l'éclat de cette campagne. La vivacité et la solidité de son jugement le rendaient propre à toutes les situations.
La santé seule pouvait lui faire défaut, mais il semblait que le bonheur dont son âme se montrait inondée dût prolonger sa vie et lui refaire en quelque sorte une constitution. Nous rêvions pour lui de longs jours. Son énergie nous trompait; il était de ces soldats qui meurent debout et pour ainsi dire sous les armes.
L'escadre avait quitté Constantinople ; elle avait doublé le cap Matapan. Quelques jours encore, et nous étions au port.
La mort se dressa sur notre passage.
Le 18 novembre, vers six heures du soir, l'amiral, qui n'avait cessé de diriger lui-même les mouvements de ses vaisseaux, fut trouvé défaillant et presque évanoui dans sa chambre.
Ses traits décomposés excitèrent nos alarmes. Ses joues étaient caves, et ce terrible signe du fléau qui avait fait tant de victimes dans l'armée de Crimée, la cyanose cholérique, marquait déjà d'un large cercle bleuâtre les yeux enfoncés dans leur orbite.
La nuit ne fut qu'une lutte douloureuse et sans espoir avec la mort.
Cette âme indomptable ne pouvait se résoudre à quitter ce corps de fer.
Dans la matinée qui suivit, l'abattement succéda aux douleurs et aux angoisses. Il y eut comme une amélioration subite dans l'état du malade, mais l'œil exercé des médecins ne s'y trompa point. On fit appeler l'aumônier, et les dernières prières furent récitées en présence de tous les officiers de l'état-major général, agenouillés auprès du lit du mourant.
L'amiral, depuis que le mal avait fait, vers quatre heures du matin, de rapides progrès, n'avait pas proféré une parole.
Jusque-là rien n'avait trahi chez lui l'inquiétude.
S'il interrompait parfois ses gémissements, c'était pour s'informer de la situation de l'escadre, de l'état du temps, des précautions prises.
L'amertume du terrible passage paraissait lui avoir été épargnée. Nous pouvions croire qu'il avait perdu le sentiment avant d'avoir eu conscience du danger qu'il courait ; mais, au moment où le prêtre prononçait les paroles suprêmes, son regard presque éteint sembla se ranimer. Il le promena lentement autour de lui. On eût dit qu'il cherchait je ne sais quel objet et qu'il s'inquiétait de ne pas le retrouver.
Ses yeux rencontrèrent enfin un portrait en pied qui était appendu à une des cloisons de la galerie. Ce portrait était celui d'une femme qui n'avait pas seulement embelli l'existence à laquelle le sort l'avait associée, mais qui, jeune encore, parée de toutes les vertus et de toutes les grâces, avait su montrer à cette existence, aujourd'hui si noblement remplie, autrefois si prompte à se prodiguer, la voie qu'elle devait suivre et le but où elle devait tendre.
Dès qu'ils eurent retrouvé cette chère image, les yeux de l'amiral ne s'en détournèrent plus.
Bientôt les lèvres déjà glacées s'entr'ouvrirent, la tête, qui s'était légèrement soulevée, retomba inerte.
Nous n'avions plus devant nous que des dépouilles insensibles, honorées encore de nos larmes.
La nouvelle de la perte immense que venaient de faire la marine et la France fut transmise à l'escadre par signal. Elle porta la consternation à bord de tous les bâtiments. L'amiral était adoré des officiers et des équipages. Il avait ces qualités brillantes qui séduisent les masses : la bravoure héroïque et l'affabilité; mais ce qui ajoutait encore à l'impression générale, c'était cet effroi dont on ne pouvait se défendre en songeant qu'un bonheur, bâti pierre à pierre, s'écroulait au moment même où rien ne lui manquait. La fortune semblait n'avoir comblé cet illustre favori que pour rendre plus amère la déception qu'elle lui préparait.
(Hachette et Cie, éditeurs.)
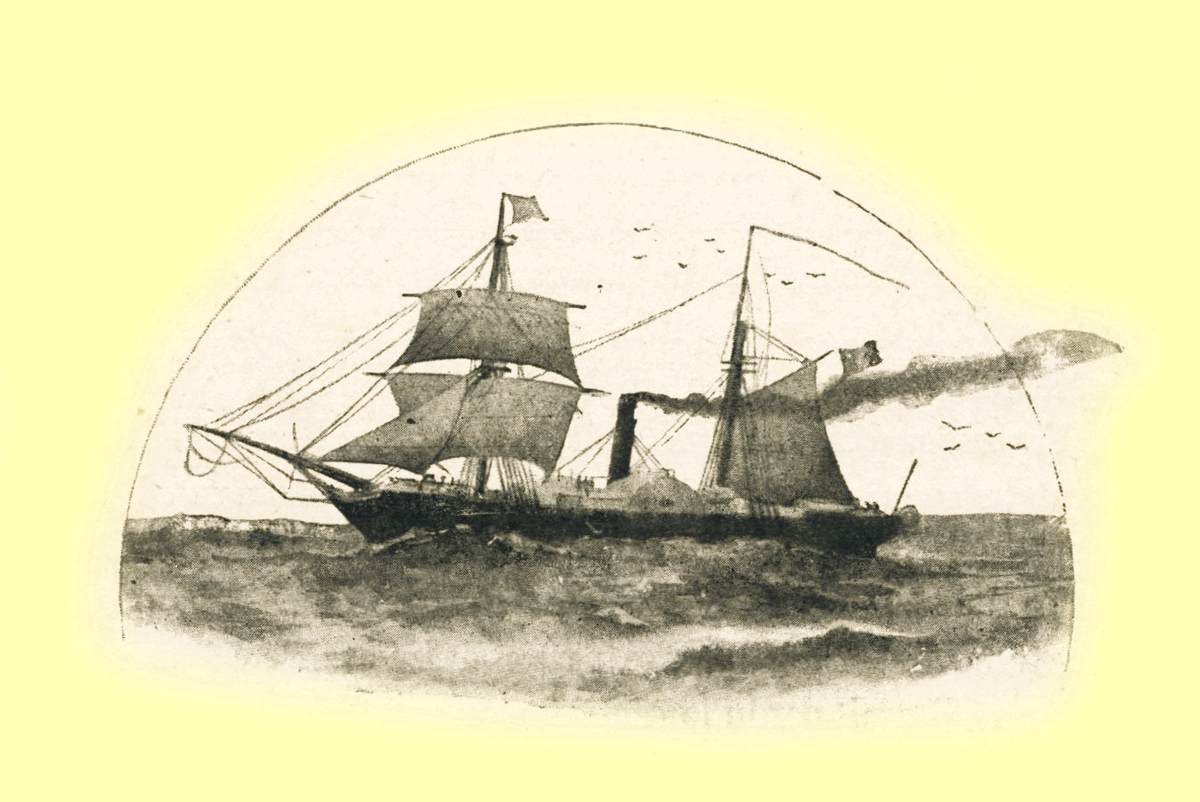
Propulsion:
Le vent — gratuit, fut remplacé par le charbon — qu'il fallait extraire, transporter et entreposer.
Les voiles furent remplacées par des machines à vapeur et bien plus tard par des machines fonctionnant au fuel.
La propulsion se faisait grâce à des roues à aubes au début et ensuite par des hélices.
Armement:
Les épais bordages en chêne des navires furent renforcés par des plaques métalliques en bronze et en fer dans un premier temps … et … … ensuite, les navires en bois furent remplacés par des navires en fer.
Les navires Trois-ponts
 devinrent des Dreadnoughts
devinrent des Dreadnoughts  et ensuite des Cuirassés
et ensuite des Cuirassés  .
.Les canons alimentés par la gueule avec des boulets sphériques devinrent des canons rayés propulsant des projectiles en forme d'ogive … avec chargement par la culasse !
De progrès en progrès, les marins s'entretuèrent plus efficacement et massivement.
etc., etc.